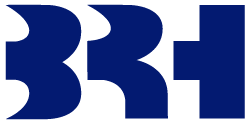Allocution de M. Ronald Gabriel, Membre du Conseil d’Administration de la BRH à l’occasion du forum “Mercredi de réflexions de la BID” au Centre de Convention de la BRH
Mesdames / Messieurs,
Mon propos consistera essentiellement à vous présenter le 3e numéro du Cahier de Recherche de la BRH qui propose au public des réflexions visant à alimenter la discussion sur les problématiques économiques au cœur des choix de politiques publiques. J’aimerais attirer votre attention sur le fait que les textes et les conclusions des investigations ne reflètent pas nécessairement le point de vue institutionnel de la BRH. Ils sont avant tout les résultats des travaux de nos économistes comme contribution aux débats académiques sur les questions de policy (politiques).
Chers amis,
Le dernier cahier de recherche de la Banque de la R épublique d’Haïti tourne autour de la problématique de l’Inflation. Il renvoie donc à la préoccupation fondamentale de toute Banque Centrale dont l’efficacité se mesure à l’aune de sa capacité à stabiliser le niveau général des prix. Cette perception, qui a pris un poids particulier depuis les déconvenues monétaires des années 80, a été quasiment portée au rang de règle dans la communauté des banquiers centraux qui ont suivi cette période. Le ciblage d’inflation dans la conduite de la politique monétaire et les riches débats que cette approche a suscités sont venus consigner ce fait dans le cercle des académiques comme dans celui des praticiens.
C’est donc avec une emphase particulière que les économistes de la BRH soumettent, à ces cercles que vous représentez, ce dernier cahier de recherche dont les travaux se proposent d’apporter un éclairage nouveau sur certains aspects majeurs de la problématique de l’inflation telle que vécue en Haïti durant les quarante dernières années. A ce titre, les réflexions qui traversent ces études constituent une halte de reconnaissance pour analyser (ces) (quatre) décennies de gestion liées à la stabilité des prix depuis la création de la banque centrale en 1979 et (de façon plus rapprochée) plus près de nous, une pause, pour évaluer le chemin parcouru depuis que l’introduction des Bons BRH en 1996 nous a fait faire un saut dans la modernité.
La nature des thèmes développés témoigne de la maturité des réflexions et le caractère utile des préoccupations soulevés. En effet, le choix des sujets traités n’a pas été guidé par le hasard. On y trouve associé une problématique majeure qui, loin de détrôner celle de la stabilité des prix, est venue renforcer son objet. Il s’agit de la croissance. On y trouve donc associé les préoccupations de croissance en tant qu’objectif économique ultime des politiques publiques de nature économique. Les effets et conséquences de la crise de 2008 sont là pour rappeler avec force que l’inflation non désirée est bordée de deux côtés sombres : l’hyper tension des sommets trop élevés et l’hypo tension des creux trop faibles. Les deux également dommageables pour la croissance.
C’est cette considération fondamentale qui motive ma proposition de faire tourner les réflexions, que suscitent les quatre études présentées dans ce dernier cahier de recherche, autour de l’une d’entre elles qui traite de La Nature de la Relation entre l’Inflation et la Croissance. Les trois autres sont tout aussi dignes d’intérêt, à la fois pour leur propre contenu que pour les implications qu’elles permettent de dégager, s’agissant de la problématique de la croissance. La BRH vient de publier d’ailleurs le premier volume de son « Agenda Monétaire pour la Croissance et L’emploi » que je vous invite aussi à lire avec attention.
Permettez-moi donc de citer, en les présentant, les quatre articles qui composent le cahier de recherche No 3:
Un modèle non linéaire du taux de change en Haïti
Cette étude propose une incursion dans la modélisation du taux de change sur la fréquence disponible la plus fine (avec l’approche qualifiée de discrétisation par les économètres et qui donne des résultats généralement assez robustes sur les relations comportementales entre les variables macroéconomiques). Elle couvre ainsi, sur une base journalière, la période inclusive du 3 octobre 2005 au 25 septembre 2009. Évidemment, de 2009 à date, diriez vous, il a pu se produire certaines mutations, notamment après le tremblement de terre de 2010 et l’afflux important des devises étrangères (près de 2 MG de dollars de RIN accumulées) portant certains économistes à évoquer même une situation de « dutch disease » donc, mutations susceptibles de nuancer un peu ou conforter les conclusions de l’investigation. Ce qui fait qu’une suite possible de ce working paper pourrait consister à investiguer la stabilité des résultats et des conclusions au cours de la période qui a suivi le choc de 2010. L’intérêt de l’étude réside dans l’utilisation d’une forme fonctionnelle non linéaire et de techniques d’estimation y relatives pour modéliser le taux de change à partir de sa mémoire chronologique.
A partir de tests probants de non linéarité dans la dynamique du taux de change journalier, l’étude propose un modèle à changement de régime porté par la fonction logistique d’un processus autorégressif. La superposition de la série calculée avec la série observée témoigne de la bonne performance des résultats confortés par des prévisions dynamiques plausibles.
Ces résultats ouvrent la voie vers la prévision et le ciblage du taux de change à travers l’utilisation d’une démarche non linéaire. Cependant, malgré la capacité prévisionnelle souvent limitée des modèles structurels, ces derniers ont la vertu de mettre l’accent sur les relations de causalité du taux de change avec des variables instrumentales qui permettent d’orienter les politiques publiques. La cohabitation des différents types de modèles demeure l’option la plus viable dans l’état actuel des outils d’aide à la décision.
Ratio de sacrifice : Une estimation pour l’économie Haïtienne à partir d’un VAR structurel.
Ce ratio établit fondamentalement le coût économique ultime associé à une baisse de l’inflation non désirée : à savoir la perte de croissance correspondante. Cette étude propose une évaluation de cette relation pour Haïti à travers la quantification des réponses dégagées de fonctions d’impulsions tirées d’un modèle de VAR structurel. Ces réponses ou innovations structurelles sont établies pour l’économie haïtienne sur la période 1986-2015 à partir d’une variante de la courbe Phillips qui permet d’isoler les effets spécifiques des chocs de demande.
L’écart par rapport au PIB potentiel (out gap) est la variable principale sur laquelle porte le choc de demande associé à une politique anti inflationniste ; le niveau des prix et le taux de change étant les deux autres variables qui complètent le modèle. Les résultats sur la période montrent un ratio de sacrifice de 0,97% , interprété comme étant la déviation du PIB réel en deçà de son niveau potentiel suite à une politique préposée à une diminution permanente de 1% de l’inflation non désirée.
Ce ratio de sacrifice est d’un niveau faible même s’il reste dans la lignée de pays comme le Brésil, la Bolivie et le Pérou et est en moyenne plus élevé que ceux enregistré pour la Jamaïque et Trinidad and Tobago. Cette faiblesse du ratio peut être expliquée notamment par le poids élevé des importations de biens de consommation finale dans l’économie et la prévalence concomitante des marges commerciales dans la VA globale (près 50% du secteur 3). La faiblesse du ratio montre aussi le degré important de contraction monétaire à consentir pour contenir les effets inflationnistes dans un environnement faiblement industrialisé et fortement empreinte d’un biais d’inflation.
Effet de seuil dans la relation entre l’inflation et la croissance économique en Haïti
Cette étude cherche à établir l’existence d’une relation non linéaire entre l’inflation et la croissance économique en Haïti dans la lignée des travaux qui soutiennent l’idée d’un seuil en dessous duquel l’inflation entretient la croissance et au dessus duquel elle s’y oppose. Cette investigation est de première importance dans la compréhension et la gestion des politiques macroéconomiques en ce sens que d’abord
- Elle apporte un certain éclairage sur une confusion apparente qui veut que la croissance des prix soit tantôt désirable et tantôt dommageable pour l’activité économique. L’établissement de ce seuil explique en quoi la relation entre inflation et croissance est sujette à un changement de régime qui la fait passer du positif au négatif.
- Ensuite, l’étude propose des balises aux praticiens économistes pour aider à un arbitrage plus rationnel entre inflation et croissance. Elle les force à penser davantage au degré plutôt qu’au sens de la relation en raison du fait empirique que le seuil détermine le caractère positif ou négatif de la relation.
Ce qui fait l’attraction de ce seuil en fait aussi une arme à double tranchant. On se souvient comment une mauvaise appréciation empirique du Max de la Courbe de Laffer aux USA a conduit, dans les années 80, à une application dommageable de la politique de l’offre dans ce pays. C’est pour cela que les travaux approfondis sur le seuil de la relation entre inflation et croissance, bien au delà des efforts de modélisation et des techniques d’estimations, doivent être soumis à des considérations structurelles, sectorielles et multidisciplinaires.
En attendant, l’étude que présente ce cahier de recherche est suffisamment bien étoffée pour retenir l’attention sur les résultats empiriques qu’elle délivre. Le seuil trouvé à la suite d’un processus itératif de régressions séquentielles est de 18%. Elle conclut à l’existence d’une relation dynamique non linéaire entre inflation et croissance économique et à des marges de politiques expansionnistes qualitativement éprouvées jusqu’à concurrence de 18% d’inflation. Enfin… la qualification même de la politique expansionniste est en soi une problématique à investiguer dans le contexte haïtien ou ailleurs.
Estimation de l’impact du financement du déficit budgétaire sur l’inflation en Haïti
Cette étude utilise un modèle VAR pour analyser les créneaux par lesquels le financement du déficit budgétaire agit sur l’inflation. Les résultats des estimations concluent à une relation généralement bien établie entre le financement monétaire du déficit budgétaire à travers le crédit à l’Etat, la masse monétaire M2 et l’inflation.
Des tests de causalité de Granger effectués sur une fréquence mensuelle et couvrant la période de 1982 à 2015 concluent à la séquence suivante : les valeurs retardées du crédit à l’Etat influencent les valeurs présentes et futures de la masse monétaire au sens large qui, à leur tour, agissent sur l’inflation sur une base contemporaine et future. L’étude des fonctions de réponse du modèle confirme cette séquence tout en dégageant la propagation des effets de causalité.
Un autre aspect de premier intérêt de cette étude est une analyse succincte mais suffisamment instructive de l’environnement macroéconomique de la longue période 1980 – 2015 décomposée en cinq sous périodes bien caractérisées.
Je ne vais pas m’attarder davantage sur cet article étant donné qu’il va faire l’objet de la principale présentation du jour après une mise en contexte par Kesner Pharel.
Je vous remercie de votre attention