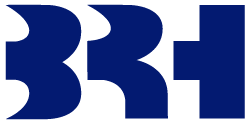Entrevue de l’ancien Gouverneur Jean Baden Dubois sur Télé Métropole le 2 janvier 2022
Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances,
Mesdames, Messieurs les Ministres
Messieurs les Secrétaires d’État
Messieurs les Sénateurs
Monsieur le Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti
Madame, Messieurs les Membres du Conseil d’Administration de la BRH
Mesdames, Messieurs les Membres du Corps Diplomatique
Mesdames, Messieurs les Représentants des Institutions Financières
Mesdames, Messieurs les Partenaires Internationaux
Mesdames, Messieurs les Directeurs et Cadres actifs de la BRH
Mesdames, Messieurs du Secteur des Médias
Mesdames, Messieurs,
Chers compatriotes,
Permettez-moi d’entrée de jeu, de présenter mes félicitations au Gouverneur et au Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haïti, pour l’élaboration d’un Plan Stratégique Global visant l’horizon 2024. J’apprécie à leur juste valeur les efforts déployés par toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce travail méthodique et bien pensé. Concevoir des plans stratégiques devrait être une démarche adoptée par toutes nos administrations, Ceci est encore plus nécessaire, dans un contexte difficile comme celui que connait notre pays. Et quand ces plans sont des œuvres d’excellente facture semblable à celui qui va nous être présenté aujourd’hui, nous pouvons être certains que l’impact sera bénéfique pour notre société et pour notre économie.
Je me réjouis qu’une telle initiative ait été prise par la BRH, car la lourde responsabilité qui m’incombe d’assurer le bon fonctionnement de nos administrations, fait de leur renforcement une des objectifs du gouvernement. Pendant la période intérimaire, nous voulons faire œuvre qui vaille, en initiant des pratiques nouvelles, en traçant des sillons qui nous l’espérons seront suivis et améliorer par les prochains élus qui auront à diriger le pays dans les années à venir. Les valeurs et missions des institutions constituant l’administration publique, trouvent tout leur sens autour d’un rôle fondamental, à savoir celui de fournir des services adéquats à la population. Je le répète souvent l’État a des obligations en vers les citoyennes et les citoyens. Il doit les assumer et faire l’impossible pour satisfaire de façon cohérente les attentes de nos compatriotes.
On dit que l’exemple doit venir d’en haut. En fait, bâtir une administration publique qui remplit pleinement sa mission de fournisseur de services, constitue un pas déterminant vers la refondation de notre nation. Si nous parvenons à introduire durablement des bonnes pratiques d’une administration publique renforcée et performante, cela devrait impacter positivement d’autres sphères de la vie nationale.
De manière pragmatique, la mise en place d’une gouvernance efficace au sein de l’administration publique, passe d’abord par un processus de remise en question constante et sans complaisance de nos pratiques. Si nous voulons que les choses changent dans notre pays, nous devons analyser la situation actuelle et planifier les stratégies qui rendront possible les changements que nous souhaitons. Aujourd’hui, la BRH donne le ton en présentant en grande pompe son Plan Stratégique Global, fruit d’un processus de débats productifs et de réflexions concertées. Cette démarche doit service d’exemple pour tous les segments de l’administration publique haïtienne qui doit être guidée par un souci d’efficacité, de modernité, d’honnêteté et par une volonté de rendre des comptes.
Mesdames, Messieurs,
C’est une bonne chose que la Banque Centrale se mette au diapason d’un contexte international marqué par de profondes mutations. Nous sommes aujourd’hui à l’ère du numérique et de l’intelligence artificielle, et on parle avec raison de révolution numérique. Ces avancées technologiques ne seront pas sans conséquence sur le mode d’organisation de notre société, et vont impacter la performance de l’économie. Le rapport des sociétés avec la monnaie change ; les institutions n’ont d’autre alternative que de s’adapter ou de disparaitre. Si l’on porte un regard sur ce qui se passe chez nous, on se rend également compte que nous ne faisons pas exception à cette règle de changements qui frappent le monde, même s’il faut admettre que les jeunes sont les principaux moteurs et véhicules de ces transformations.
Dans ce contexte d’évolution constante qui s’opère à un rythme effréné, les défis se multiplient, rendant la tâche des institutions encore plus difficile. D’où la nécessité, pour une institution comme la BRH, de s’adapter à l’environnement qui se renouvelle, et pourquoi pas se positionner en avant-garde. Des actions doivent être initiées dans cette perspective ; et quoi de plus fondamental que d’inscrire ces actions dans la logique stratégique d’un cadre clairement défini, en vue de l’atteinte d’objectifs précis ? D’où l’importance de ce Plan Stratégique Global. En ce qui concerne son contenu, mes discussions avec les autorités monétaires m’ont révélé – et l’intervention du Gouverneur vient de le confirmer – qu’à travers ce plan stratégique, la BRH a circonscrit ses actions dans un ensemble logique de domaines d’intervention, pour lesquels une série de tâches sont planifiées, en vue d’atteindre des résultats précis, et le tout
.
Dès lors, la BRH devra compter sur son capital humain, ainsi que sur le concours d’autres institutions faisant partie de tout l’écosystème national pour réussir son pari. Rappelons que sans des institutions fortes, les solutions à nos différents problèmes de société peineront à se matérialiser. Consciente de l’ampleur des difficultés d’aujourd’hui et de leurs implications pour les générations futures, je veux au nom du gouvernement lancer un appel pour une mise en commun de nos talents afin d’œuvrer ensemble à l’amélioration de conditions de vie de millions de nos compatriotes.
Comme le dit un proverbe oriental : « Les temps difficiles produisent les hommes forts, les hommes forts engendrent les temps de prospérité et de stabilité ». En ces temps difficiles, monttons-nous à la hauteur de la tâche qui nous incombe de redresser la barre. Il s’agit là d’un appel à toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens d’ici et d’ailleurs désireux d’apporter leurs pierres à la construction d’un État haïtien stable et prospère.
Mesdames, Messieurs
Je ne veux pas terminer mon propos sans rappeler à tous et à chacun que la Covid-19 est toujours présente et continue à faire des victimes dans notre pays et dans le monde. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières.
A la veille de la nouvelle année, je formule pour vous, pour vos proches et surtout pour notre pays des vœux de Paix, de Sécurité, de Stabilité et de Fraternité. Puisse l’année 2022 être bien meilleure que celle qui se termine et constituer le point de départ de la reconstruction de nos institutions démocratiques et de normalisation de la vie en société. C’est notre devoir à tous d’y contribuer dans nos sphères d’activité et d’influence. Cette année sera ce que nous aurons planifié qu’elle soit.
Je vous remercie.
Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre
Honorable President du Senat,
Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement
Honorables Sénateurs de la République
Messieurs les Représentants du Pouvoir Judiciaire
Monsieur les Secrétaires Généraux de la Présidence, de la Primature et du Conseil des Ministres
Monsieur le Directeur de Cabinet du Premier Ministre
Madame, Monsieur les Membres du Conseil d’Administration de la BRH,
Mesdames Messieurs les Membres du Corps diplomatique
Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de l’Administration Publique
Mesdames Messieurs les Membres du secteur des Affaires,
Mesdames Messieur de la Presse ecrite, parlee, televisee et en ligne..
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
La Banque de la République d’Haïti est très heureuse de vous accueillir ce matin et elle tient à vous adresser ses sincères remerciements d’avoir répondu à cette importante invitation, celle de la présentation d’un travail inédit à la Banque centrale, à savoir le Plan Stratégique Global 2021-2024.
Qu’il me soit permis de remercier de façon particulière, au nom du Conseil d’Administration de la BRH et en mon nom propre, le Premier Ministre, Son Excellence Monsieur Ariel Henry qui nous a honorés de sa présence, tout en exprimant une marque d’intérêt à l’événement du jour.
En effet, après plusieurs années de réflexions, de discussions et de multiples efforts à la Banque centrale, le Conseil d’Administration se réjouit ce matin d’exposer, à ses partenaires immédiats et aux parties prenantes, une œuvre sans précédent dans laquelle nous avons chacun un intérêt, car la politique monétaire est l’une des grandes composantes de la politique économique du pays, laquelle influence nos actions de tous les jours en fonction du cadre macroéconomique.
Lancé en mars 2016, à l’orée de la célébration des quarante ans d’existence de la Banque de la République d’Haïti (17 août 2017), ce Plan Stratégique Global (PSG) de la BRH est le fruit d’un long processus de travail et de brainstorming sur les nouvelles orientations à prodiguer à la Banque centrale, pour la période 2021-2024, en vue de permettre à l’institution non seulement de renforcer sa proactivité dans ses efforts visant à atteindre la stabilisation macroéconomique, mais aussi de définir les moyens stratégiques vers une meilleure harmonisation entre la politique monétaire et la politique budgétaire.
Ces nouvelles orientations sont manifestées à travers un ensemble de domaines clés, d’objectifs ciblés, de résultats attendus et d’activités à réaliser, et, de plus, elles s’inscrivent dans une démarche de ‘’forward looking’’, c’est-à-dire de regarder les actions de la BRH à l’avenir, dans un environnement de mutations et de crises, tant à l’échelle nationale qu’internationale.
Je dois souligner que, conformément à l’Agenda de l’activité, quelques hauts cadres de la Banque, membres de l’équipe travaillant sur la Planification Stratégique de la BRH, vont vous présenter respectivement les domaines qui ont été retenus par le Conseil d’Administration.
Mesdames Messieurs,
La présentation du Plan Stratégique Global 2024 qui nous réunit ce matin s’est articulée autour d’une vision ambitieuse, formulée par le Conseil d’Administration, à savoir : une banque centrale moderne et efficiente, assumant son rôle dans la stabilité des prix et le développement du système financier, déterminée à encourager la croissance des secteurs réels de l’économie dans l’optique d’une Haïti centrée sur l’inclusion, surtout financière.
Cette vision se fonde non seulement sur l’esprit de la loi du 17 août 1979 créant la Banque centrale et lui conférant une mission fondamentale, mais aussi, elle se base sur un agenda auquel le Conseil d’Administration attache beaucoup d’importance, à savoir l’Agenda monétaire pour la croissance et l’emploi.
En parlant de mission de la BRH, il est tout aussi crucial pour moi de souligner que la modernité et l’efficience, que charrie notre vision pour la banque centrale, sont en parfaite harmonie avec la mission fondamentale de l’institution que lui confère la loi et qui se matérialise à travers quatre fonctions principales, à savoir :
- Défendre la valeur interne et externe de notre monnaie, en conduisant une politique monétaire basée sur la stabilité des prix ;
- Assurer l’efficacité, le développement et l’intégrité du système de paiements, en négociant avec les partenaires immédiats et en mettant à profit les progrès technologiques ;
- Assurer la stabilité du système financier, en supervisant le fonctionnement des banques et en les soumettant à des normes prudentielles ;
- Agir comme banquier, caissier et agent fiscal de l’Etat, en tenant le compte courant de toutes les institutions et collectivités publiques.
Mesdames Messieurs,
Distingués invités,
Ce travail que nous vous présentons ce matin indique le cheminement envisagé à la BRH pour la période 2021-2024, dans un esprit de franche collaboration avec les partenaires publics et privés, tant au sein du pays qu’à l’échelle internationale.
C’est dans cet ordre d’idées, qu’il existe un autre élément d’ancrage, aux principes codifiés dans ce Plan Stratégique, qui amène la BRH à vous rencontrer ce matin. Il s’agit d’un ensemble de valeurs, telles que, la Collaboration stratégique, la Communication et la Transparence, en ce qui concerne directement nos partenaires et parties prenantes externes.
Ces principes institutionnels que nous nous donnons à la BRH devront non seulement faciliter une meilleure collaboration avec les acteurs externes, dans cette perspective de stabilisation macroéconomique et de renforcement de l’inclusion financière, mais aussi contribuer à la réussite du Plan Stratégique Global 2024.
Mesdames, Messieurs, chers partenaires,
Dans cette démarche d’une banque centrale moderne et efficiente, la BRH a déjà mis sur pied beaucoup de projets et programmes et elle a entrepris aussi un ensemble d’actions qui viendront en appui à la mise en œuvre et la réussite du Plan Stratégique. Je pourrais citer, entre autres :
- Les programmes incitatifs aux secteurs productifs, comme l’hôtellerie, l’immobilier dont un nouveau programme 10-10-20 qui sera publié cette semaine ou au plus tard la semaine, les zones franches et les exportations;
- La circulaire 113 en faveur du secteur agricole;
- Des circulaires visant à réduire des imperfections sur le marché des changes;
- Le Processeur National de Paiement (PRONAP) pour assurer l’interopérabilité entre les différents moyens de paiement et les différents acteurs financiers ; processeur qui sera mis a jour pour accommoder les paiements mobiles des Fintechs à travers des API, ACH et le CSD
- La Gourde digitale pour une amélioration de l’inclusion financière et une meilleure circulation de la monnaie dans l’économie;
- La Circulaire #121 pour le développement du secteur Fintech, notamment les entreprises opérant dans les services de paiement électronique;
- Et, le Fonds BRH pour la Recherche et le Développement pour susciter la recherche scientifique dans les démarches de résolution des problèmes publics.
- Le Marche Financier..
- Pour ne citer que ceux-la..
Je ne terminerai pas mes propos sans souligner que tous les domaines retenus du Plan Stratégique Global 2024 de la BRH, revêt une importance capitale pour le Conseil d’Administration et pour l’économie en général qui a toujours bénéficié des retombées positives du cadre de la conduite de la politique monétaire.
C’est dans cette optique que je profite de cette occasion ce matin pour renouveler notre foi dans la coopération avec tous nos partenaires immédiats dont leurs actions dans l’environnement externe pourraient influencer la mise en œuvre de cet outil qui deviendra la boussole de la Banque centrale, dans sa quête de résilience face aux différents chocs internes et externes, pour les 3 prochaines années.
Le Conseil d’Administration reste donc convaincu que nous sommes sur la bonne voie et il s’est déjà résolument investi dans ce cheminement positif, en institutionnalisant le Plan Stratégique, avec à l’esprit le souci de la continuité des actions positives héritées de nos prédécesseurs et un sens aigu de l’exigence de fertiliser la culture de l’intérêt commun qui a marqué le parcours des 42 ans d’existence de la Banque de la République d’Haïti.
Je vous remercie.
Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence
Madame, Monsieur les Membres du Conseil d’Administration de la BRH, Mesdames Messieurs les Membres du Corps diplomatique
Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de l’Administration Publique Mesdames Messieurs les Membres du secteur des Affaires,
Mesdames Messieurs les Membres de la presse,
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi d’abord de remercier la Banque de la République d’Haïti de cette invitation qui nous été faite, en vue de prendre part à cette activité qui revêt d’une grande importance pour le Ministère de l’Economie et des Finances, à savoir la présentation du Plan Stratégique Global 2021-2024 de la Banque centrale.
Qu’il me soit permis aussi de féliciter toute l’équipe de la BRH qui a mis à profit leur compétence pendant environ 5 années, sous le leadership global du Gouverneur et du Gouverneur-Adjoint, en vue de doter la banque centrale d’un Plan Stratégique sur trois ans, qui comprend un ensemble de domaines d’importance comme la politique monétaire et l’inclusion financière, deux domaines clés pour lesquels le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) manifeste un intérêt particulier.
Il n’est pas sans savoir que le MEF est le partenaire immédiat de la BRH dans le cadre de la conduite de la politique monétaire. Aussi, est-il important pour moi de rappeler que l’efficacité et le choix des décisions de politique monétaire dépendent bien souvent de la posture de la politique budgétaire menée par le Gouvernement à travers le Ministère de l’Economie et des Finances. De plus, l’harmonisation de ces deux politiques, à savoir la politique monétaire et la politique budgétaire, constitue un élément fondamental dans cette quête de stabilité macroéconomique, nécessaire à l’attraction des investissements et à la création d’emplois.
C’est dans cette optique que le Ministère de l’Economie et des Finances se réjouit de pouvoir prendre connaissance des nouvelles orientations que la banque centrale veut se donner pour les trois prochaines années, en vue de continuer à remplir sa mission que lui confère la loi du 17 aout 1979 et dans la lignée de cette perspective de modernisation de l’Administration Publique que prône le Premier Ministre.
Il ne fait aucun doute que le MEF continuera à travailler en étroite collaboration avec la BRH en vue de préserver le peu de progrès enregistré dans l’environnement macroéconomique et de favoriser d’autres avancées qui permettraient de créer un climat propice à la stabilité des prix.
Mesdames, Messieurs
Pour ce qui concerne le domaine 1 du Plan Stratégique de la BRH, à savoir ‘’ Mission statutaire et Politique Monétaire’’, le MEF croit effectivement que la croissanceéconomique doit être stimulée et soutenue par la mise en place de conditions optimales dans le domaine du crédit et des changes en utilisant les instruments de politique monétaire et les programmes dont dispose la BRH, avec la participation du Ministère de l’Economie et des Finances dans la préservation de la valeur interne et externe de la monnaie nationale.
Dans ce même domaine (domaine 1) du Plan Stratégique, le MEF se réjouit de voir que l’un des résultats attendus concerne l’efficacité dans le traitement des opérations financières de l’État à travers :
- La mise en place d’un système d’encaisse électronique en vue de faciliter le paiement des redevances fiscales et douanières
- La sensibilisation des acteurs concernés à l’utilisation du système d’encaisse électronique
- La mise en place d’un système permettant d’accéder aux données relatives aux opérations fiscales et douanières des organismes de perception, en l’occurrence la Direction Générale des Impôts (DGI) et l’Administration Générale des Douanes (AGD)
- La sensibilisation des institutions étatiques à l’utilisation des paiements numériques
- Et le renforcement du suivi de la dette publique (interne et externe)
Vous conviendrez avec moi que le Ministère de l’Economie et des Finances manifeste un grand intérêt à la réalisation de l’ensemble de ces activités qui s’inscrivent dans une dynamique, non seulement de modernisation des opérations fiscales de l’Etat, mais aussi de recherche d’efficacité dans la gestion des finances publiques.
Le MEF se dit donc prêt à œuvrer dans toutes les démarches et initiatives visant à améliorer ou appuyer la conduite de la politique fiscale du Gouvernement dans une perspective de parvenir à réduire l’écart entre les dépenses et les recettes fiscales, une condition nécessaire
- la réduction du rythme du financement monétaire au profit d’un meilleur cadre macroéconomique.
Pour ce qui concerne le domaine 6 du Plan Stratégique de la BRH, à savoir ‘’ Inclusion financière’’, je dois souligner que le Ministère de l’Economie et des Finances fait partiedu Comité de Coordination et de Suivi de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière et a été un acteur clé dans le lancement du Plan National d’Education Financière (PNEF) en 2020, aux côtés des partenaires tels que le Ministère de l’Education National et de la Formation Professionnelle et la Banque de la République d’Haïti.
Il demeure entendu que l’implication active du MEF dans la mise en œuvre de du PNEF s’inscrit dans une démarche visant à inciter les agents économiques et la population en général à adopter de meilleurs comportements financiers en matière de budgétisation, de planification financière de manière à bien profiter des opportunités économiques et contribuer ainsi à la croissance économique.
C’est dans ce contexte que le MEF se joint au 6e domaine du Plan Stratégique de la BRH et s’associera à toutes les activités liées à la mise en œuvre du Plan National d’Education Financière (PNEF), ceci dans une démarche de renforcement des compétences des populations à faibles revenus afin de les aider à faire des choix financiers plus judicieux et devenir plus résilientes financièrement.
Mesdames, Messieurs,
Je ne terminerai pas mes propos sans réitérer cette cohérence qui doit exister entre les politiques des deux institutions (MEF/BRH) et la volonté du Ministère que je dirige de travailler en étroite collaboration avec la BRH en vue de trouver les meilleures formules de participation active du Ministère à la mise en œuvre du Plan Stratégique, notamment dans les domaines qui le concernent, comme la Politique monétaire et l’Inclusion financière.
Je veux aussi profiter de cette occasion pour renouveler la volonté et l’engagement du Ministère de l’Économie et des Finances à œuvrer pour un cadre macroéconomique stable et résilient, découlant d’une meilleure harmonisation entre la politique monétaire et la politique budgétaire, ce qui viendra en appui aux prochains plans d’actions du Gouvernement pour un apaisement social et une meilleure gouvernance économique.
Je vous remercie.
Monsieur le Premier Ministre
Mesdames, Messieurs les Ministres
Mesdames, Messieurs les Parlementaires
Mesdames, Messieurs du Corps Diplomatiques
Mesdames, Messieurs Représentants des institutions financières
Mesdames, Messieurs Partenaires internationaux
Monsieur le Gouverneur
Monsieur le Directeur Général
Madame, Monsieur les Membres du Conseil d’Administration de la BRH
Mesdames, Messieurs, Directeurs et Cadres actifs de la BRH
Mesdames, Messieurs de la presse parlée et écrite
Mesdames et Messieurs,
Au terme de l’année 2021 marquée par des troubles socio-politiques sans précédent, une insécurité caractérisée par le kidnapping, une violence extrême entretenue par des gangs armés et une crise sanitaire persistante, en un mot, un climat délétère entrainant son cortège de deuil, de chagrin, de décapitalisation des familles, de désespoir des jeunes, il n’est pas sans intérêt que certaines initiatives soient porteuses d’optimisme envisageant un futur meilleur sur le plan institutionnel.
Le Plan Stratégique Global 2024 que le Conseil d’Administration a décidé de doter la Banque Centrale s’inscrit dans cette démarche et vise à permettre à l’institution de traduire dans le réel, au terme des 3 ans, la vision du Conseil d’Administration formulée en ces termes « Une Banque Centrale Moderne et efficiente, assurant pleinement son rôle dans le maintien de la stabilité des prix et le développement du système financier et , déterminée à encourager la croissance des secteurs réels de l’économie dans l’optique d’une Haiti centrée sur l’inclusion, surtout financière.»
Cette vision souscrit parfaitement à la pensée du père de la Planification stratégique, Michaël Porter de Harvard Business School qui nous dit en des termes simples que « la planification stratégique vise à engager une institution durablement dans le futur ».
La BRH a fait sienne ce concept, étant pleinement consciente que ne pas programmer c’est aussi programmer et les résultats diffèrent d’un choix à l’autre.
C’est en vertu de cette évidence que le Conseil d’Administration, au regard des enjeux et défis, a décidé d’élaborer et de mettre en œuvre ce PSG en vue de doter l’institution des capacités de résilience lui permettant de remplir sa mission définie dans la loi du 17 août 1979 et de concrétiser au terme des trois ans la vision conçue par l’actuel Conseil. C’est un instrument déterminant dans les destinées de l’Institution.
La réalisation de ce plan est la résultante d’un ensemble de réflexions endogènes produites par des compétences spécialisées de la BRH. Cette initiative remonte à l’année 2016. Sa gestation a débuté par un diagnostic qui a permis d’identifier les capacités endogènes de l’institution, entendez par là les ressources et les compétences disponibles au temps (t) au regard des perspectives envisagées par le Conseil.
Dans un tel contexte, le PSG à travers ses instruments stratégiques se devait de servir de fer de lance à la Banque Centrale dans l’exercice optimal de ses attributions statutaires et la réalisation opportune des mandats découlant de la vision du Conseil.
Le diagnostic a exploré les ressources de tous ordres dont dispose la BRH, les procédures en vigueur, la collaboration entre les entités de la Banque et le partenariat avec des Institutions externes.
Fort du constat, la BRH a compris que, parmi les méthodologies en vigueur en la matière, la matrice du cadre logique, décomposant les domaines en objectifs, résultats et activités, répondait mieux aux réalités de l’Institution.
6 domaines ont été retenus couvrant les différents champs d’intervention de la BRH :
- Mission statutaire et politique monétaire
- Organisation institutionnelle, ressources humaines, études techniques et scientifiques
- Infrastructure physique, systèmes d’information et capacités technologiques
- Ressources financières
- Responsabilité sociale
- Inclusion financière
Point n’est besoin de m’attarder sur les implications découlant du libellé respectif de ces domaines. Des cadres de la banque se succèderont sous peu sur ce podium pour vous entretenir sur ces différents thèmes.
Ce plan décrit la voie dans laquelle la BRH compte s’engager pour être cette nouvelle institution à la célébration de son 45ième anniversaire dans trois ans, soit en aout 2024. Il indique le cheminement envisagé pour la période 2021-2024, le rôle attribué à chaque centre de responsabilité au sein de l’Institution et le mode de collaboration avec ses partenaires publics et privés tant au sein du pays qu’à l’échelle internationale.
Mesdames, Messieurs,
L’expérience des chocs de tous ordres (économiques, socio-politiques, sanitaires ou physiques,) nous apprend que les prévisions sont assez souvent en butte aux mouvances de l’environnement. Ainsi le succès ou l’échec du PSG peut dépendre du cours des évènements. Cependant, tout en étant bien conscient de cette éventualité, notre rendez-vous avec le succès nous détermine à prévoir des scenarios en conséquence. Notre conviction en la viabilité du dit plan et notre optimisme manifeste nous portent à conclure que cette œuvre de la BRH est à la fois un exemple et un modèle. Un exemple d’une volonté de conduire l’institution vers des lendemains meilleurs par des choix rationnels tout en la préparant à faire face aux mutations de l’environnement. Un modèle offert aux autres institutions de l’Etat et du privé, conscients que la pleine maitrise de la conduite de la barque est indispensable à l’atteinte de résultats concluants et satisfaisants, ce pour de meilleurs services à la communauté et l’amélioration du standard de vie du citoyen.
Et, si jamais, il en devait être autrement pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous resterons sereins à l’idée que parfois pour mériter de l’estime de la patrie, il n’est pas indispensable d’avoir fait de grandes choses, il suffit de les avoir tentées.
Mesdames, Messieurs,
L’accouchement du Plan Stratégique Global 2024 (PSG-2024) pour la Banque de la République d’Haïti (BRH) est l’aboutissement d’un cheminement long de quatre (4) années de cogitation où des idées contraires se sont affrontées pour donner forme à un ensemble d’instruments stratégiques devant guider nos choix et actions dans le cadre de la conduite de notre mission de banque centrale. Des rencontres ont eu lieu, des échanges ont alimenté les débats, des décisions ont été prises ; le tout a porté fruit, en témoigne notre présence aujourd’hui en ces lieux pour vous présenter cet outil de travail. Au nom du Conseil d’administration de la Banque de la République d’Haïti, je veux prendre le temps de saluer le sens de leadership, du dévouement et de don de soi qu’ont manifesté tous ceux et toutes celles qui ont travaillé sur ce document alors que le contexte socio-politico-économique paraissait ne laisser pourtant guère de place à ce genre de travail. Encore une fois, merci. Votre contribution est inestimable, et la République toute entière peut en être fière. Je veux aussi prendre le temps pour remercier le Premier Ministre, les Ministres du Gouvernement, les Parlementaires, le Corps diplomatique, les représentants des institutions financières, la presse parlée et écrite, vous tous, et vous toutes distingués invités qui avez répondu à notre invitation d’aujourd’hui. Je ne saurais terminer sans profiter de l’occasion pour vous souhaiter mes vœux les plus chers pour l’année 2022 qui s’annonce. Tous mes meilleurs vœux chers compatriotes ; je vous souhaite une bonne dose de pensées positives pleines de bonnes promesses pour des actions positives pour le bénéfice de millions de nos compatriotes.
Merci
Allocution de Madame Myrtho René, Membre du Conseil d’Administration de la BRH, à l’occasion du lancement du Forum des Femmes Rurales
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural
Chers Collègues Membres du Conseil de la Banque de la Republique d’Haiti
Monsieur l’ex Ministre de l’Education Nationale, Professeur Nesmy Manigat
Mesdames les Représentantes du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes
Madame la Représentante de l’ONU-FEMMES en Haïti
Mesdames et Messieurs Représentants de l’AFI
Mesdames et Messieurs Représentants du Ministère des Affaires Sociales,
Mesdames et Messieurs Représentants de la CNSA
Mesdames, Messsieurs des Institutions Bancaires et Financières
Chers Collaborateurs de la BRH
Mesdames et Messieurs, Membres de la Presse parlée, écrite, télévisée et en ligne,
Potorik fanm nan Nò, Medam Okap yo, Madan Sara yo ki se boulon sant fanmi yo
Distingués Invités en vos rangs, titres et qualités,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec infiniment de joie et d’entousiasme qu’au nom du Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haiti, je me retrouve dans cette belle cité Christophienne, afin de prendre une part active au Forum des Femmes Rurales, résultant d’une collaboration entre le Ministère de l’Economie et des Finances, la Banque de la République d’Haiti et le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, associés à d’autres instances nationales et internationales.
Souffrez que d’abord, je félicite toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Cette demarche, dont le but principal est l’intégration de tous, aux chaînes de valeurs mondiales, est louable et la priorité accordée aujourd’hui aux femmes est d’autant plus importante que le monde est engagé dans une époque de bouleversemenents dont les effets se font sentir dans toutes les sphères de l’activité humaine.
Les enjeux sont multiples et le devenir des peuples en dépend. Des valeurs telles que la démocratie, l’affirmation des droits de la personne et la justice sociale sont les fondements de l’évolution et du progrès des collectivités. La restructuration économique est donc nécessaire car elle tend a réduire les disparités sociales.
A l’instar des autres nations, Haïti est en mutation. L’évolution de la situation des femmes y est étroitement liée. Plus que jamais, nos femmes haïtiennes désirent et, elles doivent participer, plus activement, aux décisions et orientations qui modèlent l’avenir de cette nation.
Si les femmes avaient droit aux mêmes opportunités que les hommes, elles réaliseraient des prodiges. Lorsque leurs droits sont lésés, nous privons leurs enfants, et la société toute entière, d’un avenir meilleur. Malgré leur marginalisation, les femmes, et à plus forte raison, les femmes Rurales, sont créatrices et actrices incontournables, dans tous les secteurs. On les retrouve dans les secteurs formel et informel des affaires, dans la gestion de la chose publique, dans les activités religieuses et j’en passe.
L’inégalite des genres, l’accès limité au crédit, aux soins de santé, constituent autant de défis pour les femmes, et autant de freins à l’évolution des sociétés. La pandemie et les nombreuses crises qu’elle provoque ne font qu’aggraver la Condition Féminine dans le monde.
Il est grand temps que soient abolis les mécanismes de subordination qui, dans un système sexiste et patriarcal, entravent le processus de la participation des femmes dans l’évolution de la société.
De meilleures pratiques, en conformité avec la réalite du milieu, devront etre adoptées, de manière à inciter des activités génératrices de revenus pour les femmes.
De manière plus générale, “la Banque de la République d’Haïti propose des incitations financières, tant à travers son programme pro-croissance, qu’à travers la circulaire 113, au secteur financier, ciblant particulièrement les différents agents
économiques des filières productives, tous acteurs du monde rurale, confondus.
En tant que gardiennes de valeurs et des traditions, rôles qu’ elles assument d’ailleurs avec grâce, malgré les embûches, les femmes doivent avoir accès à l’éducation, en général, et à l’éducation financière en particulier, voies royales pour sortir des schémas traditionnels intégrés afin de faire face à la mondialisation.
Map salye fanm kap viv nan zòn riral yo
Fanm madan sara ,fanm djanm kap pote sosyete a sou do yo
Fanm ki pa pè goumen ak lavi
Fanm ki se souf ak nanm kay yo
Fanm ki gen fanm nan fanm yo
Mwen di nou Onè, Respè
Onè , Respè ak tout fanm peyi Dayiti
Kit isit , kit lòt bò dlo
Depi ayè, sa nou wè kap pase nan Hostellerie Roi Christophe la , se yon repons ak anpil kesyon ke nou te genyen
Se limyè ki komanse klere sou chimen nou
Se ledikasyon ak bon jan ankadreman ak konsèy ki pral tabli pou nou bay lavi nou yon pi bon direksyon.
Bank Repiblik Dayiti (BRH) ansanm ak Ministè Finans ak Ministè Edikasyon Nasyonal kole zepòl pou yo pote bon jan nouvèl pou nou .
Pou yo montre nou kijan pou nou jere vi nou, kòb nou epi bay bay biznis nou jarèt.
Bagay yo pa fasil se vre
Jounen yè a , nou te rive idantifye kèk pwoblèm ki ka rezoud si tout met tèt nou ansanm pou nou vanse pi byen.
Difikilte yo fè fas kare ak nou lajounen kou lannwit men nou pa panike se atò nap goumen.
Men fwa sa, batay nap mennen an app jwenn ranfò paske Plan Nasyonal Edikasyon Finansyè a rive sou nou.
Depi ayè anpil deba ap fèt , fristrasyon ap tonbe, pwopozisyon ap lage tribò babò, bagay yo ap bouyi men nan bon ti mamit.
Lè m ap gade bèl espektak sa, mwen wè pitit menm tè, pitit menm nasyon ki pote kole pou chanje lavi frè ak sè yo.
Mwen wè Ministè Finans, Ministè Ledikasyon, Bank Santral (BRH) ak kèk lòt enstitisyon nasyonal ak entènasyonal kap travay pou plis kòb rete nan men nou paske nou pral aprann kijan pou nou jere tèt nou .
Nou pral aprann enpòtans mete kòb sou kanè epay nou pou lè gen kouri nan fanmi nou, nou pa oblije al pran ponya nan lari , ni al vann tèt nou pou nou jwenn yon ti kòb.
BRH gen de pwogram , pwodwi ak sèvis ki la , ki disponib , pou ede nou , pou fè biznis nou grandi.
Nou pral aprann nou menm ak pitit nou kisa ki antreprenarya pou nou ka jere tèt nou pi byen.
Premye antrepriz la se fwaye nou, se lakay nou. Se ladan l ke nap jere : manje, bwè , dòmi. Nap jere ledikasyon sou tout fòm li. Nap jere lekòl pwofesyonèl, Kijan nou pral bay pitit nou bon jan ledikasyon pou l sa okipe tèt li demen. Nap jere tou ki jan , ki kantite valè moral nou pral bay piti nou anvan nou lage yo nan lavi a. Sa mande tan , sa mande lajan.
Kidonk, nou pral aprann fè tout sa. Kounye a , lè nou komanse konprann tout sa m sot di yo, zafè kite timoun nan kay poukont yo pral fini. Paske kounye a nou pral aprann fè bidjè nou . Nap mete yon kòb sou kote pou nou kite yon moun nan kay la ak timoun yo lè n al chèche lavi. Zafè lajan paka ret nan men nou pral fini paske nou pral aprann ke biznis w genyen an, kòb ki ladan l lan pa pou ou, tout kòb la pa pou ou. Gen yon pati nan benefis ke w fè ke w pral reinvesti nan biznis ou. Nou pral aprann ou kijan pou n fè sa.
Kounye a la , lè bagay sa yo komanse fèt, lè afè n komanse bon, m ta renmen konnen ki gason ki ka gade nou pou ýo vin leve men sou nou paske depi lè yo gade fanm djanm, fanm solid ke n pral devni a lap wè ke nou ka okipe tèt nou poukont nou., nou ka okipe pitit nou. Nap jwenn respè. Na banm nouvèl. Map profite de espas sa , pou m di mèsi ak tout gason konsekan kap kore fanm e ki ankouraje yo al pi wo. Sa demontre ke yo soti nan yon fanmi ki te ankadre yo, ki te ba yo ba yo bon jan leson pou vini bon sitwayen , bon papa pou pitit yo, bon mari pou madanm yo, , bon pitit Bondye e sa mete anpil valè nan sosyete a. Onè respè pou nou Mesye yo.
L’Education est un facteur de développement économique et un chemin d’épanouissement pour tout être humain. Le progrès d’une nation est proportionnel à l’effort durable consentis par les Gouvernants, en faveur de l’éducation. Une femme instruite, éduquée, renseignée, tout en retrouvant sa dignité humaine, se sent capable d’améliorer ses conditions d’existence et celles de sa famille et de contribuer, plus efficacement à la construction de son pays.
Le développement durable et la réduction de la pauvreté ne pourront se réaliser sans l’élimination des inégalites. Ce changement, basé sur les principes de droits, sonnera le glas des pratiques anciennes qui, pendant trop longtemps, ont enclavé l’émancipation économique des nos femmes rurales entrepreneures.
Je terminerai mon mot en vous souhaitant une bonne participation à la seconde journée du Forum des Femmes, forum au cours duquel le public sera informé, entre autres, de manière concrète, des options offertes par la Banque de la République d’Haïti pour faciliter les transactions financières, quelles qu’elles soient, ainsi que les programmes et produits disponibles à cette Banque pour soutenir les activites Rurales.
Ces échanges fructueux, visant la Promotion de l’Education et de l’Inclusion des Femmes dans les secteurs économique et financier, à travers le PLAN NATIONAL D’EDUCATION FINANCIERE(PNEF), nous permettront de co-créer un avenir meilleur, sur les fondements d’une devise, cette fois-ci, éprouvée: “ LE PLUS GRAND BIEN AU PLUS GRAND NOMBRE’.
Je vous remercie.
Myrtho René
Membre du Conseil d’Administration de la BRH
Cap-Haïtien, le 20 mai 2021
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances,
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Madame la Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme,
Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Ressources Naturelles et du Développement Rural,
Chers collègues du Conseil d’Administration de la BRH
Monsieur le Représentant de l’Alliance pour l’Inclusion Financière
Madame la Représentante de l’Onu Femmes en Haïti,
Mesdames, Messieurs les Membres de la Commission de Coordination de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière
Mesdames, Messieurs les membres du secteur privé des affaires et de la société civile,
Femmes évoluant dans tous les secteurs d’activité confondus en Haïti et dans la diaspora.
Mesdames les exposants
Chers participants qui nous suivent en ligne et en présentiel ;
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes arrivés au terme de ce forum, dédié aux femmes, qui s’est déroulé ces deux derniers jours dans la cité Christophienne, autour du thème : « Education et Autonomisation Financières : Renforcer la Résilience des Femmes Rurales. »
Ce thème revêt d’une importance capitale car sans l’éducation financière nous ne saurions atteindre l’autonomisation financière et sans l’autonomisation financière il sera impossible d’arriver à l’Egalite de genre.
Map di tout fanm nan tout kouch nan sosyete Ayisyèn-a si nou vle rive konkretize rèv nou tout bon, pa gen wout pa bwa ; bon wout la se edikasyon et sitou edikasyon finansyè. Se youn nan mesaj kapital forum sa a te vle fè pase e nou panse objektif sa atenn.
Quelqu’un eut à dire « si vous pensez que l’éducation coute chère, essayez l’ignorance ».
Ce forum nous a permis de mettre en exergue, une fois de plus, le potentiel extraordinaire de nos femmes haïtiennes, en milieu rural comme en milieu urbain, et leur importance au sein de notre société. Les différents documentaires visualisés nous en disent long. Ce forum a également pointé du doigt les nombreuses contraintes auxquelles font face les femmes. Nous citons, entre autres :
Le manque d’encadrement
Les inégalités de genre dans la sphère économique ;
L’accès limité au financement et particulièrement au crédit ;
L’accès limité aux soins de santé ;
L’accès limité à l’éducation financière et tant d’autres barrières qui constituent des défis à l’émancipation des femmes.
Plusieurs études prouvent que les femmes sont des entrepreneures et des emprunteuses hors pair car les crédits qui leur sont octroyés sont le plus souvent remboursés. Cependant, il est fort de constater que le volume de crédit alloué aux hommes est plus élevé que celui des femmes. Cette réalité est liée au fait que les entreprises dirigées par les femmes sont souvent liées à des filières très peu valorisées. La question de formalisation de ces entreprises n’est pas à sous estimer non plus. Travailler à l’autonomisation des femmes c’est travailler à la valorisation des filières productives, à la formalisation des entreprises dirigées par les femmes et à l’amélioration de l’accès des femmes au crédit pour une plus grande stabilité du système financier combien nécessaire pour la santé de toute économie.
Forum sa-a te pèmèt nou abòde anpil bagay ki kontribye nan kreye pwoblèm sa yo ; li te pouse nou reflechi sou solisyon nou ta ka pote pou konstwi ak ranfose kapasite fanm yo pou yo ka pran plas yo merite nan kominote yo e pèmèt yo kapab rekanpe pi dyanm aprè sitiyasyon difisil ki konn frape yo.
Pandan 2 jou sa yo, nou te mete fanm yo devan, nou te pale ak yo e yo te pale sou pwoblem yo tou. Yon gwo kout chapo pou tout medam yo ki chak jou pwouve yo se poto mitan sosyete a !
Au nom du Comité de Coordination et de suivi de la Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière, nous réitérons notre engagement d’intégrer davantage de femmes entrepreneures dans le secteur financier formel. Afin, de contribuer à mieux adresser les problèmes identifiés, les résolutions clés suivantes ont été prises :
– Le comité de réalisation de ce forum vous promet que les propositions faites durant ces deux jours auront des suites. Pour ce faire, un taskforce sera créé pour le suivi des recommandations.
– La BRH, va organiser un concours en faveur des femmes entrepreneures, sous peu. Les quinze (15) meilleurs projets vont être sélectionnés, un encadrement technique de 6 mois leur sera offert. En vue de faciliter leur inclusion financière, une subvention leur sera offerte à travers une institution financière.
– Suite aux difficultés de financement mises en lumière par les différents panels, un fond de garantie en faveur des femmes entrepreneurs sera créé au sein du FDI où un mécanisme ciblant les entrepreneurs en général est déjà mis en place. Nous espérons pouvoir démarrer avec un portefeuille 10 millions de Dollars US. Nous sommes ouverts à des partenariats constructifs pour la réalisation de ce grand objectif.
– Sous l’égide du Comité de coordination et de suivi de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière, maintenir le débat autour du thème de l’autonomisation financière des femmes ;
– Continuer à sensibiliser les institutions étatiques et privées à mettre en place des points focaux dédiés à la question de genre ;
– Travailler à la promotion du Plan National d’Education pour les femmes.
La BRH, le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle remercient la participation de tous les intervenants pendant ces deux journées de discussions fructueuses.
Nous remercions les différents Ministères tels que le Ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, le Ministère du Commerce et de l’Industrie, le Ministère des Affaires Sociales et du Travail, le secteur financier, la société civile, les Organisations de femmes, les Firmes d’encadrement, nos partenaires internationaux AFI, ONU-Femme, l’USAID, la Coopération Suisse, le Gouvernement Canadien, MEDA, le Développement international Desjardins, WOCCU, le Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et du Crédit au Sénégal (PAMECAS) .
Merci d’avoir permis à vos cadres cadre de faire le déplacement malgré leurs obligations professionnelles pour venir enrichir les débats et supporter la réalisation de ce forum. Nous remercions l’ancien Ministre Manigat qui s’est mis disponible, pendant les deux jours, pour supporter cette initiative et agir en tant que modérateur. Un grand merci à nos panelistes de la société civile, du secteur financier et des ONG pour tous vos apports et la qualité de vos interventions.
Aussi, nos remerciements s’étendent à nos exposants, à toute l’équipe de planification et d’organisation et à l’équipe technique qui a permis la retransmission de ce forum en ligne. Nous ne terminerons pas sans remercier de façon spéciale tous ceux et toutes celles qui nous ont suivi pendant ces deux jours.
Ensemble luttons pour l’éducation financière et l’autonomisation des femmes
Ensemble luttons contre la féminisation de la pauvreté !
Ensemble, luttons contre la dépendance économique et financière des femmes !
Finanse Fanm Se Finanse estabilite finansyè, se finanse kwasans ak Devlopman ekonomik Peyi a !
Merci pour votre attention et bon retour au bercail à tout le monde !
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances,
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Madame la Ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme,
Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Ressources Naturelles et du Développement Rural,
Chers collègues du Conseil d’Administration de la BRH
Monsieur le Représentant de l’Alliance d’Inclusion Financière
Madame la Représentante de l’Onu Femmes en Haïti, Madame Dédé EKOUE
Mesdames, Messieurs les Membres de la Commission de Coordination de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière
Chers participants qui nous suivent en ligne et en présentiel,
Mesdames, Messieurs,
-
Au nom du Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haïti (BRH), je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce Forum des femmes, qui se déroule dans la cité Christophienne, autour du thème ‘’Education et Autonomisation Financières : Renforcer la Résilience des Femmes Rurales ‘’.
L’organisation de ce Forum à l’intention des Femmes intervient dans un double contexte :
• D’abord, toutes les études récentes sur les impacts de la pandémie, notamment celles du Fonds Monétaire International, montrent que les Femmes figurent parmi les catégories les plus affectées par la crise sanitaire de Covid-19, d’où la nécessité de renforcer leur résilience à travers, entre autres, une bonne autonomie financière ;
• Ensuite, ce Forum s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF), lancée en 2014 par la BRH sous le haut patronage de la Présidence de la République dans le but de faciliter l’accès à la population aux produits et services financiers.
La mise en œuvre de cette SNIF, qui nous réunit, encore une fois, ce matin, se réalise autour de cinq piliers, à savoir : des Services financiers pour faciliter l’inclusion et la réduction de la pauvreté ; du Crédit pour la croissance économique ; des Services financiers de proximité ; l’Education et la protection des consommateurs ; et le Renforcement des institutions et des infrastructures financières.
Selon une analyse des besoins aux services et produits financiers , des groupes de la population présentant des caractéristiques, qui devraient être considérés comme étant prioritaires, ont été identifiés de la manière suivante : Les jeunes, les micros petites et moyennes entreprises, les personnes vivant dans les endroits reculés, les personnes en situation précaire, les travailleurs migrants et leurs familles, les agriculteurs ; et parmi tous ces groupes cibles, nous retrouvons bien évidemment les femmes qui constitue un groupe cible transversal de la Stratégie et du Plan National d’Education Financière.
Chers participants,
Au niveau global, les données de la Banque Mondiale montrent que sur les 1.7 milliards de personnes qui n’ont pas accès aux services financiers, 1 milliard sont des femmes, ce qui représente 56% du total. Ces personnes habitent pratiquement toutes dans des pays en voie de développement et à faible revenu, dont Haïti, et nécessitent des programmes d’appui financiers et non financiers. C’est donc dans cette perspective que la BRH, en plus de son support au renforcement de l’infrastructure financière, a mis en œuvre des programmes spécifiques (programme pro-croissance) en vue de promouvoir certains secteurs productifs clés à forte valeur ajoutée et à fort potentiel, susceptibles d’avoir des retombées directes sur les activités économiques des femmes dont celles que nous tenons à mettre en évidence ce matin : Les activités économiques de nos « Madan Sara ».
Aussi, il convient de souligner qu’au-delà d’une aide économique, un cadre règlementaire peut aussi permettre aux femmes d’avoir une indépendance financière. Cela revient à dire que, changer les procédures, et parfois la loi, peut être nécessaire pour ouvrir l’accès à la finance aux femmes. Une très bonne raison pour ce faire car plusieurs études ont montré que les femmes sont des emprunteuses hors pair car les crédits qui leur sont octroyés sont le plus souvent remboursés à 90%. Plus important encore, accorder un prêt à une femme a tendance à avoir des impacts positifs, non seulement, sur ses conditions de vie, mais aussi impacter celle de toute sa famille. N’est-elle pas celle qui, dans bien de cas, nourrit la famille, paie les soins de santé, débourse pour l’écolage des enfants et doit épargner pour les jours durs ? Chapo ba medam !!!!!!!
Mesdames, Messieurs,
La contribution des femmes dans les différentes sphères d’activités du pays se retrouve souvent noyée dans les statistiques nationales. Pourtant, la collecte d’indicateurs désagrégés est importante pour cerner les problèmes d’inégalité de genre, de répartition de la richesse et pour sensibiliser les institutions sur leur engagement à jouer leur participation dans la résolution de ces problèmes.
Chez nous en Haïti, les statistiques révèlent que les femmes sont majoritaires, car 51% de la population âgée de 15 ans et plus sont des femmes. D’un autre côté, les données de l’enquête FinScope ont confirmé que 75 % de ces femmes vivent d’emplois précaires ; seulement 9% sont bancarisées, et environ 75% n’épargnent pas et n’investissent pas. Ces données, entre autres, laissent présager que l’exclusion financière des femmes constitue alors un des éléments contribuant à ce qu’on appelle la féminisation de la pauvreté en Haïti.
Mesdames, Messieurs,
L’atelier que nous ouvrons ce matin constitue un témoignage de l’engagement du Comité de Coordination et de suivi de la Stratégie Nationale de l’Inclusion Financière de nous aider à mieux cerner la problématique de l’exclusion des femmes entrepreneures. A travers ce Forum de 2 jours, on entend adresser non seulement les différentes contraintes, mais aussi faciliter la mise en évidence des opportunités liées à l’inclusion et l’autonomisation financières des Femmes en Haïti, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière mais surtout dans cette perspective de relance post-Covid.
Au cours de ce forum, il sera question de suggérer des mesures pour favoriser l’inclusion financière et l’autonomisation des femmes rurales, mais également d’informer la population, particulièrement les femmes participantes au Programme National d’Education Financière (PNEF). Aussi, ce Forum des Femmes se veut être un espace de discussions, d’échanges d’idées et de partage d’expériences pour la promotion de l’inclusion et de l’éducation financières des femmes. Aussi, doit-il offrir un cadre de réflexions sur les principaux enjeux et opportunités pour une meilleure inclusion sociale, financière et économique des femmes rurales.
La BRH espère que les échanges, causeries et discussions aboutissent à des solutions innovantes susceptibles d’offrir de nouvelles modalités d’inclusion financière et des opportunités économiques pour les femmes rurales. C’est cet état d’esprit qui doit nous animer ce matin !
Mesdames, Messieurs,
Je ne terminerai pas mon intervention sans remercier particulièrement tous les membres du Comité de Coordination et de Suivi de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière dont le Ministère de l’Economie et des Finances assure la présidence.
Nos remerciements les plus sincères vont à l’endroit les différents Ministères tels que le Ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes, le Ministère de l’Education et de la Formation Professionnelle, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, le Ministère du Commerce et de l’Industrie, le Ministère des Affaires Sociales et du Travail, le secteur financier, la société civile, nos partenaires internationaux AFI, ONU-Femme, l’USAID, la Coopération Suisse, le Gouvernement Canadien, MEDA, le Développement international Desjardins, WOCCU, le Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et du Crédit au Sénégal (PAMECAS) etc. Je remercie également toutes les autres institutions ainsi que les intervenants qui ont répondu favorablement à notre invitation et tous ceux et toutes celles qui, d’une façon ou d’une autre, contribue à la réalisation de cet événement dans la ville du Cap-Haitien.
A nos très chers Capois, merci pour votre chaleureuse hospitalité !
Sur ce, je déclare le Forum des Femmes ouvert depuis la Cité Christophienne ! Je formule les vœux de plein succès à vos travaux. Puissent à travers ce forum, émergent, de vos débats fructueux, des orientations dont pourront s’inspirer les différents acteurs de l’inclusion financière pour une plus grande résilience des femmes rurales.
Que Dieu continue de nous bénir Haïti !!!!
Merci.
Jean Baden Dubois
Gouverneur de la BRH
Madame la Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes,
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement rural,
Monsieur le Ministre du Commerce et de l’Industrie,
Monsieur le Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti,
Madame, Messieurs les Membres du Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haïti,
Madame la Représentante de l’Organisation des Nations Unies pour les Femmes (ONU / FEMMES),
Mesdames, Messieurs les Partenaires dans la réalisation du Plan National d’Education Financière, notamment l’Alliance Mondiale pour l’Inclusion Financière (AFI),
Mesdames, Messieurs les Cadres de l’Administration Publique,
Mesdames, Messieurs les Cadres de la Banque de la République d’Haïti,
Mesdames, Messieurs les Présentatrices, Présentateurs, Modérateurs, Modératrices et Panélistes,
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, vous qui suivez en Virtuelle, en vos titres, grades et qualité,
Mes Dames, Messieurs les Représentants de la Presse
Distingués femmes entrepreneures,
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
Les assises auxquelles j’ai le plaisir de participer ce matin témoignent tant de la ferme volonté que du souci constant du Chef de l’Etat Son Excellence Jovenel MOÏSE et de l’ensemble du Gouvernement de poursuivre et d’intensifier la lutte pour l’inclusion des femmes dans les activités économiques et financières du pays.
En effet, doter les femmes, particulièrement celles vivant en milieu rural, des moyens d’assurer leur autonomisation financière est l’une des conditions nécessaires à une croissance économique et à un développement équitables et durables. Nous en sommes tellement conscients que nous nous efforçons, chaque jour davantage, à inscrire dans la réalité quotidienne de nos concitoyennes et concitoyens les bienfaits découlant de la Stratégie Nationale d’inclusion financière ainsi que du Plan National d’Education Financière ouvrant à toutes et à tous, par l’éducation et l’information, les portes de l’environnement économique et financier national.
Dans ce dessein, je ne peux que me réjouir de pouvoir donner forme aujourd’hui à ce forum sur l’Education et l’Autonomisation Financière prévu à travers le Plan National d’Education Financière qui met une emphase spéciale sur ce groupe sensible, vulnérable mais essentiel de notre population, je veux parler des femmes vivant en milieu rural. Déjà les femmes, d’après les chiffres de l’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique, totalisent environ six (6) millions sur une population de 11.9 millions d’habitants. Celles qui vivent en milieu rural sont recensées à hauteur de 2.5 millions de personnes.
Ainsi, vous convenez toutes et tous avec moi, que l’importance de ce groupe n’est plus à démontrer et que ce Forum, en dépit de toutes les difficultés conjoncturelles connues, se révèle sinon pertinent du moins nécessaire pour inciter la participation réelle des femmes dans la machine économique et le système financier du pays.
En ouvrant ce Forum adressé aux femmes vivant en dehors des agglomérations urbaines, nous poursuivons la campagne de sensibilisation entamée l’an dernier sur les concepts, notions et structures de la Finance et de l’Economie. La culture financière que nous voulons orienter, développer, renforcer chez les filles et femmes habitant en dehors des villes, devra rendre ces dernières plus autonomes, encore mieux organisées afin que leurs décisions et comportements s’harmonisent avec les efforts institutionnels pour une croissance rationnelle et durable de l’économie nationale.
L’agenda qui se déroulera à ces fins, devra permettre des discussions et activités qui feront ressortir les réalités de ces filles et de ces femmes, leurs forces comme leurs faiblesses, tout en leur fournissant l’opportunité d’explorer des pistes pour une meilleure structuration de leurs choix et actions dans l’optique d’un rendement optimal pour elles, leurs familles, leurs communautés.
Bien que l’activité se déroule aujourd’hui dans la belle ville de Cap-Haïtien, notre action ne se limitera pas aux filles et femmes de la zone du Nord. Les moyens technologiques disponibles porteront nos efforts à celles qui vivent dans d’autres parties du territoire. Elles sont, toutes, concernées par cette campagne d’information, d’éducation et d’inclusion économique et financière.
En examinant avec les personnes ciblées les chiffres inquiétants avancés ce matin, nous chercherons à approfondir la compréhension de part et d’autre, système versus population, des défis et obstacles, pour tenter de trouver, ensemble, des voies de solution à travers les structures existantes. Le cas échéant, il faudra dégager des indices pour orienter de nouvelles réflexions et réponses.
Le Plan National d’Education Financière voudra augmenter ces nombres trop restreints de femmes propriétaires, de femmes génératrices de revenus convenables, de femmes entrepreneures utilisant les services financiers formels. Informer les filles et les femmes vivant en milieu non urbain, devra allonger la liste des personnes bancarisées, capables d’épargne et d’investissement.
Les structures et incitations mises en place au bénéfice des actrices économiques du monde rural doivent être connues et comprises par toutes celles qui sont éligibles afin qu’elles en usent à bon escient. Celles qui ne sont pas encore qualifiées pour en tirer profit dans l’immédiat seront stimulées à le devenir dans un avenir plus proche que lointain.
Les filières productives rurales que le Gouvernement de la République se propose d’accompagner, selon les spécificités de chacune, dans le cadre du Plan de Relance Economique Post COVID, seront développées, comme il est dit dans ce Plan : « aux fins de renverser la tendance au déclin de la production et permettre au secteur agricole d’assurer pleinement sa fonction traditionnelle et primordiale de contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Ce Plan, comme les supports et projets envisagés, faciliteront l’accès à l’énergie renouvelable, à l’eau potable et pour irrigation, ainsi que l’obtention de crédit.
Mais il faudra, pour réussir ce Plan de Relance, que les acteurs et actrices du secteur soient prêts, c’est-à-dire, tout à fait conscients des enjeux et capables de naviguer efficacement le système financier dans une perspective d’accroissement de la production et de création de richesse.
Les différents opérateurs du système initieront, dès ce Forum, une éducation formalisée des filles et des femmes du monde rural, à travers les écoles, organisations, associations, et autres types de regroupements. Un encadrement spécifique sera mis en place pour une préparation appropriée à l’entreprenariat et la gestion subséquente pour des exploitations viables et durables.
Demain, à la clôture de ce Forum, nous devrons avoir une bien meilleure appréciation de la réalité et de l’environnement économique des femmes vivant hors des zones métropolitaines. Les filles et les femmes qui participeront, de près ou de loin, à travers la plateforme technologique mise à leur disposition, auront une compréhension plus pratique du système financier et des structures formelles d’encadrement et d’assistance.
Elles devront être, après ces deux jours, avoir les informations nécessaires à la continuation de leur sensibilisation et leur éducation en ce qui concerne l’utilisation normale du système financier. Ces filles et femmes devront déjà être désireuses de prendre des décisions avisées par la consultation d’agents ou opérateurs financiers et l’impact attendu est important vu la transversalité de la présence féminine dans les différentes sphères de la vie nationale, particulièrement, leur rôle dans l’économie rurale et le caractère primordiale de cette dernière dans l’environnement économique haïtien.
Fanm Okap mwen yo, Fanm peyanm,
Ke nou nan Okap oswa nap swiv sou Entènèt, kèlke swa kote nou ye nan peyi Dayiti, mwen salye nou epi tou mwen di nou jan mwen kontan avè nou maten an. Nou vini la pou kòmanse Fowom que Bank Repiblik Dayiti ak Ministè Finans ap òganize jodia ak demen.
Nou menm, ki ap travay nan Gouvènman Peyi Dayiti, nou wè youn nan solisyon pou nou pote chanjman nan kijan nape viv, nan kijan nap travay, jan ke nou gade zafè lajan: se pou nou konprann, se pou nou genyen bonjan enfòmasyon sou systeme financier pays dayti.
Se pou nou genyen tou, bonjan lide sou kijan pou moun òganize komès yo, biznis yo oswa konpayi yo. Lè nou fè bèl rekòlt, genyen lòt jan ke nou kapab vann oswa fè lòt pwodwi avèk sa nou rekòlte.
Lòt lentansyon Fowom saa , se pou nou eksplike Medam yo kijan sektè finans nan mache nan peyi Dayiti epitou kijan Medam yo kapab jwèn èd oswa lajan pou fè biznis. Lè machandiz yo pakab ale vann, yo pa ta dwe gaspiye, nou pa ta oblije jete yo, gen jan pou nou ta fè lòt pwodwi ak yo. Men sa mande lajan. Ebyen gen posibilite pou nou jwen lajan nan bank, oswa kooperativ oubyen nan Mikwofinans.
Men genyen yon jan pou ou parèt pou mande lajan oswa èd. Se sa nou vini eksplike.
Nan Fowòm sila, ou ap genyen pou diskite ak ajan epi tou ak operatè zafè finans. Yo pwale eksplike nou kijan pou nou fonksyone nan sistèm finans peyi Dayiti.
Mwen ta swete nou tande byen, pale byen pou pwofite 2 jou sa yo. Fowòm sa a se, pou nou patisipe nan aktivite ki ap fè nou aprann, fè nou reflechi, epi tou ki ap fè nou konprann pi byen zafè lajan. Lè nou di zafè lajan, nou vle pale de konprann kote moun jwenn lajan, kòman pou nou sèvi ak lajan, epi tou kòman pou nou pa pèdi lajan twò fasil. Li enpòtan pou Medam yo konprann nesesite pou sèvi avèk asirans, pou yo pa pèdi pou kont yo, pou yo pa pèdi twòp.
Lòt lide Fowòm sa, se pou ede Medam yo nan jan yo kapab mete tèt yo ansamb pou monte yon konpayi oswa antrepriz, pou yo fabrike pwodwi pou yo vann epi tou pou yo kapab bay lòt moun nan peyi a travay pou fè lajan tou, pou yo kapab manje epi tou okipe pitit yo ansamb ak fanmi yo.
Sa mande pou nou aprann, pou nou byen konprann sistèm lan. Se preparasyon sa a ke Fowòm jodia vle kòmanse. Se preparasyon sa ke Plan Nasyonal Edikasyon Finansyè a vle reyalize. Plan sila, se yonn nan chimen Estrateji Nasyonal Enklisyon Finansyè peyi Dayiti vle reyalize : pou tout moun nan peyi nou, kapab patisipe kòm sa dwa nan aktivite ekonomik nòmal, byen òganize yo pou yo fonksyone pi byen, fè komès epi tou biznis pi byen. Konsa, yo va jwenn pi plis lajan, yo va bay plis moun travay, yo va kapab patisipe nan pèmèt Leta fè wout, fè lopital ak lekòl fonksyone pi byen. Epitou, tout moun va pwofite.
Medam yo genyen pou yo konprann epi tou aprann koman Leta travay, koman Leta fonksyone pou li cheche lajan, itilize lajan, epi tou plas pa yo nan bagay Leta ap fè.
Mwen swete tout Jèn fi, tout Medam kap viv andeyò lavil tout kote nan peyi Dayiti, pou yo patisipe tout bon nan sa kap fèt la nan Fowòm sila, avèk Plan Nasyonal Edikasyon Finansyè a.
Mwen pale nan non Ministè Ekonomi ak Finans pou mwen di nou, Medam, se pou nou byen pwofite de Fowòm sa a.
Mwen vle tou voye konpliman pou tout moun Bank Repiblik Dayiti ki travay pou fè Wonble sila, antan map swete aktivite sa a byen pase.
Bon travay tout moun !!
Mèsi anpil.
Monsieur le Gouverneur
Monsieur le Gouverneur-Adjoint
Monsieur le Directeur Général
Collègue Membre du Conseil
Mesdames, Messieurs de la Haute Direction
Mesdames, Messieurs les Cadres
Chères Collaboratrices et Chers Collaborateurs,
Chers Exposantes et Exposants
Membres de la Presse
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, présents et en ligne
Au nom de mes pairs du Conseil d’Administration, permettez que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue, à la Foire annoncée, lors des festivités de fin d’année, foire lancée sous le thème:
“ Retrouver notre identité à travers la mode”.
Cet évènement, inédit à la BRH, est une initiative revêtant une importance capitale pour le Conseil d’Administration, car il s’inscrit dans la lignée des efforts consentis, devant conduire à la croissance économique.
La Banque de la République d’Haïti s’est évertuée, au fil du temps, à mettre en place un ensemble de mécanismes financiers, visant l’augmentation de l’emploi et de la production nationale. Elle a compris également que, pour maximiser les résultats attendus de ces susdits mécanismes, des actions concrètes, ciblant directement la demande de consommation des biens et services, produits localement, sont une nécessite et constituent un levier important sur lequel, capitaliser, afin d’impacter positivement l’économie nationale.
Dans cette optique, la Banque de la République d’Haïti se veut être un acteur pionnier, en posant la première pierre que constitue l’initiative du jour. Cette foire-Exposition de produits de mode, localement fabriques, nous permettra de partir à la découverte de nos talentueux artistes, artisans et créateurs, à travers leurs oeuvres, empreintes d’originalité, de couleur, de finesse et de créativité.
Il nous faut saisir au vol cette opportunité que nous offre la crise, causée par la pandémie. Les voyages vers l’extérieur devenant de plus en plus contraignants, un momentum se dessine donc pour le secteur de la mode et pour d’autres secteurs, tels, la Gastronomie Haïtienne, le tourisme local, les Salons-expositions et j’en passe!
Je salue donc la présence et la participation des exposantes et exposants et leur souhaite une journée, porteuse de grandes opportunités.
Cet évènement s’est construit avec le support inconditionnel de nombreux Collaborateurs et souffrez que je prenne le temps de les en remercier, du fond du Coeur:
Merci à nos Collaborateurs de la Direction de Communication et des Affaires Publiques, de la Direction des Affaires Juridiques, de La Direction de l’Information et de Technologie, de l’Unité Organisation, Méthodes et Innovation, de l’Unité de Sécurité et de Transport, de l’Unité de Gestion des Bâtiments et à tout le staff du Centre de Convention et de Documentation.
Et enfin, last but not least, Merci à l’équipe de Chokarella et a Mme Laurence Magloire!!
Le moment est venu de céder le microphone à l’Architecte de cette journée, le Gouverneur, M. Jean Baden Dubois, sans la grande implication duquel cet évènement n’aurait pas pris corps. Gouverneur, sous vos applaudissements!
Merci!
Myrtho René
Membre du Conseil d’Administration
- La mise en circulation d’une Gourde Digitale par la Banque centrale s’inscrit dans le prolongement des actions visant à accompagner et orienter le développement de l’économie numérique en Haïti. La BRH rejoint donc la mouvance internationale orientée vers l’implication croissante des Autorités Monétaires dans l’offre de moyens de paiement mieux adaptés aux mutations technologiques et aux préférences des consommateurs. En avançant à grands pas vers l’implémentation d’une phase pilote, la BRH se hisse à la hauteur du dynamisme affiché par les pays de la région, certains ayant achevé leur phase pilote (l’Uruguay) tandis que d’autres sont en cours d’implémentation (Les Bahamas) ou à un stade avancé dans leur recherche conceptuelle (la Jamaïque).
- Le système de paiement haïtien a connu des progrès significatifs au cours de ces 20 dernières années notamment avec l’apparition des Banques à distance et des FinTech. Toutefois, ces avancées se heurtent à des contraintes persistantes, les empêchant de réaliser leur plein potentiel en tant qu’outils d’inclusion financière. En effet, l’absence d’un cadre légal, le manque d’éducation financière et l’absence d’interopérabilité entre les fournisseurs de services ainsi que de dispositions claires qui garantissent la protection des consommateurs constituent des freins à une plus forte expansion. Ajouté à cela, les difficultés d’accès à l’énergie et à un réseau internet compromettent l’accès et la disponibilité des services financiers surtout dans les zones reculées.
- A travers cette solution, la BRH compte offrir un moyen de paiement plus sécuritaire (surtout en cas de catastrophes naturelles) qui permet d’adresser les problèmes cités plus haut, en étant garanti par l’Autorité d’Emission, accessible sur tout le territoire national et circulant sur un support permettant d’éliminer la dépendance à l’énergie et au réseau internet. La Gourde Digitale vient donc renforcer le système de paiement actuel et se révèle donc un facteur de modernisation de la politique monétaire, de promotion de la concurrence dans le paysage financier, d’augmentation du seigneuriage, de dynamisation des activités économiques et de promotion de l’inclusion financière
- La Gourde Digitale tout comme la gourde physique sera un instrument de souveraineté nationale et un symbole de notre identité. Ce projet dépasse donc le cadre de la BRH et son appropriation par le public est fondamentale pour la matérialisation des résultats attendus. L’organisation de ce concours suit donc cette logique participative que nous préconisons en vue de susciter l’intérêt du public tout en mettant à profit les compétences et expertises à divers niveaux. A l’issue de cette compétition qui mettra aux prises vos sens créatifs, il s’agira de trouver un nom pouvant identifier de manière unique la Monnaie Digitale de la Banque Centrale Haïtienne. Les candidats seront évalués selon les critères et principes fondamentaux qui vous seront présentés pendant cette rencontre.
Mw di nou mèsi pou interè que nou manifeste pou projè sa e mw ban nou garanti que chwa yo ap fèt ak anpil transparans, pwofesyonalis ak rigè. Nou konnen jan peup ayisyen gen imajinasyon e yap rive jwenn yon non ki makonnen ak istwa nou, kilti nou, idantite nou e ke nap fyè poun kleronnen tout kote n pase. Goud dijital la se pwojè tout ayisyen e se youn nan mwayen poun ede activité ekonomik boujonnen nan peyi a, sa ki ap pèmèt kreye plis travay e amelyore kondisyon lavi sitou nan zòn ki pi rekile yo.
Mesdames et Messieurs les membres du conseil d’administration de la Banque de la République d’Haïti
Chers directeurs et cadres de la Banque de la République d’Haïti
Membres de la presse parlée et écrite
Distinguées invités
Chers participants
Mesdames, messieurs,
Au nom du Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haïti (BRH), je vous félicite d’être présent avec nous sur toutes les plateformes (Twitter, Facebook, Instagram et bien sûr à travers les médias traditionnels) pour le lancement de ce concours national a une appellation ainsi qu’a un logo pour « la gourde digitale ».
La BRH est convaincue que l’innovation est nécessaire pour aller de l’avant. C’est pour cela qu’elle ne cesse d’encourager l’innovation dans les différentes sphères d’activités et naturellement au niveau du système financier que ce soit,
- pour apporter son soutien dans les infrastructures,
- le savoir-faire
- et la technologie.
Je veux profiter de l’occasion pour saluer les initiatives des institutions financières, qui, elles aussi tendent à rendre le système financier haïtien plus dynamique et plus compétitif et plus accessible.
L’innovation a permis au système de paiement d’évoluer depuis ces dernières années. Il est possible d’effectuer des transactions par carte, par téléphone et en ligne. Naturellement, nous devons citer
- la compensation électronique des chèques et
- l’interopérabilité entre les différents systèmes de paiement des institutions financières possible, depuis le 1er octobre de cette année, à travers le Processeur National de Paiement (PRONAP). Grâce à ces innovations nous avançons à grand pas vers la révolution numérique de la monnaie et l’inclusion digitale.
L’innovation au niveau du système financier entraine de plus en plus la digitalisation croissante des paiements scripturaux avec un impact certain sur la demande d’espèces (pièces de monnaie et billets..).
En tant banquiers centraux, nous devons donc prendre des initiatives afin de renforcer le système de paiement et répondre aux attentes des consommateurs pour la protection des transactions, maintenir la confiance du public, assurer la stabilité du système financier et surtout favoriser une plus grande inclusion financière de la population vivant dans les zones reculées.
Cette révolution numérique riche en bénéfices qui améliorent nos quotidiens amene avec elle également des risques importants : risques de conformité, risques financiers et risques de stabilité. Ces risques associés à la monnaie numérique sont donc à la fois macroéconomiques et micro-économiques.
Aujourd’hui, 80 % des banques centrales de la planète étudient la possibilité de créer une monnaie digitale et 10 % sont au stade de projet pilote. A l’instar des banques centrales du monde, la BRH analyse l’opportunité de lancer une monnaie digitale de banque centrale (MDBC).
C’est ainsi que depuis 2019, la BRH travaille sur l’opportunité de lancer une Gourde Digitale. Une gourde qui pourra être accessible via une carte à puce, un téléphone intelligent ou de base, une tablette et même un ordinateur.
Le projet de la gourde digitale a été présenté au public à différentes occasions : 5ème Edition de la Fintech (30 avril 2020), au lancement du Plan National d’Éducation Financière (25 juin 2020), au Mercredi de Réflexions de la BID : Gourde Digitale et Inclusion Financière en Haïti (22 juillet 2020) et même sur le Rendez-vous Économique avec Kesner Pharel (27 juillet 2020).
Aujourd’hui, c’est a vous public d’être un acteur de la Gourde Digitale !
Et désormais, vous allez a être un acteur clé tout au long du reste du processus.
Ce matin nous vous invitons à participer au concours national d’appellation de la gourde digitale. Nous allons donc ensemble choisir le nom et le logo pour la Gourde Digitale.
Nous attendons de vous en tant que participant de proposer le nom qui désignera le mieux Notre Gourde Digitale, ses valeurs, sa philosophie et sa mission dans l’économie.
La sélection de ce nom qui sera retenue pour la gourde digitale sera faite par un jury constitué de personnalités compétentes et sur la base de critères spécifiques. Le travail des membres du jury nous présumons sera énorme. Nous leur disons déjà un grand merci. Ce jury choisira les trois meilleurs (noms et logo).
Et de ces trois, on laissera le public voter et le nom retenu sera le nom que vous public aurez choisi.
Dapre yon anket ki te fèt an 2018, 46% nan moun ki gen 15 an oswa plis an Ayiti yo eskli finansyèman. Pou nou rive korije sa. “Nou vle pou chak ayisyen kapab enkli finansyèman, se premye objektif sa a.
Dezyèm objektif goud digital li ekonomik.
- “Pri pou fè biye trè enpòtan.”
- Goud la dijital fè li posib modènize sistèm nan peman,
- Mete plis kontwol nan servic yap bay popilasyon an
- Lap pemet leta rive zou mounn kap viv nan zòn ki lwe yo jwen bonjan kalite mwayen pou lavi yo.
kreyasyon goud dijital la ap fèt nan yon sekirite dijital ki chita nan bank santral la epi y ap itilize li pou transfere lajan sa a elektwonikman nan diferan bous.
La Banque de la République d’Haïti compte beaucoup sur votre contribution. Nous espérons que cette nouvelle forme de monnaie apportera un réel changement au pays et que vos efforts favoriseront la croissance et le développement durable d’Haïti.
Merci à vous
Excellence Monsieur l’Ambassadeur
Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances
Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique de l’Ambassade Suisse
Madame et Messieurs Membres du Conseil de la Banque de la République d’Haïti
Cadres de la BRH
Mesdames et Messieurs de la Presse parlée et écrite
Mesdames et Messieurs,
La Banque de la République d’Haïti est fière d’élargir son partenariat avec la Coopération Suisse via l’Ambassade de Suisse en Haïti dans le cadre des efforts visant à financer le secteur agricole dans le pays. En effet, les deux entités ont conclu un accord en décembre 2019 pour la mise en place d’un Cadre National pour le Renforcement du Financement Agricole en Haïti (CNFA). Les ambitions du programme CNFA sont d’augmenter le revenu et contribuer à la sécurité alimentaire des exploitants agricoles en renforçant durablement la gouvernance et la définition de mécanismes financiers adaptés au secteur agricole. En termes de résultats escomptés, on a :
• Les institutions financières publiques et privées des secteurs agricole et agroalimentaire développent et mettent en place des mécanismes adaptés et fonctionnels de gouvernance du système financier agricole.
• Les entrepreneurs, des femmes et des hommes des secteurs agricole et agroalimentaire, mieux informés et sensibilisés à la gestion des risques, utilisent les services financiers et d’accompagnement adaptés au développement des chaînes de valeur agricoles.
Considérant son agenda monétaire pour la croissance, la BRH s’est donc engagée pour une durée de 54 mois à mettre à la disposition du programme CNFA des ressources financières allant jusqu’à cinq milliards de gourdes par an pour le financement de projets bancables qui seraient portés par les acteurs de toute la chaine de valeur du secteur agricole via l’application de la circulaire 113 qui offre audit secteur des opportunités de financement qui jusqu’ici n’existaient pas encore.
Mesdames, messieurs,
La Banque a fait plus que s’engager pour supporter le secteur agricole. Des réflexions portées sur une meilleure applicabilité de la circulaire 113 ont débouché, en date du 20 novembre dernier, sur la signature d’un Protocole d’Accord entre la BRH et le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), pour la garantie des opérations de paiement du Fonds de Garanties partielles du risque de crédit en faveur des PME de l’agriculture et de l’exportation (FGPCAE), lequel Fonds de Garantie est administré par le FDI. La mise en place du FGPCAE constitue une brique importante dans la construction de l’écosystème de financement agricole nationale.
Ces actions témoignent de la volonté de la Banque centrale de changer les paradigmes autour du financement du secteur agricole. En outre, la Banque centrale comprend le potentiel des jeunes dans le processus de création de richesse, en témoignent les 1700 concepts d’affaires reçus en seulement une semaine lors du lancement du concours de Concept d’Affaires dans le cadre du Forum des Jeunes organisé conjointement par la BRH et le MEF les 12 et 13 août 2020.
Mesdames et messieurs,
La signature de cet Avenant entre la Coopération suisse et la BRH renforce l’Accord de décembre 2019 et s’inscrit lui aussi dans une dynamique de continuité des efforts de financement du secteur agricole. En effet, cet Accord va permettre de financer près de 50 concepts d’affaires de plus. A noter que la Banque avait sélectionné 12 concepts d’affaires des 1700 reçus. Grace à cet Avenant, la Coopération Suisse rendra disponibles des fonds qui permettront non seulement de financer ces jeunes entrepreneurs dans des filières porteuses comme la transformation agricole, l’élevage, l’artisanat et la pêche, mais aussi d’améliorer leurs compétences en éducation financière et de réaliser une étude de capitalisation afin de documenter les résultats et les leçons apprises.
Vous comprenez donc que ce programme a un volet d’éducation financière qui est d’une grande importance pour la Banque qui estime qu’un entrepreneur éduqué financièrement lui permettra de :
• Prendre de meilleures décisions pouvant réduire les risques financiers pour son entreprise ;
• Contribuer ainsi à augmenter la chance de survie de son entreprise ;
• Favoriser une inclusion financière toute en douceur ;
• Favoriser le transfert de l’informel au formel.
Mesdames et messieurs,
Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, ce genre d’initiatives a le mérite d’insuffler un vent d’espoir et de présager de meilleur lendemain. Cela nous rappelle que l’investissement n’est rien d’autre qu’un pari positif sur l’avenir.
De concert avec nos jeunes, mettons-nous au travail pour façonner ce futur. De toute manière, entre choisir un futur qui sera le produit de nos inactions présentes ou le reflet de nos actions et engagements d’aujourd’hui, le choix n’a jamais été aussi clair.
Jean Baden Dubois.
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances,
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Madame et Messieurs les membres du Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haïti,
Monsieur le Directeur Exécutif de l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI),
Mesdames et Messieurs les représentants et membres de l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI),
Monsieur le représentant du Centre de Recherche pour le Développement International (IRDC),
Monsieur le représentant de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE),
Mesdames et Messieurs les responsables d’Institutions membres du Comité de Pilotage du Plan National d’Education Financière,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de Pilotage du Plan National d’Education Financière,
Chers directeurs et cadres de la Banque de la République d’Haïti Honorables invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs,
C’est un honneur pour moi de prendre la parole, au nom du Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haïti, à l’occasion du lancement du Plan National d’Education Financière (PNEF). Je vous remercie, tous, d’avoir répondu favorablement et virtuellement à notre invitation. Signe de votre intérêt pour la thématique de l’éducation financière, qui nous converge ce matin vers nos écrans d’ordinateurs, nos tablettes ou nos téléphones portables.
Les questions de l’inclusion financière constituent, un enjeu économique majeur, mais également sociétal, pour tout pays et précisément pour Haïti. Nos choix économiques, financiers et nos modes de vie sont souvent impactés par la problématique de l’inculture financière. Environ 89% de la population âgées des quinze (15) ans et plus n’ont pas accès à un compte bancaire, 73 % n’épargnent pas formellement et 87 % n’empruntent pas. La profondeur du marché financier, son incapacité à répondre, adéquatement, aux besoins en services financiers d’une fraction significative de la population peuvent avoir des incidences négatives sur le développement de l’entrepreunariat formel et la croissance économique du pays.
Dans la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière, lancée en 2014, cinq (5) grand axes ont été identifiés et priorisés comme levier pour amener une bonne frange de la population à avoir accès à plus de services et de produits financiers de qualité et de proximité. Ces initiatives devraient contribuer à l’amélioration de son bien être financier. L’un de ces cinq (5) piliers retenu porte sur l’éducation financière et la protection du consommateur. Si des progrès ont été observés au niveau du taux d’inclusion financière en Haïti passant de vingt-sept (27) % en 2014 à trente-quatre % en 2018, il nous faut comprendre que l’éducation financière demeure une prérogative centrale pour consolider les acquis et renforcer la résilience.
Mesdames, Messieurs, le niveau d’éducation financière de nos concitoyens ainsi que leur perception du sujet ont été évalués, à travers deux (2) lourdes enquêtes, au cours de ces trois (3) dernières années : Le FinCap et le FinScope . Selon les enquêtes FinScope, réalisées en 2018, sur plus de plus de sept point cinq (7, 5) millions de personnes âgées de quinze (15 ) ans et plus, en Haïti, 53 % d’entre elles, souhaitent bénéficier d’une éducation financière, de manière à mieux faire fructifier leurs actifs financiers, mieux définir leur priorité financière et se protéger contre les aléas de la vie.
Cette forte attente est tout à fait justifiée quand nous savons, que :
- les individus tout comme les ménages ont besoin d’un minimum de compétences financières pour faire un budget, épargner, financer l’éducation des enfants, faire des investissements à long terme, acheter une maison et plus encore.
- selon l’étude FinScope, environ 80% de la population sont en précarité financière, 63% n’ont aucun contrôle sur leurs dépenses, 12 % seulement arrivent à comprendre un produit financier.
- le changement de comportement financier ne suivra pas tout seul. Si nous voulons contribuer à l’émergence de ce monde inclusif, il doit être stimulé par des efforts de sensibilisation et de formation conjugués et une simplification des informations nécessaires. L’’éducation financière peut mieux guider les ménages dans leurs choix financiers.
- l’accès à l’éducation financière peut contribuer, non seulement, à accroître, l’accès, mais aussi, l’utilisation des services financiers en termes d’épargne, à réduire le niveau d’endettement, faire diminuer la probabilité de défaut de paiement et de la faillite et maintenir la stabilité financière.
Le 27 mai 2020, a été consacré à la restitution des travaux portant sur l’élaboration du Plan National d’Education Financière, à nos deux (2) Ministères concernés, porteurs du projet, au Conseil d’Administration de la BRH ainsi qu’aux autres institutions membres du comité de pilotage du document. Ce Plan s’appuie sur les recommandations de l’OCDE-INFE, de l’AFI et les leçons apprises de certaines pratiques de notre communauté de praticiens en éducation financière. Leur aboutissement est, le fruit d’une année de collaboration entre différents acteurs, tant du secteur privé que du secteur public, œuvrant tous pour l’amélioration de l’inclusion financière en Haïti.
C’est dans ce contexte, qu’au nom du Conseil d’Administration de la Banque Centrale, en ma qualité de président du Comité de pilotage, j’ai le privilège de rendre public le Plan National d’Education Financière dit PNEF Haïti, aujourd’hui. Le PNEF arrive dans un contexte particulier mais tellement opportun. En effet, l’arrivée de la crise sanitaire de la Covid-19 a été l’occasion de mieux appréhender l’ampleur du travail à faire pour arriver à une inclusion réelle en Haïti. La pandémie et le confinement auxquels nous sommes confrontés actuellement touchent particulièrement les personnes vivant dans des conditions de vulnérabilité mais aussi les grandes compagnies, les professionnelles, les travailleurs, les MPME, les ménages, les écoliers et les universitaires. Elle nous a permis de comprendre combien l’accès et la maîtrise des outils technologiques et de communication sont devenus plus que nécessaires pour la continuité des affaires.
Mesdames, Messieurs, ce document cadre, dont l’horizon est de cinq (5) ans, devra nous permettre de mobiliser tous les acteurs concernés, pour mieux combler les attentes de la population haïtienne en matière d’éducation financière. Enfants, jeunes scolarisés ou non, moins jeunes, universitaires, professionnelles indépendants ou cadres du secteur public ou privé, citadins ou citoyens vivant dans nos régions rurales, investisseurs, agents économiques du secteur formel comme ceux du secteur informel, les ménages en général, vous êtes tous concernés par ce Plan National d’Education Financière, dans votre quête d’autonomisation financière, pour pouvoir vous adapter aux évolutions de ce monde économique tant compétitif. Les services basiques de paiement à distance ou en ligne, la digitalisation des opérations, des incitations à l’’épargne, une meilleure appropriation des concepts d’assurance sont autant d’outils et de moyens qui doivent être mis à contribution pour augmenter votre résilience financière.
Il me plait, par la même occasion, de faire une mention spéciale à nos partenaires internationaux qui ont apporté tout leur soutien pour la réalisation de ce document et l’organisation de cet évènement de lancement public. A nos amis de l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI), de la Fondation Capitale, du Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI), l’OCDE, la Banque Mondiale, la Banque Centrale de Seychelles, la Banque de Réserve des Fidji, la Banque Centrale du Maroc ainsi que la Fondation Marocaine pour l’Education Financière, nous vous disons un grand merci !
Aux institutions membres du comité de pilotage et leurs représentants, CHAPO BA ! Toujours ferme à la barre ! Votre présence constante, malgré vos lourdes responsabilités professionnelles et le contexte difficile du pays lock et de la crise sanitaire de la Covid 19, va laisser ses empreintes. En ce sens, nous remercions chaleureusement les représentants :
- du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
- du Ministère de l’Economie et des Finances ;
- de l’Université Quisqueya ;
- de l’Association Nationale des Institutions de Microfinance d’Haïti (ANIMH) ;
- de l’Association Professionnelle des Banques (APB) ;
- du Conseil Mondial des Coopératives (WOCCU);
- de l’Unigestion Holding à travers Digicel/ Mon CASH ;
- de la Fédération Le Levier
- du Conseil National pour le Financement Populaire (KNFP) ;
- du Group Croissance ;
- de l’Alternative Insurance Company (AIC) ;
- de l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) ;
- de l’Action pour la Coopération avec la Micro Entreprise SA (ACME SA) ;
- de Care Haïti à travers son programme de banques villageoises
Permettez-moi, également, d’adresser mes remerciements au Président de la République, pour avoir pris l’initiative de mettre en place la Commission Présidentielle ainsi que le Groupe de travail pour l’Inclusion Financière. Ces entités devront nous permettre de créer plus de synergie entre les politiques d’inclusion et d’éducation financières et les autres politiques sectorielles pour une plus grande inclusion économique, sociale et financière.
A tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail d’une façon ou d’une autre. Les consultants, les lecteurs, les panelistes, les modérateurs, les médias, le comité organisateur de l’événement, les Directeurs, les cadres techniques et de support, au nom du Conseil d’Administration et en mon nom propre, nous vous adressons un merci spécial.
La Nation vous sera tous reconnaissante pour votre contribution à son élévation !
Mesdames et Messieurs,
Je suis persuadé que la richesse et la profondeur des échanges de cette journée nous permettra d’identifier les voies et moyens d’encourager les innovations favorables à l’éducation et l’inclusion financières, dans un cadre global qui allie à la fois la promotion et la diversification des services, la sécurité des opérations et la stabilité du système. Faisons du Plan National d’Education Financière, le PNEF, l’une de nos boussoles, pour agir vite et bien pour relever le défi de la croissance inclusive. C’est ainsi qu’en Haïti pourra s’inscrire dans les objectifs du développement durable !
Que Dieu continue de protéger Haïti !!!!!
Merci

Je prends un plaisir bien réel à vous adresser le discours d’ouverture de la FinTech dans le cadre de la 10ième édition du Sommet Internationale de la Finance. La réalité du virtuel est en train de prendre la pleine mesure du concret dans un monde encore dominé par le schéma occidental de la pensée cartésienne. Cependant, les temps changent, imperceptiblement, à l’image de ce mouvement d’horloge que même l’esprit le plus averti peine à capter dans sa quotidienneté. Et comme le gong de l’horloge, les moments historiques sont là pour venir consigner, dans les annales, les moments de rupture qui, souvent, sont déjà, pour l’esprit d’avant-garde, des éléments du passé. La pandémie du COVID-19 recoupe bien cette analogie.
Aujourd’hui, la réalité quantique prend la pleine mesure du concret dans des applications technologiques qui envahissent, mine de rien, l’espace de l’utilitaire à l’image de l’ordinateur quantique en gestation. Progressivement, la logique cartésienne est en train de s’ouvrir à une forme plus ouverte de rationalité que les scientifiques les plus pétris de sciences pures désignent, au propre pour certains, ou au figuré pour d’autres, sous le nom de mystères des nano structures. Les temps changent donc, imperceptiblement, et certaines frontières du fait scientifique comme du fait technologique perdent de leur étanchéité à l’image de la frontière déjà ténue entre le virtuel et le réel. Au temps où le virtuel devient le nouveau réel, bienvenue dans la dimension réelle du virtuel.
Il aura fallu la crise du COVID-19 pour donner à cette dimension une échelle planétaire. Pour Haïti, le Sommet 2020 représente l’occasion idéale pour intégrer avec fierté cette mouvance dans les moments mêmes de ses manifestations premières. C’est d’ailleurs, fort de cette fierté que procure la légitimité d’être partenaire privilégié de cet événement que la BRH, par mon organe et au nom du Conseil d’Administration, vous convie aux assises historiques des premières assises virtuelles de la Fintech.
Je m’associe également au Group Croissance, à Profin et á PROFIT pour souhaiter une chaleureuse bienvenue aux participants de cette première qui se trouve être la 5ième édition de cette manifestation. Fort heureusement, les thèmes que sont : l’impact des TIC sur la finance, le rôle de la technologie dans l’éducation, les enjeux du Bitcoin, l’inclusion financière à travers les TIC, tous traités dans les précédentes éditions, rencontrent à point nommé les besoins de réflexion du thème particulier de l’édition actuelle. Nous avons donc, s’il en est besoin, le minimum de prérequis pour asseoir l’action de « Financer la réponse au COVID-19 et préparer l’après-crise ».
Les interventions qui vont suivre revêtiront, à n’en pas douter, un caractère prospectif. Il y va du contexte historique de ce sommet. A ce tournant particulier, l’importance des enjeux devrait inspirer les réflexions les plus novatrices aux praticiens des secteurs privés et publics, aux membres de la communauté académique et aux professionnels des institutions internationales pour fonder les actions que nécessitera, beaucoup plus tôt que dans le cours normal des choses, la mise en place du nouvel ordre international que la crise du COVID-19 aura initié sans préavis. C’est donc un honneur pour moi de lancer ce matin les activités de cette édition.
Chers Participants Virtuels,
Les conditions dans lesquelles se tiennent les assisses de 2020 révèlent une capacité d’adaptation qu’on gagnerait à reproduire à une échelle nationale dans une société figée dans la torpeur d’une croissance anémique sur les quatre dernières décennies. Il a fallu la résilience des institutions partenaires, le professionnalisme et la compétence des concepteurs, pour aboutir à la tour de force d’organiser ce sommet virtuel là où la logique première laissait entrevoir, au mieux, un ajournement des activités. Le gouverneur a mis la barre à un niveau encore plus élevé de difficulté en manœuvrant pour respecter la tenue de l’évènement au mois d’avril, dans la tradition sans faille des éditions précédentes. Aujourd’hui, nous y voilà ! Pari tenu ! Une petite voie tracée dans le long cheminement des paris à gagner en matière de création et de répartition de la richesse, de valeurs ancestrales à redorer, de patrimoine culturel et historiques à remembrer ; des vecteurs qui ont pour résultante le maître-mot : Développement. La leçon à tirer est que le raccourci technologique est un outil puissant lorsqu’il est au service d’une volonté collective.
Ce n’est pas le défi qui manque à ceux qui n’ont de choix que de s’engager. C’est le fardeau de chaque haïtien à l’an 2020 de tous les enjeux. Entre la tenaille d’une crise sociétale qui a trop duré et les assauts de plus en plus rapprochés de l’hydre planétaire du COVID-19, la société haïtienne est à l’heure du sursaut qui nous fera trouver dans les graves difficultés actuelles les pousses d’opportunités nouvelles. Pour la planète entière, la crise économique qui accompagne la crise sanitaire laisse ouvertes les options post-pandémie. Les cas de figures couvrent une plage très large de situations qui dépendront du degré de désarticulation des structures de l’économie mondiale et des fractures sociales qui en découleront. Le retour, même transitoire, à des formes plus autocentrées d’action de développement est dans l’ordre des considérations que nous devrions contempler comme voie de sortie à notre propre crise de société.
C’est donc l’occasion pour nous d’ouvrir le champ à plus d’autonomie dans la conduite des politiques publiques en modulant notamment les horizons qu’on leur imprime. Il faudra par ailleurs s’écarter de toute tentation de repli sur soi. L’une des façons de s’y prendre est de profiter des effets de synergie et d’amplification liés aux acquis des technologies qui ont fait leur preuve dans les économies de transition. Citons à titre d’Exemples :
• La Formation en ligne pour obvier aux limitations chroniques des infrastructures académiques et d’un personnel enseignant en quantité en qualité insuffisantes
• Le développement des énergies renouvelables, notamment solaire, pour répondre aux besoins énergétiques associés à un tel effort
• Le télétravail pour contourner les contraintes d’infrastructures à la création d’emplois et comme véhicule privilégié dans la mobilité internationale du facteur travail.
• Le mobile-banking pour sauter la barrière de la proximité dans l’accès aux services financiers et qui, dans ce contexte, aurait pu permettre d’adresser le besoin de la distanciation sociale dans les transactions financières au niveau des banques commerciales.
Ces exemples, bien maigres par rapport aux champs ouverts de possibilités, illustrent la capacité des applications technologiques à transformer l’organisation sociale du travail et ouvrent les choix individuels à un degré beaucoup plus large de flexibilité dans le cadre d’un marché de l’emploi libéré d’un niveau trop coercitif de contraintes physiques. Ils appellent à mon sens á deux niveaux de considérations :
• Le besoin immédiat, pour un pays comme Haïti, d’accommoder l’existant technologique dans la guerre ouverte contre la dissémination du COVID-19 et d’en faire un outil privilégié de prévention dans un environnement fortement limité en matière d’infrastructure sanitaires.
• La mise en place d’un dispositif large de développement des technologies de masse, dans le cadre d’une Stratégie Nationale d’Inclusion Numérique, sur des horizons moyen et long, pour se créer une place honorable dans ce qui ne tardera pas à se dessiner comme le paradigme d’un ordre économique nouveau.
La leçon fondamentale, que l’ampleur des préoccupations immédiates renvoie au second rang des réflexions sur la pandémie actuelle, est le danger que représentent les fractures de toutes sortes, tant au niveau local qu’au niveau mondial, dans un monde où, in fine, la notion de frontière est un leurre, ne serait-ce que par rapport à la réalité du partage planétaire d’une même biosphère.
La marche du progrès planétaire est donc indivisible de son contenu humanitaire global. Fracture numérique, fractures économiques, fractures sociales, sont aussi des facteurs de résilience et, de mutations extrêmes des vecteurs de pandémie en raison de leur meilleure capacité à couver dans les espaces de pauvreté qu’elles alimentent. Le recours au confinement, même dans des conditions de grandes facilités technologique, ne saurait être une solution durable.
Erigé en dispositif de politique publique, il conduit facilement à la configuration sociale si bien décrite dans le roman 1984 de Georges Orwell. Une tentation du repli qui ouvre la porte à des formes sophistiquées de la tentation totalitaire ; à la rétrogradation de notre humanité. Par contre, dans le décor opposé, la marche du progrès planétaire s’accommode mieux du merveilleux à la Jules Verne, dans lequel l’appropriation humanitaire des applications scientifiques les plus innovantes ouvre la voie à ce qu’il y a de mieux dans la nature humaine.
Chers Participants,
La tenue de la 10ième édition du Sommet International de la Finance dans un environnement virtuel de rencontre et d’échanges représente un tournant majeur dans l’existence de cet événement, sinon dans la vie socio-professionnelle en Haïti. La FinTech, qui a fini par s’installer comme composante technologique du Sommet, est l’un des principaux acteurs de ce tournant. Je veux voir dans les assises d’aujourd’hui un saut sur une orbite supérieure d’activité qui prépare cet acteur à jouer, au profit d’Haïti, le rôle qui est le sien dans la nouvelle configuration socio-technologique que le COVID-19 est en train de profiler.
L’apprentissage est un facteur inhérent à tout processus d’adaptation et de développement. Plus forte est la pente de la courbe qui trace ce cheminement, meilleur est le rendement économique et social qui s’y rattache. Cette course à l’efficience commence avec la pertinence des idées qui sortiront de ces assises. Nous, les acteurs d’aujourd’hui n’aurons pas l’occasion de contempler l’arrivée. Mais, qu’à cela ne tienne !! Nous n’avons d’objectif que d’être dans le peloton de tête au moment de passer les torches à la génération du prochain relais. En ce sens, vous conviendrez avec moi que le développement technologique est finalement une course de relais dont les gains d’étape conditionnent la vie des peuples. Je trouve que c’est extrêmement passionnant comme challenge !
Je déclare ouvertes les assises 2020 de la Fintech
MERCI
Ronald GABRIEL
Je commence par saluer tous les intervenants qui ont rendu possible cette édition du
sommet de la finance.
Je salue de manière particulière :
Le Président, Son Excellence Monsieur Jovenel Moise
Monsieur le Premier Ministre,
Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances
Monsieur le PDG du Groupe Croissance
Monsieur le PDG de PROFIN
Mesdames, Messieurs les représentants de la presse
Mesdames et Messieurs les participants virtuels, tous les réseaux sociaux confondus.
Comme vous le savez, le sommet de la finance est devenu l’un des
événements économiques les plus attendus du pays depuis son lancement par le
groupe Croissance, il y a dix ans.
Chaque année, des spécialistes du secteur économique et financier sont invités à se
prononcer sur un thème à la fois utile et actuel. L’année dernière, par exemple,
le double thème retenu – « financer l’agritourisme en Haïti » et « faciliter l’inclusion
financière par les TIC » – s’inscrivait en droite ligne des innovations que la BRH ne
cesse de promouvoir de manière à contribuer à la croissance soutenue de l’économie
haïtienne.
Et nous voici en 2020, où le monde entier se retrouve à porter des réponses à une
pandémie qui a tout chaviré sur son passage. Notre pays n’est point épargné non plus,
ce qui, cette année, a placé le fléau au centre de la réflexion au Sommet de la
Finance, à travers le thème retenu : « Le COVID-19 : financer la réponse et préparer
l’après-crise ». De plus, le virus a aussi exigé, pour l’organisation de l’évènement,
l’adoption du format virtuel, seul propice à l’observance effective de la consigne de
distanciation sociale.
Cela dit, les organisateurs auraient pu maintenir le format présentiel coutumier de la
conférence, en décalant sa tenue de quelques mois. Cependant, une telle décision eût
perturbé la longue et efficace pratique d’organisation du Sommet au mois d’avril.
De plus, vu que la moitié de la communauté mondiale se retrouve confinée au moment
où se déroule l’édition de 2020, il était raisonnable d’estimer que celle-ci puisse être
visionnée par un très large public qu’il aurait été impossible d’accueillir dans une salle
de conférence.
Il faut retenir aussi la réalité de l’absence certaine de la majorité de ces participants
virtuels qui, si le Sommet arrivait à se tenir en présentiel vers la fin de l’année,
devraient engager des coûts importants de déplacement et d’hébergement associés à
un voyage en Haïti.
Nous voici donc, Mesdames et Messieurs, virtuellement réunis pour explorer quelques
pistes de réflexion sur une pandémie qui nous engage dans un combat collectif pour la
survie. Je partage donc avec vous mes propres réflexions, qui incluront deux volets.
D’abord, les difficultés liées à la pandémie, les conséquences pour l’économie et les
contraintes pour les politiques publiques. Ensuite, les enseignements et les leçons à
tirer de la crise.
Sur le premier point, j’aimerais souligner que nous faisons face à une crise à laquelle
aucun pays n’était vraiment préparé. Cette impréparation est encore plus patente dans
les pays en développement, dont la situation sociale et sanitaire souffre de déficiences
qu’expliquent les faiblesses de la sécurité sociale et des infrastructures de santé.
Chez nous, en Haïti, ce panorama social et sanitaire se déploie dans un contexte
d’épisodes récurrents d’instabilité politique, lesquels furent nettement plus prononcés
au cours des deux dernières années. Les effets de cette crise politique sont
désastreux pour la performance économique, comme en témoignent la dépréciation
continue de la monnaie nationale, un niveau d’inflation proche de 20% et la contraction
de 0.5% du PIB en 2019.
À cela s’ajoute une succession de catastrophes naturelles, dont certaines majeures,
surtout au cours des décennies 2000 et 2010. Il en est résulté des pertes en capital
importantes, évaluées par la Banque Interaméricaine de Développement et la Banque
mondiale à 120% du PIB en 2010 (le tremblement de terre) et 32% du PIB en 2016 (le
cyclone Mathieu). Cette accumulation de chocs négatifs nous laisse, de nos jours, aux
prises avec une crise humanitaire dont une caractéristique première est la situation
précaire de 4,6 millions d’Haïtiens nécessitant une assistance humanitaire d’urgence.
Voici donc, Mesdames et Messieurs, l’état dans lequel la grave crise sanitaire du
COVID-19 a trouvé notre pays.
Qu’avons-nous déjà fait pour juguler cette crise ?
Que pouvons-nous faire de mieux, vu les circonstances que je viens de décrire ?
Pour enrayer la pandémie, le gouvernement haïtien a décrété l’état d’urgence sanitaire
avec le confinement de la population, la fermeture des écoles, un couvre-feu, la
réduction des heures de travail en présentiel, des restrictions de circulation, la
fermeture des magasins pour les produits non essentiels, celle des frontières, et enfin
l’interdiction du trafic aérien, sauf pour les vols commerciaux et humanitaires.
Quant au confinement, le gouvernement haïtien a opté pour une application partielle,
faisant confiance à la compréhension et à la solidarité des citoyens pour mettre en
pratique les gestes barrière. Un comité scientifique a été mis en place afin de définir la
stratégie du gouvernement dans la lutte contre l’épidémie.
À date, les résultats des tests effectués par le MSPP indiquent un faible indice de
contagion dans le milieu haïtien. Mais les scientifiques restent inquiets, et une partie
de la population, incrédule.
Les mécanismes de soutien offerts par le FMI et d’autres bailleurs de fonds
internationaux devraient permettre au gouvernement de dégager de nouvelles
ressources pour lutter contre le corona virus. Cependant, même les pays dotés de
moyens financiers importants ont été confrontés à des difficultés certaines en matière
d’approvisionnement en équipements sanitaires.
En temps normal, on est en présence d’un oligopsone, l’État étant le seul acheteur
face à une offre abondante provenant de fournisseurs mis en concurrence sur le
marché. Dans la situation actuelle, les règles d’engagement semblent avoir été
modifiées dans la mesure où il apparaît que les fournisseurs imposent leurs conditions
aux États. Ainsi, les fournisseurs qui détiennent des stocks stratégiques alimentent la
spéculation et font augmenter les prix au détriment des pays les plus démunis.
De son côté, la BRH a mis en œuvre un ensemble de mesures visant à alléger les
contraintes qui pèsent sur le système financier. Ces mesures consistent notamment :
• à réduire le taux d’intérêt directeur et les coefficients de réserves obligatoires sur les
passifs libellés en gourdes et en devises étrangères des banques commerciales ;
• à diminuer le coût d’accès à la liquidité pour les banques à travers la baisse du taux
de prise en pension des bons BRH et la suspension des frais relatifs aux
virements interbancaires pour les clients ;
• à limiter temporairement les coûts de transaction pour les clients en décalant les
remboursements des prêts ;
• à relever les limites applicables aux transactions de la Banque à Distance.
Évidemment, ces mécanismes de soutien à l’économie pourraient se révéler
insuffisants en fonction de l’ampleur de la crise, mais le gouvernement pourra, le cas
échéant, mobiliser les ressources budgétaires disponibles en vue d’atteindre les
couches les plus vulnérables et de compenser, par la même occasion, une éventuelle
baisse de la demande.
Mais déjà, le gouvernement a pris quelques mesures pour sinon alléger la charge
fiscale, du moins pour l’étaler dans le temps.
Parmi les mesures envisagées, les plus importantes sont les suivantes :
• décaler les paiements de l’impôt sur le revenu pour les entreprises et les particuliers ;
• surseoir aux amendes et pénalités dues au retard de paiement, jusqu’au 30 juin
2020 ;
• transférer du pouvoir d’achat à 1,5 millions de familles de 5 à 6 personnes ;
• subventionner 100.000 enseignants du secteur privé et professeurs d’université ;
• faire une distribution massive de kits alimentaires ;
• prendre en charge les salaires de plus de 55.000 employés de la sous-traitance dans
le secteur textile ;
• accorder une prime spéciale au personnel soignant des hôpitaux et aux forces de
l’ordre ;
• subventionner le secteur du transport.
Ces mesures peuvent avoir un impact positif sur la demande, à travers la
consommation des ménages. Sur le court et même le moyen terme, elles pourraient
aussi avoir un effet de compensation sur une éventuelle baisse des transferts sans
contrepartie qui alimentent la consommation.
Cela dit, les difficultés sont nombreuses sur le plan humain.
La première difficulté est le déni de la réalité circulant dans des secteurs de la
population. Exprimé par de l’incrédulité, ce déni tend à limiter la portée du confinement
et à favoriser une propagation silencieuse de la maladie. L’actualité nous l’a rappelé, il
y a une semaine, lorsque des riverains avaient pénétré de force dans un établissement
hospitalier des Côtes-de-Fer pour récupérer un malade infecté par le COVID-19.
La deuxième difficulté est la peur de la stigmatisation qui pourrait porter certains
malades à s’isoler, favorisant ainsi des foyers de contamination difficiles à détecter, à
l’instar de ce qui s’était passé en Équateur.
Ce déni et cette peur recèlent des risques importants, en termes surtout de
propagation de la maladie, et les conséquences pour l’économie ne tarderont pas à se
faire sentir.
Au niveau du secteur réel, les mesures de la Banque Centrale, alliées à celles du
Ministère de l’Economie et des Finances et des Ministères sectoriels, devaient
permettre de mitiger l’impact de cette double crise sanitaire et économique sur notre
posture de croissance.
Nous travaillerons donc à minimiser les coûts liés à cet environnement délétère et à
créer les conditions les meilleures pour un rebond que nous voudrions robuste et
durable. Cette logique veut que nous nous situions dans un horizon de futur proche
pour optimiser les facteurs capables de porter cette perspective dans le domaine du
faisable.
L’amplification d’activités de production de nature autocentrée, notamment dans les
filières du secteur primaire devrait permettre d’aboutir à cet objectif.
De ce fait, la baisse prévue des transferts sans contrepartie, devrait trouver, dans un
certain regain de l’offre local de biens (non échangés), une contrebalance dans la
baisse de la demande de devises assortie à la demande correspondante de biens
d’importation.
La prolongation des conditions adverses au comportement des transferts, telle que
prévue par la Banque Mondiale, devrait trouver un effet contre cyclique dans cette
posture de la production locale que nous gagnerons à systématiser. Voici le cas de
figure que nous voulons promouvoir et adapter pour dégager des éléments
d’opportunités de la crise actuelle.
Mesdames et Messieurs,
La crise sanitaire du COVID-19 doit être pour nous l’opportunité de réfléchir sur le
problème fondamental qui renvoie à notre capacité à gérer efficacement les situations
de pénurie. Par rapport à cet aspect de la crise, les leçons à tirer sont multiples. Par
exemple, les difficultés d’approvisionnement en équipements sanitaires appellent à des
solutions, à la fois innovantes et à coûts réduits, prises sur la base d’arbitrages rapides.
En effet, en dépit des décaissements effectués par le Trésor public de façon autonome, les
pouvoirs publics se trouvent confrontés aux difficultés d’approvisionnement et à
l’augmentation des coûts qui découlent notamment du transport de ces équipements. Le
défi étant l’obligation d’avoir tout ce qui est nécessaire avant le pic de la pandémie afin
d’éviter la saturation des hôpitaux déjà non suffisamment équipés.
La BRH, de concert avec le Ministère de l’Economie et des Finances, a tout fait pour
qu’Haïti bénéficie du soutien financier du FMI et des autres bailleurs de fonds
internationaux.
Ces engagements sont parfois lents à se matérialiser, alors que l’urgence de la situation
nous oblige à agir sans attendre.
Il apparaît donc clairement que nous devons mettre en place la permanence de stratégies
viables pour trouver des solutions adaptées aux crises exceptionnelles comme celle du
COVID-19.
L’outil budgétaire en est une composante majeure. Le développement de budgets pluri
annuels viables devrait nous permettre de sortir du carcan du PPTE (Pays Pauvres Très
Endettés) et d’améliorer notre capacité d’emprunt sur les marchés financiers lorsque des
situations exceptionnelles comme la pandémie actuelle nous obligent à élargir rapidement
nos options de financement des dépenses sociales.
C’est aussi à ce prix que les politiques publiques pourront limiter les atteintes de cette
nature au pouvoir d’achat de la gourde et renforcer leur crédibilité pour affronter de
nouveaux défis.
Je vous remercie de votre attention et je déclare ouvert le Sommet International Virtuel de
la Finance et de la Fintech de 2020
Jean Baden Dubois
Gouverneur


Monsieur le Gouverneur Adjoint,
Madame, Monsieur les Membres du Conseil d’Administration de la BRH
Mesdames, Messieurs les Représentants de la BID
Mesdames, Messieurs les PDG, Directeurs Généraux et Représentants du secteur financier,
Mesdames, Messieurs les Directeurs et Cadres de la BRH,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil Consultatif et du Comité scientifique du FRD-BRH,
Mesdames, Messieurs les représentants d’universités,
Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile,
Mesdames, Messieurs,
La Banque de la République d’Haïti (BRH) éprouve un vif plaisir à vous accueillir aujourd’hui. Le personnel de l’institution se joint à moi et à mes collègues du Conseil d’Administration pour vous remercier d’avoir fait le déplacement. Nous voulons voir dans votre présence ici un signe de l’importance que revêt à vos yeux le lancement officiel du Fonds BRH pour la Recherche et le Développement, le FRD-BRH. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue.
Je m’empresse de saluer la présence parmi nous du Ministre de l’Économie et des Finances et celle du Ministre de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle.
Le premier, pour le gage d’une collaboration fructueuse, en matière de financement de la recherche, entre la Banque Centrale et le Ministère de l’Économie et des Finances, les deux institutions conjointement responsables d’un cadre macroéconomique porteur de croissance et créateur de richesse.
Le second, pour l’attente que nous fondons dans le rôle de creuset institutionnel qu’assume le ministère de l’Education Nationale qu’il dirige en matière de production ouverte du savoir. J’étends cette expression de bienvenue aux représentants des autres institutions étatiques dont les apports contribueront au développement du Fonds et qui attendent, à ce titre, les retombées positives des activités de recherche futures pour les politiques publiques dont elles ont la charge.
Je remercie les membres de la communauté académique et scientifique qui ont fait le déplacement. L’espace que nous accommodons aujourd’hui est le leur. L’affirmation d’un tel espace dépendra des intérêts qu’ils auront manifestés dès aujourd’hui et, davantage encore, dans un avenir proche pour faire du Fonds cette entité à succès dont nous attendons tous des résultats mesurables.
Je les enjoins à se l’approprier rapidement pour en faire un pont solide entre les préoccupations du savoir, les pratiques du savoir-faire et les politiques publiques éclairées qui devront les couver.
Je salue avec emphase les représentants des institutions de la coopération internationale dont certaines, comme la BID, se sont manifestées dès les premiers moments de mise en œuvre du Fonds BRH pour la Recherche et le Développement
Permettez-moi finalement d’exprimer la joie que nous avons d’accueillir les représentants du secteur privé, auxquels nous associons les autres membres de l’auditoire pour la mise en commun des énergies au profit du développement. Nous voudrions, à travers eux tous, inviter l’ensemble des acteurs sociaux à s’approprier d’emblée les activités du Fonds en tant que bien public.
L’honneur que vous nous faites de votre présence est réconfortant dans une société jusqu’ici centrée sur des préoccupations économiques de survie. J’apprécie pour son pesant d’or le message que charrie cette manifestation d’intérêt que nous interprétons comme suit: « Nous avons une société au ressort encore solide à l’image de cette jeunesse foisonnante de capacité créatrice. »
Comment canaliser cette énergie vers des voies de transformation porteuse de développement ? Voilà le type de questions auxquelles la réflexion et la recherche devront répondre pour justifier les fonds qui leur seront alloués dans un environnement où les ressources financières sont rares.
Mesdames, Messieurs, Avant d’entrer dans les considérations qui ont conduit à la création du Fonds BRH pour la Recherche et le Développement, permettez-moi de saluer l’intérêt manifesté pour ce projet tant par le Conseil d’Administration précèdent, que par l’actuel Conseil. Qu’il me soit permis de remercier également tous les cadres qui ont fait un travail de premier ordre, depuis la conception jusqu’au lancement du Fonds, dont les activités de recherche devront aussi servir à éclairer l’orientation de la politique monétaire de la BRH au profit d’une croissance plus robuste et durable.
La création du FRD-BRH fait suite à des réflexions très poussées, datant de plus de 2 ans, sur les handicaps à la croissance et au développement du pays. Ces réflexions avaient permis de renforcer l’hypothèse selon laquelle l’absence de données scientifiques dans la compréhension de certains problèmes ou de certains phénomènes, expliquait, pour la plupart, l’échec observé dans les prises de décision ou dans les solutions envisagées.
L’université a en général une double vocation de formation et de recherche. Cependant, on note une certaine faiblesse en matière de production scientifique en Haïti. Faiblesse qui n’est certainement pas imputable à une insuffisance de ressources humaines qualifiées, mais plutôt :
- à un manque d’efforts coordonnés au niveau des compétences existantes pour promouvoir la recherche ;
- à une culture de recherche peu développée dans les universités et dans le milieu professionnel ;
- à une absence de fonds disponibles pour financer des activités de recherche scientifique.
Ceci dit, il est louable de constater que certaines institutions ou établissements d’enseignement supérieur continuent de tenter, à travers des études, d’alimenter la recherche scientifique. Cependant, la plupart de ces travaux ne permettent pas d’aborder véritablement les problèmes cruciaux que connaît le pays, tant au niveau des politiques publiques qu’à celui du développement économique et social. D’où le besoin de créer les bases d’un espace institutionnel préposé à la production de travaux de recherche orientés vers la compréhension des phénomènes économiques et sociaux dans une société en quête de transformation profonde.
Mesdames, Messieurs,
L’importance de la recherche scientifique dans l’avancement de toute société n’est plus à démontrer. Par exemple, dans les années 1990, avec les avancées dans le domaine de la politique publique en Angleterre, on a compris que la formulation de solutions durables à des problèmes publics – ou la prévention de ces derniers – passe d’abord par des données ou des informations scientifiques. Ce qui avait stimulé la prolifération de laboratoires de recherche et développement et la création de bon nombre de ‘’Think Tank’’ dans beaucoup de pays d’Europe, de l’Asie et du Pacifique.
Aujourd’hui, la production de données ou d’informations scientifiques relatives aux problèmes socio-économiques que confronte Haïti doit permettre, non seulement de mieux aborder les programmes de renforcement de nos institutions, mais aussi de mieux formuler les mesures de politiques publiques capables de poursuivre véritablement l’atteinte des objectifs de développement durable. De plus, les universités doivent jouer un rôle plus proactif dans l’établissement d’un cadre conceptuel de réflexion autour de la problématique de mise en œuvre de ces politiques publiques, pour la prise de décisions stratégiques et l’instauration d’un processus de développement intégré et inclusif.
C’est fort de ces considérations que la Banque de la République d’Haïti (BRH), consciente de la contribution de la recherche dans la quête d’une croissance économique soutenue et inclusive, a mis sur pied le Fonds pour la Recherche et le Développement (FRD-BRH).
Ce Fonds mobilisera à la fois des ressources publiques et des ressources privées, en vue de financer toute initiative de recherche jugée d’un grand intérêt pour la société dans les domaines de l’économie, de la finance, de la gestion des politiques publiques, dans les disciplines connexes et dans d’autres sciences sociales.
Il s’agira pour la BRH, par cet acte, de revitaliser la culture de la recherche dans les espaces universitaires, de stimuler des recherches collectives, de promouvoir la production et la transmission de connaissances scientifiques, tout en créant une synergie entre ceux qui s’intéressent à la recherche et au développement. Il n’en demeure pas moins également que l’apport des professeurs, universitaires, étudiants et chercheurs en général pourra être ainsi mis en commun, au bénéfice d’une meilleure approche dans l’élaboration et la mise en œuvre de bonnes politiques publiques.
En résumé, ce Fonds BRH pour la Recherche et le Développement a un double objectif :
- D’abord encourager la recherche scientifique en Haïti à travers le financement de projets de recherche dans diverses disciplines ;
- Ensuite, mettre en place une structure devant susciter des initiatives de politiques publiques ou de projets d’investissement, notamment dans les secteurs prioritaires pour la BRH et ou l’Etat Haitien, sur la base de la production de données ou d’informations issues de la recherche scientifique.
Mesdames, Messieurs,
La question de la gouvernance du Fonds a fait l’objet d’un traitement minutieux qui couvre sa structure de gestion, la procédure de soumission des demandes de financement, les critères de sélection des dossiers de candidature, la capitalisation et le renflouement des ressources financières, la politique de coopération internationale et la stratégie de communication. Il y va de la pérennité même d’une instance dont la crédibilité est cruciale pour l’avenir immédiat de la recherche en Haïti.
L’acte constitutif du Fonds est scellé dans une résolution du Conseil d’Administration de la BRH. Sa mission principale est:
a) de promouvoir et d’appuyer la recherche appliquée dans diverses disciplines, principalement en économie, en finance, dans d’autres disciplines connexes et éventuellement d’autres sciences sociales ;
b) de développer la recherche scientifique dans le milieu universitaire.
Pour mener à bien sa mission et travailler à la réalisation de ses objectifs, le Fonds est doté d’une structure de gouvernance composée de quatre (4) entités:
- Le Conseil d’Administration de la BRH qui assure la fonction de Conseil d’Administration du Fonds.
- La Direction Exécutive qui est chargée de la gestion quotidienne du Fonds.
- Le Comité Scientifique qui assure la viabilité du processus complexe de validation des activités de recherche.
- Et le Conseil Consultatif qui est chargé de renforcer la gouvernance du Fonds de Recherche. Ce Conseil est composé d’un Représentant du Ministère de l’Economie et des Finances, d’un Représentant de l’Université, d’un Représentant du Forum Economique du Secteur privé et d’un Représentant des bailleurs ayant contribué au Fonds.
La procédure de soumission des demandes de financement bénéficiera des dernières avancées technologiques dans le domaine. Les critères retenus, pour analyser les dossiers de soumission sont les suivants:
- L’intérêt du projet de recherche, en termes d’objectif de caractère d’innovation;
- Sa pertinence, en termes d’impact potentiel sur la société en général et de capacité à susciter des initiatives de politique publique;
- Sa faisabilité, en terme d’analyse coût-bénéfice et de crédibilité du calendrier de la recherche, entre autres;
- La qualification et les compétences de l’équipe de recherche
L’approche du basket fund sera utilisée pour procéder à la capitalisation du Fonds de Recherche. Ce basket fund sera alimenté par:
? La BRH
? Le Ministère de l’Economie et des Finances
? Et le Secteur Privé
Le Fonds s’ouvre également à des financements externes provenant de bailleurs internationaux ou d’institutions nationales à partir de dons directs ou d’un partenariat public-privé. En ce qui concerne la politique de coopération du Fonds, il faut dire que ce dernier est ouvert à des partenariats avec toute institution régionale ou internationale manifestant un intérêt pour la promotion de la recherche scientifique en Haïti.
Le partenariat avec une institution internationale ou régionale pourra être effectué à trois (3) niveaux :
- L’institution
peut décider :
- d’octroyer un don destiné à la recherche dans un domaine bien spécifique, tout en restant dans le champ des domaines préconisés par le Fonds;
- d’octroyer un don qui peut être utilisé pour la recherche dans n’importe quel domaine couvert par le Fonds ;
- d’alimenter le Fonds par un support financier sur une base régulière préalablement définie à travers un accord avec la Banque de la République d’Haïti (BRH) ;
De plus, des partenariats peuvent être établis avec des instances internationales sur un horizon convenu entre les deux parties, et d’autres types de partenariat peuvent être établis sous forme d’appui technique ou d’apport en industrie au Fonds.
Mesdames, Messieurs
Avant de conclure, il est important pour moi de souligner, quitte à me répéter, que le Conseil d’Administration reste très accroché à la pérennisation, la viabilité et la crédibilité de cette initiative à travers des principes fondamentaux d’éthique, de bonne gouvernance et de transparence. Cette transparence sera manifestée sur plusieurs formes, dont notamment:
- L’accessibilité du grand public, à travers le site web du Fonds, aux informations relatives au fonctionnement du Fonds, à ses activités et aux appels à proposition;
- La publication des rapports de reddition de compte;
- Et l’audit annuel du Fonds par des auditeurs à la fois internes et externes.
La BRH, en tant qu’entité publique, se réjouit de pouvoir mettre ce Fonds, premier en son genre dans notre pays, à la disposition de la communauté scientifique haïtienne afin de promouvoir toutes activités de recherche adressant un problème crucial au bénéfice du développement durable et inclusif du pays.
Nous espérons que d’autres institutions publiques ou privées vont nous rejoindre, par le biais de mise en œuvre de structures similaires ou à travers des formes de partenariat avec nous, pour l’avancement de la chaîne de production scientifique en Haïti. Certains pays sont connus pour le talent de leurs ingénieurs et l’habileté de leur main d’œuvre. Notre pays est connu pour sa créativité artistique et sa production littéraire. Aujourd’hui, nous devons travailler d’arrache-pied pour que la nation haïtienne soit reconnue pour la portée de ses publications universitaires et la clairvoyance des décideurs publics et des entrepreneurs privés.
L’ampleur des défis à relever nous y oblige et la tâche est exaltante. L’aventure commence à peine, la route est longue et il n’y a pas de ligne d’arrivée dans le domaine de la recherche scientifique.
Que Dieu nous benisse tous ! Que Dieu benisse Haiti !


Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances,
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale
Monsieur le Gouverneur
Madame, Messieurs les Membres du Conseil d’Administration de la BRH
Madame, Messieurs les Représentant de la BID
Mesdames, Messieurs les Membres de la communauté Internationale
Mesdames, Messieurs les PDG, les Directeurs Généraux et Représentants du secteur financier
Mesdames, Messieurs les Directeurs et Cadres du Ministère de l’Economie et des finances
Mesdames, Messieurs, les Directeurs et Cadres de la BRH,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil Consultatif et du Comité scientifique du FRD-BRH
Mesdames, Messieurs les Recteurs et représentants d’universités,
Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile,
Mesdames, Messieurs
L’histoire des sociétés humaines est aussi celle des institutions qui les façonnent. Mieux encore, il y a de ces institutions qui ont une portée de civilisation. La Banque Centrale est de ce rang là. Aujourd’hui, la nôtre, la Banque de la République d’Haïti, ouvre une dimension nouvelle dans son champ d’action en se dotant du Fonds-BRH pour la Recherche et le Développement.
La nature des activités de Banque Centrale et la capacité à générer l’effet de crédibilité qui en fait la force, font de la Recherche un domaine privilégié d’intérêt pour cette institution. A ce titre, la cérémonie du jour, marque un tournant majeur dans la quête inlassable de modernité de la BRH qui vient de boucler quatre décennies d’une existence riche en événements à succès.
Vous comprenez donc l’émotion qui traverse mes propos et le plaisir que j’éprouve à renouveler les salutations adressées, avant moi, par le Gouverneur, à ce public de choix que vous représentez. Je remercie les représentants du secteur privé et des institutions étatiques de nous honorer de leur présence et ceux de la coopération bilatérale et multilatérale de répondre avec empressement à notre invitation. C’est une marque d’intérêt qui augure les meilleures perspectives pour le devenir du Fonds pour la Recherche.
Permettez-moi d’adresser une salutation spéciale aux membres de la communauté académique et scientifique. Je remercie avec emphase ceux qui se sont impliqués dans le processus qui a conduit à la mise en place du Fonds, et, par anticipation, ceux qui viendront prendre le train en marche. Il est grand temps, pour l’académique en Haïti, que la recherche ne soit plus un domaine de lointaine curiosité. Il est grand temps de donner un contenu concret à l’idée cardinale que la Recherche est un bien public. Et c’est dans cet esprit que je salue le grand public à travers la présence de chacun des membres de l’auditoire.
Mesdames, Messieurs
La mise en place du Fonds-BRH pour la Recherche et le développement est le fruit de longs travaux de réflexion, d’échanges avec des professeurs et recteurs d’université, de recherche documentaire et d’application pratique qui ont mobilisé, par souci d’efficience, une équipe réduite de cadres dynamiques que je prends plaisir à saluer ce matin en les engageant encore plus sur le défi que représente le futur immédiat et lointain du Fonds. Je veux citer…Max Edouard Mondésir…… Déjà, je suis amplement rassuré par l’entrain qui caractérise actuellement les travaux de mise en opération; une attitude qui cadre parfaitement avec l’enthousiasme qui a caractérisé le déroulement des travaux de mise en place depuis l’instauration des premières séances de travail en mars 2017.
C’est dire l’intérêt qu’ont suscité ces travaux de mise en place dans l’agenda du Conseil précédent. Cet enthousiasme explique également l’empressement de l’actuel Conseil d’Administration à en assurer la continuité. Je n’ai donc pas besoin de forcer la note pour affirmer que sur l’idée d’un Fonds-BRH pour la Recherche et le Développement, la question du « Pourquoi » a fait place, presque sans débat, à la question du « Comment ». Comment mettre en place ce fond, comment le faire fonctionner, comment le financer, comment faire pour en assurer la permanence institutionnelle ?
A la vérité, le principe cardinal de voir dans la recherche un bien public doté d’un facteur intrinsèque d’externalité positive n’avait pas besoin de faire son chemin. Les échanges ont porté surtout sur le poids envahissant du vulgaire dans une société trépidante de jeunesse qui a aussi besoin de vulgarisation pour faire un saut conscient, donc sans aliénation, dans la modernité. La recherche dans notre Haïti en mal de développement est donc de cette essence capable d’alimenter les créneaux de communication, non pas en certitudes issues de pratique d’apprentis-sorciers, mais en vérités, en toute relativité, basées sur une dynamique de questionnement sans complaisance.
Il peut s’agir d’une démarche volontariste ou d’une approche sans prétention coercitive, voire libérale. Peu importe le label idéologique qui sous-tend ce besoin de vulgarisation. La recherche doit avoir droit de citer selon une logique autonome de reproduction et de diffusion pour donner aux élites les outils de réflexion pour l’action et développer au sein des masses des réflexes portés par des faits scientifiques et sociétaux bien établis et en constant renouvellement. Aussi dans l’environnement, qui est le nôtre, de ressources plus rares qu’à l’accoutumée, l’efficience nous impose de voir dans la Recherche un domaine de production de connaissance renouvelée et de vulgarisation sans barrière pour fonder les actions à tous les échelons de décisions des acteurs sociaux.
Si le cycle de la Recherche ; dans ses mission de production, de diffusion, de recyclage et de reproduction de la connaissance; sait transcender l’idéologie ; Si l’effort de politiques publiques est suffisant pour créer des conditions de perméabilité des couches sociales aux idées et aux faits que charrie la recherche ; Si le minimum de conditions objectives est rempli pour créer les effets de transformation des comportements et des mentalités ; La recherche aura joué son rôle de raccourcie dans la quête de développement et aura mérité au centuple son appellation de bien public. La rentabilité socio-économique des ressources allouées sera d’autant plus forte que la période de ce processus transformationnel sera courte.
Voici donc la nature des réflexions qui nous valent aujourd’hui la jeune existence du Fond-BRH pour la recherche et le Développement. Bien sûr, les considérations sur le déficit des ressources allouées aux activités de Recherche dans le pays ont pesé dans la balance. Nous avons également fait le tour, il est vrai non exhaustif, des expériences de nos devanciers que nous prenons d’ailleurs plaisir à citer. Le Fond RED( )…, le CIRAD( )…, Le département de la Recherche du CTPEA mis en place dans la deuxième moitié de années 1980 par une équipe qui avait à sa tête Pierre Richard Agénor et qui a publié dans les Cahiers de Recherche du CTPEA, nombre d’études de poids sur la planification macroéconomique en Haïti, la question fiscale et la modélisation du marché des changes. Cette démarche documentaire n’est pas sans conséquence sur le profil que nous avons décidé de donner au Fonds dans l’état actuel de son existence.
Mesdames, Messieurs,
Le Fonds BRH pour la Recherche et le Développement a été créé en date du 20 février 2019 par Résolution du Conseil d’Administration dans le but de financer des projets de recherche principalement dans les domaines de la gestion des politiques publiques, de l’économie, de la finance et d’autres disciplines connexes. Au-delà des considérations de rareté de ressources, la BRH a trouvé opportun de donner aux activités du Fonds un caractère immédiatement utile tenant compte de ses missions de banque centrale et des aspects qui touchent aux préoccupations de ses partenaires de l’Etat et de la coopération externe. L’intangible que représente la crédibilité de l’institution a été l’élément préalable de dotation que nous avons mis dans la balance.
Nous voulons remercier les institutions partenaires qui ont rapidement soupesé le poids de cette dotation de départ pour cheminer avec nous et ouvrir la voie à un champ nouveau de coopération dans un domaine qui a pris toute sa dimension conceptuelle depuis une dizaine d’années avec les travaux de Etzkowitz de l’Université de New Castle et de Leydesdorff de l’Université d’Amsterdam sur le rôle de la trilogie Université-Entreprise-Etat dans l’ère nouvelle de l’économie de la connaissance. Il est grand temps d’exploiter le principe de la triple hélice au profit d’une économie haïtienne coincée, depuis quatre décennies entières, dans une trappe à la croissance molle pour rester dans la logique encore complaisante du professeur Charles Cadet.
Je remercie les recteurs et professeurs : Samuel Pierre, ….…… qui sont parmi les premiers d’une liste plus large de responsables académiques qui ont manifesté leur volonté de collaborer. Nos remerciements vont plus amplement à la BID qui a embrassé dès le départ cette initiative dans le sillon d’une coopération déjà agissante dans le domaine de la production de connaissance. C’est l’occasion pour moi de saluer cette coopération qui a fait naitre le DSGE (…), et les productions conjointes qui ont fait l’objet de présentation à succès dans le cadre des mercredis BRH/BID. J’en profite pour annoncer avec reconnaissance la décision de la BID de faire un don financier au FOND sur les deux premières années de son fonctionnement.
La première année d’existence du Fonds verra les gestionnaires s’atteler à développer en priorité deux pans d’activités vitales pour le devenir de cet outil: (1) La mise en place progressive mais sans relâche d’une clientèle académique viable en qualité et en quantité pour asseoir les bases d’une production qui répondent aux attentes du Conseil d’Administration du Fonds. (2) La concrétisation des promesses de coopération qui ont vu le jour au cours de la période de mise en œuvre des activités du Fonds et la prospection de nouvelles voies de coopération. Ce deuxième volet est d’autant plus important pour la pérennisation du Fonds qu’il est générateur d’un double domaine de ressources financières et humaines. Aussi, permettez-moi de citer les autres acteurs déjà engagés dans ce champ de coopération ou en voie de l’être :
- L’Ambassade de France à travers la bourse BRH–Ambassade de France-Groupe Parlementaire Haïti France et bientôt un appui de la BRH et de l’Ambassade de France à la mobilité doctorale
- la Compagnie De LA Rue, Chevening à travers des programmes de bourses d’excellence
- FMI…qui nous a donné accès aux nombreuses ressources de sa bibliothèque
- Cirano
Mesdames, Messieurs,
L’aspect lié à la gouvernance du Fonds-BRH pour la Recherche et le Développement, comme l’a souligné le Gouverneur, a été traité avec un niveau de préoccupation qui tient de la parcimonie. La quantité d’heures allouées à ce volet représente la part la plus importante de la charge de travail mobilisée dans la mise en place du Fonds. La nature technique des travaux qui ont porté sur le développement des fonctionnalités du site internet a nécessité un processus itératif fastidieux pour répondre aux critères de transparence et de commodité d’utilisation pour les prochains usagers. Dans ce domaine, les recherches sur les <best practices> ont inspiré une collaboration harmonieuse entre le champ informatique et celui de la gestion pour asseoir un niveau satisfaisant de crédibilité dès les premiers moments de fonctionnement du Fonds. Il y va de la pérennisation d’une activité que nous espérons voir sortir des préoccupations restreintes d’une banque centrale pour atteindre assez vite les dimensions institutionnelles d’un domaine essentiel au développement.
Nous n’insisterons donc jamais assez sur le caractère essentiel de cet aspect dans le devenir du Fonds. L’intérêt manifesté par nos partenaires du milieu académique, de l’Etat et de la coopération externe est lié, dans notre entendement, à cette attente à laquelle nous entendons répondre au mieux de nos capacités. Il a fallu, d’ailleurs, opérer un arbitrage serré entre l’idée de repousser le lancement du Fond seulement au terme de la finition complète de son site internet et celle de procéder à un lancement plus précoce que déjà la conclusion assez satisfaisante de la phase I du site justifie. Comme vous le vivez avec nous aujourd’hui, la décision finale a porté sur le second choix. La logique étant de faire de ce lancement non pas un test de grandeur nature de cette activité qui est maintenant nôtre, mais d’avancer sans coup férir, dans une entreprise qui ne peut que bénéficier d’une courbe d’apprentissage que nous voulons rapide mais conforme à un processus de maturation bien orchestré.
Je vous invite donc à vous consulter le site internet du Fonds pour vous imprégner, entre autres, des objectifs poursuivis et des modalités de fonctionnement de cet outil qui vous sera présenté brièvement au cours de la matinée. Je ne puis néanmoins me soustraire à l’idée de vous faire un rappel de la structure de gouvernance qui est composée de quatre entités : (1) le Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haïti (2) La Direction Exécutive (3) Le Conseil Scientifique (4) Le Comité Consultatif.
Les trois premières entités sont importantes pour le fonctionnement harmonieux du Fonds. Elles en assurent l’efficacité interne et la pérennité. Par contre le Comité Consultatif est crucial pour le développement des rapports du Fonds avec le reste de la société. Il est l’instance qui connecte directement le Fonds avec les préoccupations économiques et sociales telles qu’elles seront exprimées par la société civile, le secteur des affaires et les entités étatiques ainsi que la vision moyenne des PTF. C’est donc une caisse de résonnance qui permettra d’évaluer la rentabilité socio-économique du fonds. Il en assure donc l’efficacité externe. Nos attentes sur le bon fonctionnement du Comité consultatif sont d’autant plus fortes qu’elles le placent au cœur du principe de la triple hélice comme concept clé dans le développement des rapports Université-Entreprise-Etat.
- L’université comme espace de production et de diffusion de la connaissance en synergie avec les politiques publiques appropriées mises en place par l’Etat
- L’entreprise comme espace privilégie d’utilisation du savoir produit par l’université et de transformation de ce savoir en savoir-faire.
- L’Etat comme domaine de mise en œuvre des politiques de nature macro, méso et micro pour créer les conditions les meilleures de création de richesse et d’emplois par l’entreprise au niveau des marchés.
Voilà l’ambition ultime que charrie le Fonds BRH pour la recherche et le développement. Elle traduit l’idée que l’accumulation de savoirs et leur transformation en savoir-faire est le seul raccourci viable vers le développement durable. C’est essentiellement le crédo qui motive notre action.
Mesdames, messieurs
Nous avons fait le tour de la question du Fonds-BRH pour la Recherche et le Développement. Le plaisir institutionnel que nous tirons est celui de voir la Banque de la République d’Haïti, votre banque centrale, franchir un niveau supérieur de maturité et de capacité qui lui ouvre une audience plus large dans le cercle prestigieux de ses pairs. Le vœu que nous caressons est de voir le Fonds inspirer d’autres institutions dans des domaines scientifiques autrement techniques…
Je vous remercie


Au nom du Conseil d’Administration de la BRH, Je voudrais féliciter l’USAID et tous les autres partenaires pour avoir porté le projet “Haïti Invest” jusqu’à cette phase. Nous savons tous la potentialité d’une telle initiative pour nos Petites et Moyennes Entreprises en terme de financement et d’ouverture de marchés.
Ces bienfaits se traduiront par une augmentation du nombre d’emplois en faveur de la jeunesse haïtienne. En effet, Haïti Invest est un autre moyen de favoriser l’investissement en Haïti vers la création de richesse.
Mesdames, messieurs
Nous avons atteint une étape cruciale dans l’implémentation du projet, celle d’avoir des conseillers en transaction aux PME. Je tiens à remercier les organisateurs du projet Haïti Invest d’avoir associé la BRH à la présentation de ces conseillers en transaction aux PME.
Je félicite également la participation des hauts cadres d’institutions partenaires du projet Haïti INVEST qui évoluent dans le domaine de la finance et de l’investissement. Votre apport dans le cadre de l’exécution de ce projet apportera un plus significatif qui pourra entraîner une reprise des activités économiques dans des secteurs spécifiques.
Il faut rappeler que l’évolution de l’activité économique concrétisée par la variation de la production nationale informe sur le niveau de croissance d’un pays dont l’un des principaux moteurs est l’investissement.
En effet, tel qu’illustré par l’économiste Walt
Rostow en 1960, le taux d’investissement, élément de disparité distinguant les
pays en voie de développement des pays développés, caractérise la phase de
décollage d’un développement économique.
La Banque de la République d’Haïti dans son souci d’accomplir sa mission de conduire la politique monétaire d’Haïti et de veiller à la stabilité du système financier national, ne saurait négliger le cadre macro-économique et social dans lequel elle est appelée à agir. De ce fait, la BRH a un rôle à jouer” dans la mise en place et le maintien des conditions nécessaires à la bonne marche de l’économie nationale.
Mesdames et messieurs,
Permettez-moi de rappeler la grande importance de ce programme de l’USAID pour la BRH. En effet, le caractère générateur de croissance de cette initiative s’aligne parfaitement à l’agenda monétaire pour la croissance et l’emploi initié en 2017 par la Banque Centrale. A travers ces différents programmes pro-croissance la BRH vise à promouvoir les secteurs productifs à fort potentiel de valeur ajoutée et à effets multiplicateurs.
Dans cet élan, plusieurs initiatives ont été entamées parmi lesquelles:
- les réunions de concertation avec différents acteurs du secteur agricole;
- les réunions de concertation avec des entreprises faisant partie
de l’association SA SE BUSINESS PAM (SSBP) ;
- Des ateliers sur la bonne gouvernance d’entreprise.
- Le projet de mise en place d’une clinique d’investissement qui devrait utiliser en levier les experts de Haiti Invest. Je me suis fait accompagner de mes deux porteurs de projet dans le cadre de cette Clinique d’Investissement.
- Dans un partenariat avec l’AUF, l’Agence Universitaire Francophone, la Banque de la République d’Haïti a décidé de contribuer à l’insertion économique des Etudiants et diplômés Haïtiens par le financement d’un programme d’incubation et de soutien financier à l’entreprenariat. Nous participons également à la création d’un Réseau Solidaire d’Accompagnement à la Création d’entreprises. (ResACE)
Il est indéniable que les problèmes d’insécurité que nous confrontons aujourd’hui peuvent être attribués à une croissance économique trop faible et qui n’a pas suivi la courbe de croissance de la population. Nous devons impérativement créer des emplois. Si nous échouons à créer ces jobs pour cette jeunesse et cette population…. D’autres créeront des jobs que nous ne souhaiterions pas dans les ghettos et bidonvilles qui ont encerclé la majorité de nos villes.
Il est indiscutable que les Petites et Moyennes entreprises sont vitales pour l’économie haïtienne. Elles représentent plus de 70 % d’emplois générés. Cependant elles se heurtent à de nombreux obstacles dans leur quête de croissance et de création de valeur.
Ces contraintes sont dues au manque d’accès au financement et à son coût élevé. Ces conseillers en transaction acceptent le défi d’être des agents de promotion pour un développement inclusif et durable à travers des outils de financements alternatifs tels que ceux offerts par les marchés financiers.
Mesdames et messieurs,
Permettez-moi de mettre l’emphase sur la nécessité d’innovation dans le secteur économique haïtien à travers les marchés financiers. Ces derniers ont le potentiel d’allouer et de relocaliser des ressources au sein d’une économie afin d’assurer une croissance soutenue. Son impact direct sur le paysage économique d’un pays en fait l’un des éléments clés du développement. Toutefois, pour atteindre son objectif, une infrastructure adéquate et surtout des outils financiers diversifiés tels l’option de financement offerts par Haïti Invest en sont essentiels.
L’un
des défis les plus importants dans le développement économique et des marchés
financiers est le faible nombre
d’entreprises pouvant accéder au financement. Dans cette
optique, à travers son projet de “clinique d’investissement”, la BRH est prête
à accompagner les petites et moyennes
entreprises en facilitant le renforcement de leurs capacités et les doter
d’outils pour les rendre aptes à recevoir différents modes de financements
parmi lesquels ceux
qui seront procurés
par ces (4)
conseillers en
transaction du projet “Haïti Invest”. A travers ces cliniques, nous prévoyons une augmentation du nombre d’entreprises ayant les structures adéquates telles que:
- Structure de gouvernance
- Transparence (des entreprises dotées d’États Financiers conformes aux normes prudentielles nationales et internationales)
- Modèle d’Affaire «Business model» propice.
Mesdames et messieurs les conseillers,
Je vous souhaite déjà du succès dans l’accomplissement de votre mission. Haïti Invest s’annonce être un levier clé pour toucher les entreprises évoluant dans les différents secteurs productifs de l’économie nationale.
La BRH réitère son engagement à travailler en étroite collaboration avec l’USAID pour continuer à canaliser différentes sources de capitaux pour une meilleure inclusion financière.
Je vous remercie!
29 janvier 2020
Madame La Présidente de la Chambre de Commerce des Femmes Entrepreneures
Madame la Représentante de ONU Femmes en Haïti Monsieur le Directeur de l’USAID
Chers Membres de la Chambre de Commerce de Femmes Entrepreneures
Mesdames, Messieurs de la Presse, Chers Invité(e)s
Je tiens tout d’abord à féliciter la Chambre de Commerce des Femmes Entrepreneures d’Haïti (CCFEH) pour la réalisation de ce troisième forum économique des femmes haïtiennes, et, ensuite exprimer mes plus vifs remerciements pour cette invitation faite par l’Organisation à prendre la parole ce matin.
« Quoi qu’elle fasse, la femme doit le faire deux fois mieux que l’homme pour qu’on en pense autant de bien. Heureusement, ce n’est pas difficile. » Citation de Charlotte Whitton.
Je félicite les Organisations comme la vôtre, qui fera en sorte que ce ne sera plus nécessaire que la femme fasse deux fois mieux que l’homme pour qu’on pense autant de bien… Mais Reconnaissons-le. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
Ce Forum fait écho dans un contexte ou plus d’un milliard de femmes sont aujourd’hui exclues des services financiers formels. Il existe un écart de genre de 9% en accès de compte bancaire dans le monde.1 (Global Findex 2017) Parmi les 500 plus grandes entreprises du monde, on ne compte que 33 femmes PDG2. (Forum Economique Mondial Janvier 2020)
Dans la même veine, nous saluons le prix Nobel de l’Économie de l’année 2019, décerné à Madame Duflos, femme travaillant sur des options pour la lutte contre la pauvreté, il se révèle important de prendre des mesures adaptées et innovantes pour lutter contre l’exclusion des femmes.
En Haïti, je ne citerai que cinq (5) chiffres pour parler de la situation des femmes dans l’économie : 51 % de la population des 15 ans et plus sont des femmes3 ; 55% d’entre elles travaillent dans le secteur informel4 . L’image des femmes qui s’attellent dans les marchés est même très caractéristique de l’activité commerciale en Haïti où elles sont à 65 % et à tous les niveaux : la vente, le transport, l’hôtellerie, les services communautaires et l’agriculture.
Il est certain que la valeur du travail des femmes tant au foyer que dans les sphères marchandes est considérable. Selon le PNUD, l’éducation a réussi son pari en Haïti puisque la présence des filles à l’école secondaire est nettement supérieure à celle des garçons (52% vs 48%).
- Global Findex 2017
- Forum Economique Mondial, janvier 2020.
- FinScope 2018
- Livre Blanc du PNUD
Félicitations Mesdames ! Mais encore du travail à accomplir.
Au niveau national, des mécanismes institutionnels et légaux ont été mis en place pour accroître la participation des femmes dans la vie sociale, politique et économique du pays. Permettez-moi de rappeler l’article 17.1 de la Constitution, qui expose clairement que « Le principe du quota d’au moins trente pour cent (30 %) de femmes est reconnu à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics ».
À la Banque de la République d’Haïti, nous pouvons nous enorgueillir pour dire que nous avons dépassé ce quota. Présentes aux différents niveaux de l’Administration : de l’agent de sécurité jusqu’aux membres du Conseil d’Administration, les femmes représentent 32% de l’effectif total des employés de la BRH.
Afin de renforcer la résilience des femmes et de favoriser leur autonomie financière, la BRH supporte de manière institutionnelle l’application du
« Plan d’action de Denarau » qui est un engagement international de l’Alliance d’Inclusion Financière (AFI) dont la BRH est membre depuis 2011.
Ce plan permet d’augmenter le nombre de femmes ayant accès à des services financiers abordables à l’échelle mondiale et à réduire l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’inclusion financière. Ce plan
d’action vise à promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et réglementations intelligentes par les membres du réseau AFI pour créer un environnement propice qui accélère l’inclusion financière des femmes.
Avec le Plan d’action de Denarau (DAP), les membres de l’AFI sont invités à:
- Intégrer les considérations de genre tout en favorisant l’apprentissage par les pairs et en développant des produits ;
- Examiner et mettre en œuvre des politiques intégrées combinant l’inclusion financière des femmes et les stratégies nationales d’inclusion financière ;
- Favoriser le développement des services financiers numériques pour accélérer les progrès ;
- Souligner le rôle des infrastructures financières appropriées telles que les bureaux de crédit et les registres électroniques de garanties ;
- Diriger les questions relatives au genre et à l’inclusion financière des femmes ;
- Développer et promouvoir les meilleures pratiques dans la collecte, l’analyse et l’utilisation de données ventilées par sexe via le groupe de travail sur les données d’inclusion financière ;
- Fixer des objectifs et des cibles spécifiques pour l’inclusion financière des femmes ;
- Appeler les institutions financières et les organisations du secteur à prendre des mesures concrètes pour mieux comprendre le segment du marché féminin ;
- Promouvoir la collaboration avec les agences gouvernementales et la société civile pour identifier les obstacles sexospécifiques à l’inclusion financière – et encourager la collecte efficace de données pour des politiques et des réglementations intelligentes ;
- Accroître la diversité des genres au sein de leurs institutions financières.
Ainsi, en 2019, au Forum Mondial sur les Politiques d’Inclusion Financière au Rwanda, la Banque de la République d’Haïti (BRH) a été reconnue officiellement comme « AFI Gender Inclusive Ambassador ». Cette distinction est reçue en reconnaissance des efforts accomplis par la BRH dans le cadre du Plan d’action de Denarau.
Sur le plan macro-économique, soulignons que depuis quelques années, la Banque de la République d’Haïti, s’est également engagée dans la promotion de l’égalité des sexes à travers son engagement dans la promotion de l’inclusion financière.
Dans le document de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière lancé en 2014, les femmes constituent l’un des groupes cibles et un ensemble d’actions sont définies à travers les piliers afin de favoriser leur accès aux services financiers.
Dans cette Stratégie, les PMEs ont également été identifiées comme groupe cible. Ce qui permet de toucher doublement les femmes car les PMEs sont généralement tenues par les femmes qui représentent 47% des exclus du système financier formel. Seulement 9% des femmes ont un accès à un compte bancaire traditionnel et 43% ont un accès à des services financiers formels 5.
5 Finscope 2018
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Parler de la question des femmes dans l’économie, c’est également parler de besoins, d’argent, de liberté, de valeurs, de préjugés.
Selon les informations que nous avons collectées à travers le Bureau d’Informations sur le Crédit (BIC) en 2018. Les femmes bénéficient de 51% des prêts totaux accordés dans le système financier contre 49% pour les hommes. Cependant, en termes de volume, les hommes reçoivent 70% du montant total accordé et les femmes seulement 30%.
Ceci nous permet d’affirmer que les femmes ont effectivement accès aux crédits mais malheureusement à de faibles montants. L’autonomie économique et financière des femmes, c’est également pouvoir être reconnues comme un être économique à part entière disposant librement de ressources financières pour satisfaire ses besoins ainsi qu’à ceux des personnes dont elles ont la charge.
La BRH, à travers le Programme Pro-Croissance conçu pour inciter la création de richesse, la croissance et l’emploi, a pris des mesures pour faciliter et encourager les institutions à accorder du crédit, à financer des projets qui contribuent à soutenir des initiatives pour l’insertion sociale et économique sans discrimination de sexe. Je profite de l’occasion pour inviter les femmes entrepreneurs à visiter le site www.brh.ht pour s’informer sur ces programmes d’incitations et se tourner vers les banques et institutions financières pour avoir accès aux crédits pour leurs entreprises.
Pour favoriser l’inclusion des femmes dans les institutions financières, il faut la constitution d’une bonne base de données fiable. La BRH a donc pris des mesures pour inviter les institutions à ne pas négliger la collecte et le traitement des données désagrégées par sexe. Ces informations devront contribuer à nous guider dans la prise de décision de politique d’inclusion financière et de mieux orienter nos stratégies en faveur de l’autonomisation financière des femmes.
En espérant renforcer la participation des femmes entrepreneures dans le développement de l’économie nationale, il est important de souligner que le principe de l’équité du genre représente un enjeu crucial pour lutter contre la pauvreté, participer au développement humain et surtout au développement durable.
Il est nécessaire de renforcer la capacité financière des femmes à subvenir à leurs propres besoins financiers mais également favoriser les conditions pour la création de richesse. Pour ce, il est surtout impératif que les politiques économiques, sociaux et culturels soient appliquées sans discrimination de sexe.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Le renforcement de l’entrepreneuriat féminin est une solution de développement économique pour Haïti. Pouvoir exploiter pleinement le potentiel des femmes est critique pour réaliser le développement durable que nous souhaitons tous.
C’est au secteur privé, à travers les différentes lignes de métiers, de jouer son rôle en soutenant la création d’entreprise par des femmes et pour des femmes. Le développement des réseaux de femmes entrepreneurs est plus qu’à encourager !
La BRH profite de l’occasion pour inviter les autres acteurs publics et privés à plaider pour une finance inclusive des femmes.
Que Dieu nous bénisse tous ! Que Dieu bénisse Haïti !
Jean Baden Dubois
Gouverneur
27 Janvier 2020
Madame, Messieurs les membres du Conseil d’Administration de la BRH
Mesdames Messieurs les PDG des Institutions Financières,
Cher Professeur Kigabo Mesdames Messieurs les Économistes
Chers cadres de la BRH
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais d’abord rappeler que la présence du professeur Thomas Kigabo en Haïti, économiste principal à la Banque centrale du Rwanda, témoigne de l’intérêt de la BRH à renforcer son cadre de politique monétaire, par le partage d’expériences entre banques centrales et en recherchant des modèles dont elle peut s’inspirer, tout en tenant compte des spécificités de l’économie haïtienne et des contraintes structurelles qui lui sont associées.
Sa présence témoigne aussi de notre volonté d’établir des rapports d’échange et de partenariat entre Haïti et les pays d’Afrique. Le Rwanda est une nation sœur qui a vécu des périodes difficiles, peut-être encore plus difficiles que celles que nous avons déjà vécues. Les citoyens rwandais ont su mettre de cote leurs différences pour s’atteler à la reconstruction de leur nation. Le Rwanda a pu s’élever aujourd’hui au rang d’une nation modèle que plus d‘un regarde pour s’en inspirer.
Lors de ma dernière intervention publique, j’ai eu à mentionner la citation de Winston Churchill à savoir qu’une « crise est trop importante pour la gaspiller ». Il n’en tient donc qu’à nous Haïtiens et Haïtiennes d’apporter les réponses appropriées pour relever une fois pour toutes les défis à la fois structurels et conjoncturels auxquels nous faisons face.
À la BRH, nos réflexions se portent déjà sur les défis de l’après-crise. Et nous travaillons déjà sur une évolution de l’agenda monétaire pro-croissance vers une approche structurelle d’une transformation socioéconomique.
Les présentations, les discussions et les échanges entre les cadres de la BRH et le professeur Kigabo durant ces trois derniers jours ont été à la fois enrichissants, instructifs et fructueux à divers égards. Ils nous ont permis de :
a) renforcer notre esprit de combattivité face aux difficultés ;
b) de réaliser que le temps, le savoir et le savoir-faire peuvent nous aider à les affronter efficacement ;
c) de comprendre la nécessité de faire valoir la dimension humaine dans nos relations avec les bailleurs de Fonds internationaux ;
d) de mettre Haïti en perspective par rapport aux efforts colossaux indispensables à la stabilisation et à la réhabilitation d’une économie.
Les échanges d’expertise et de connaissances des trois derniers jours ont porté essentiellement sur :
a) le processus d’évolution de la politique monétaire au Rwanda;
b) les projections de liquidités associées au mécanisme de transmission de la politique monétaire au Rwanda.
La BRH a beaucoup appris de l’expérience de la Banque centrale du Rwanda quant à l’évolution de son cadre de politique monétaire après le génocide en 1994, notamment :
1) le ciblage monétaire (1995-2008)
2) le développement du marché monétaire comme prérequis au développement du marché secondaire ;
3) le développement du marché des bons du trésor et l’utilisation d’instruments de politique monétaire de très court terme ;
4) l’harmonisation des politiques budgétaire et monétaire (le policy-mix)
5) l’utilisation de la persuasion morale (moral suasion) pour gérer les anticipations négatives des agents ;
6) le rôle clé de la communication dans la formulation des orientations à l’intention des opérateurs économiques et financiers (indications prospectives ou forward guidance)
7) le passage du ciblage monétaire au ciblage du taux d’intérêt.
Les échanges qui auront lieu au cours de cette journée porteront sur trois sujets d’intérêt pour la BRH à savoir :
1) la recherche ;
2) l’analyse économique ;
3) la modélisation et la prévision à la Banque centrale, avec l’expérience du Rwanda ;
Au niveau de la BRH, la Direction Monnaie et Analyse Économique (MAE), dirigee par notre chief economiste Erol Saint Louis travaille sur tous ces sujets. Elle effectue des prévisions ou des projections sur des indicateurs clés comme l’inflation, la croissance du PIB et la liquidité bancaire.
Sur le plan de la recherche, la BRH entend aller au-delà des publications actuelles en encourageant des travaux de recherche dans le milieu universitaire et professionnel avec la création d’un Fonds BRH pour la Recherche et le Développement (FRD-BRH). Ce Fonds devrait être lancé une fois que la BRH sera en mesure de travailler dans un contexte socio-politique plus apaisé.
En ce qui concerne la direction générale de la politique monétaire, qui est le second point de l’agenda du jour, la BRH travaille sur beaucoup de projets devant redynamiser le cadre de la politique monétaire pour le mettre en adéquation avec le double mandat non hiérarchisé qui lui est confié par la loi : la stabilité des prix et la promotion de la croissance de l’économie.
La mise en place de ces projets devrait conduire la BRH vers :
1) une meilleure utilisation des bons BRH pour des impacts plus significatifs sur le contrôle de la liquidité du système ;
2) l’utilisation d’instruments de politique monétaire à très court terme devant jeter les bases de l’établissement d’un marché monétaire ;
3) l’élargissement des bons du Trésor à d’autres secteurs de l’économie nationale ;
4) le développement d’un marché financier, qui, entre autres, viendra en support à l’élargissement des bons du Trésor ;
5) des partenariats formels avec des Ministères clés, des éléments du secteur privé et avec l’international pour une véritable transformation socioéconomique.
Pour les dirigeants des institutions financières et les économistes présents dans cette salle, je voudrais préciser ce qui suit :
• La BRH conduit une politique monétaire consistant à resserrer les conditions du crédit bancaire en obligeant les banques commerciales à détenir des réserves obligatoires relativement élevées.
• Cependant, parallèlement à cette situation, la BRH accorde certaines exonérations sur les réserves obligatoires relatives aux prêts qui entrent dans le cadre de son programme d’incitation aux secteurs productifs. Ce programme se situe dans le droit fil de l’agenda monétaire pour la croissance et l’emploi que promeut la BRH. Mais, l’effet-volume de la politique monétaire risque d’être compromis sans un effort des autorités budgétaires pour améliorer la qualité des dépenses en mettant l’accent sur les dépenses productives et en particulier, les dépenses d’investissement public qui peuvent avoir un effet d’entraînement sur l’investissement privé.
Face à cette situation difficile, le Conseil d’Administration que je dirige ne restera pas inerte.
En attendant la combinaison judicieuse des politiques publiques, la BRH propose que les bons du Trésor servent de mécanisme de financement du déficit budgétaire.
Le bon BRH constituait jusque-là le principal instrument de reprise de la liquidité bancaire depuis sa création en novembre 1996. Cependant, il s’avère nécessaire de franchir une nouvelle étape dans le mécanisme d’absorption des liquidités excédentaires dans un contexte où les sources alternatives de financement sont à la fois conditionnelles et aléatoires. Cette nouvelle étape consiste à procéder à l’émission des bons du Trésor conformément à l’objectif visé lors de l’introduction du bon BRH.
Le bon du Trésor est considéré comme étant la meilleure option possible parce qu’il est associé à des externalités positives pour les raisons suivantes :
a) à court terme, garanti par la BRH, Il est sans risque pour son détenteur surtout lorsqu’il est indexé à l’inflation ;
b) Il servira de marqueur pour la courbe de rendement tout en conférant une certaine efficacité à l’utilisation des instruments de politique monétaire basés sur les règles du marché;
c) Il permettra de satisfaire les besoins du gouvernement et de réduire l’encours des bons BRH et la charge de la dette externe ;
d) Il permettra de moduler la politique monétaire à travers les instruments de court terme tout en servant d’indicateur pour les perspectives de croissance et d’inflation ;
e) Il pourra être maintenu même en présence de surplus budgétaires qui pourront être utilisés pour rembourser la dette.
Par ailleurs, il est important de préciser que les obligations du réseau routier national introduites vers la fin des années 80 ont été remboursées et que les bons du Trésor seront garantis par la BRH.
Néanmoins, certaines conditions nécessaires à la mise en œuvre de cet instrument ne sont pas tout à fait réunies. Certes, la BRH jouit d’une autonomie opérationnelle, mais elle n’est pas une banque centrale indépendante. De plus, il n’existe pas encore de marché secondaire qui pourrait faciliter le développement de marchés liquides et la transmission des impulsions monétaires.
Conséquemment, la BRH proposera que le MEF travaille conjointement avec elle sur la matérialisation du projet de mise en place des bons du trésor en trois étapes :
1) Une première étape pour la mise en place des procédures du front-office (MEF) et du back–office (BRH);
2) Une deuxième étape consacrant l’entrée en vigueur du protocole d’accord entre le MEF et la BRH pour la mise en œuvre des bons du Trésor ;
3) Une troisième étape pour la mise en place d’un marché secondaire dans le cadre de la transition vers la création d’un marché financier en Haïti.
Ces différentes étapes pourraient figurer parmi les réformes structurelles à mettre en œuvre dans le cadre d’un éventuel programme avec le Fonds Monétaire International.
Face à la conjoncture actuelle, les autorités monétaires resteront vigilantes à tous les nouveaux développements observés dans l’économie nationale et internationale et elles se tiendront prêtes à adopter les mesures appropriées pouvant contribuer à l’amélioration du cadre macroéconomique et financier.
Merci de votre attention!
Excellence Monsieur le Premier Ministre par Intérim
Honorables Sénateurs
Monsieur le Ministre de L’Economie et des Finances
Mesdames/Messieurs les PDG des banques commerciales
Madame/Messieurs les Directeurs Généraux des banques commerciales
Monsieur le Président de l’APB
Messieurs les Présidents des Caisses Populaires
Mesdames/Messieurs les Représentants du secteur privé
Madame/Messieurs les membres du Conseil d’Administration de la BRH
Messieurs les Gouverneurs et les anciens membres du Conseil d’Administration de la BRH
Mesdames/ Messieurs les Représentants de la presse
Chers amis
Chers invités
Mesdames Messieurs,
Je suis particulièrement honoré de la confiance placée en moi par le Président de la république en me reconduisant à la tête du nouveau Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haïti. Je m’associe donc à mes collègues pour adresser les remerciements les plus chaleureux à son Excellence Jovenel Moise pour cette marque de confiance que nous nous efforcerons de mériter dans l’exercice de notre mandat. L’heure est à l’action novatrice pour dégager le potentiel d’une économie dont les contraintes au redémarrage sont liées d’abord aux phases conjoncturelles de pesanteurs extra économiques.
C’est cette conviction qui a guidé l’action du précédent Conseil que je présidais et dont trois membres sont reconduits aujourd’hui aux postes de responsabilités les plus importantes de l’institution. La continuité dans l’action est donc garantie. Nous comptons l’amplifier de l’expérience acquise en nous aidant, notamment, de la collaboration du personnel de la banque centrale, de la compétence de nos partenaires de la Commission paritaire BRH-APB, de l’apport des autres institutions financières comme les caisses populaires et de la coopération des partenaires traditionnels tant du secteur public que de la communauté internationale.
Je salue avec beaucoup de reconnaissance, les importantes contributions des deux autres membres du Conseil précédent, Mme Georgette Jean Louis et Monsieur Fritz Duroseau à la mise en œuvre de ce vaste chantier que je vais vous présenter succinctement. Je leur souhaite encore plus de succès dans les entreprises futures auxquelles ils apporteront leur compétence avérée. C’est également l’occasion pour moi de saluer l’arrivée de Mme Myrtho René qui avait déjà prêté ses services à la BRH et le retour au bercail de Edgard Jeudy après une période fructueuse d’activités à la tête du Fonds de Développement Industriel.
Mesdames Messieurs,
La loi du 17 août 1979 portant création de la Banque de la République d’Haïti nous rappelle que l’institution vient de compléter quatre décennies d’activités de banque centrale. Comme la plupart de ses vénérables consœurs, la BRH a hérité de pratiques institutionnelles plus que centenaires. Un point d’ancrage, que nous pourrions faire remonter à une période bien antérieure, est la création, par le Président Lysius Félicité Salomon Jeune, de la première institution financière jouissant du privilège exclusive de création monétaire, en 1880. C’est cette filiation qui nous rattache sans faille à une orthodoxie éclairée et qui fonde la résilience d’une institution née au fort de la crise économique mondiale qui a suivi le second choc pétrolier de 1979.
Voici pourquoi les quarante ans de la BRH occupent une place importante dans mes propos d’aujourd’hui. Ces années sont là pour :
- Rappeler que l’institution est dépositaire d’un héritage profond qui charrie les germes de nos vertus fondatrices.
- Marteler qu’elle fait partie de cette quête du renouveau qui nous porte à regarder au-delà des conjonctures.
- Dire la fierté qui est la nôtre de servir une entité qui appartient à la lignée de nos grands patrimoines.
- Vous exposer les piliers d’une institution qui trouve dans la profondeur de ses traditions la capacité à transformer son environnement et à marquer ses repères face à l’incontournable modernité des technologies.
C’est dans cet esprit de modernité que la Banque de la République d’Haïti a poursuivi les projets qui ont précédé la tenure du Conseil partant et ouvert de nouveaux chantiers que les impératifs de développement institutionnel et de transformation socio-économique nous imposent. Une démarche qui s’appuie sur 5 piliers :
- L’Agenda monétaire pour la croissance et l’emploi
- La modernisation du système financier
- Le développement des marchés financiers
- L’implémentation de la stratégie nationale d’inclusion financière
- La promotion de partenariats formels avec les Ministères clés, les secteurs privés et les institutions internationales.
Les 4 dernières années n’ont pas été faciles. Les défis à relever étaient nombreux et lourds dans un contexte socio-politique très complexe. Une situation qui a conduit à un financement monétaire record de l’ordre de 4% du PIB au cours de l’exercice fiscal 2017-2018 et un niveau comparativement moins important, au vu des statistiques disponibles, pour l’exercice en cours. Les manifestations exacerbées des (paramètres de crise ont poussé l’Administration de collecte dans ses retranchements et affaibli drastiquement la performance fiscale. Les emballements subséquents des marchés ont été contenus dans les limites qu’autorisait la gravité des moments les plus pénibles de la conjoncture. On en est arrivé à des épisodes importants de dépréciation et à une marche inflationniste qui nous vaut le niveau significatif d’environ 19% au mois de Juillet 2019
Les mesures utilisées pour contrer ces emballements ont connu des taux de réussite variables, entre de simples décélérations du taux de change dans les moments de conjonctures très graves et de courte et fragile stabilité dans les moments de moindre gravité. Les anticipations pessimistes qui résultent de ce processus ont alimenté les facteurs d’inertie dans la détermination des prix sur le marché des biens. Conséquemment les mouvements inflationnistes ont dépassé largement le coefficient de transmission de dépréciation de la monnaie. C’est ce à quoi l’efficacité des mesures monétaire a du faire face. On imagine alors le niveau exagéré de la perte de bien-être que l’absence de ces mesures aurait permis. Dans ce cas d’espèce une politique de non intervention aurait été catastrophique. C’est cette analyse contrefactuelle que les services compétents de la Banque Centrale s’attèlent à quantifier.
L’institution, comme toujours, sort renforcée de ces épreuves et les leçons à tirer sont multiples. Elles trouvent néanmoins une synthèse dans l’idée cardinale que la conduite efficace de politiques publiques utiles est l’art de compromis qui réussissent dans les limites de faisabilité institutionnelle et de pérennisation des institutions. La nature complexe, inhérente à tout environnement social, fait de ces politiques la résultante d’arbitrages d’autant plus difficiles que les conjonctures sont mues par des forces résolument contraires. Pour les praticiens que nous sommes, la théorie des jeux est là pour guider les meilleurs chemins critiques dans la prise de décisions qui échappent rarement au domaine de solutions de « second best » qui est le propre des solutions d’arbitrage.
L’environnement qui prévaut à la conduite de la politique monétaire des 4 dernières années est de cette trempe-là :
- Nous avons augmenté les taux de réserves obligatoire et changé le mode de constitution de ces dernières en nous exposant au courroux de nos partenaires du système financier qui n’optimisent pas nécessairement la même que la Banque De La Republique d’Haiti ;
- Nous avons tiré à répétition la sonnette d’alarme et obtenu l’accord d’une gestion (de caisse) (contrôlée) conjointe des autorisations de dépenses budgétaires au risque d’irriter l’Autorité fiscale ;
- Nous avons puisé dans nos réserves internationales, malgré l’avis contraire de nos partenaires multinationaux, pour casser les emballements spéculatifs dans les conjonctures de forte irrationalité favorisée, entre autre, par des turbulences socio-politiques ;
- Nous avons augmenté les taux directeurs pour resserrer les conditions monétaires malgré les cris de débiteurs aux abois et le spectre de portefeuilles de crédit en perte de qualité.
- Nous avons fait des SWAPS, des « repurchase agreement » qui ne plaisent pas toujours aux institutions compétitrices des bénéficiaires.
- Nous avons tenté, il est vrai avec retenue, des incursions de nature microéconomique dans la conduite d’une politique monétaire de nature fondamentalement macro en exposant notre crédibilité, à la recherche d’un équilibre même sous-optimal étant donné les conditions et les défis qui ne rentrent pas dans notre juridiction.
Les coûts d’opportunité de ces mesures sont plus importants qu’ils ne le seraient dans un contexte de sérénité. Cependant, nous n’avons pas perdu le cap d’une vision de moyen/long terme de la politique monétaire. Et c’est là qu’intervient un arbitrage voulu entre le présent et le future ; un arbitrage inter temporel qui trouve son expression dans notre Agenda Monétaire Pro Croissance et un mode opératoire dans la mise en place d’un cadre favorable au financement de secteurs clés qui couvrent l’immobilier résidentiel, l’agriculture, le tourisme et l’hotellerie, les zones franches et les entreprises d’exportations. Il en est découlé des mesures concrètes qui ont attiré de nouveaux investissements dans les secteurs cités plus haut en facilitant :
- Des prêts de court, moyen et long terme à des taux préférentiels ;
- Le renforcement des structures évoluant dans le secteur agricole (zones franches, coopératives agricoles, etc.) ;
- La diversification des stratégies de financement comme le crédit-bail.
- Le rapatriement en mars 2019 du projet SYFAAH initialement géré par la coopération canadienne.
L’évaluation sommaire des interventions fait état de 143 dossiers traités pour un décaissement total de 14.5 milliards de gourdes depuis 2016 à travers le FRCRE, le FCEE, le PPDI et les programmes qui couvrent l’Agriculture, le secteur hôtelier, les prêts au logement et les zone franches.
La Stratégie d’Inclusion Financière en plein développement viendra compléter ces dispositifs de crédit d’une dimension de proximité économique qui ouvre la voie à un impact social plus large de la politique monétaire. C’est un projet qui nous tient particulièrement à cœur en raison de notre attachement à cette vision de long terme d’une politique monétaire qui se veut au centre d’une politique financière viable pour le développement.
Les efforts récents mais soutenus de mise en place d’un marché financier diversifié st suffisamment profond participe de cette démarche. Les travaux prospectifs avancent à grands pas et couvrent des domaines divers comme : le chantier réglementaire et législatif, le chantier organisationnel, le chantier de formation et celui d’un plan directeur de marchés. Le renforcement continu du cadre de supervision du système bancaire constitue un acquis indéniable à l’aboutissement de ce projet et les efforts consentis à cet effet sont importants.
Mesdames Messieurs,
La réalisation de ces politiques d’horizons divers, depuis la modulation des outils de gestion monétaire, la multiplication des passerelles entre les secteurs monétaire et réel jusqu’à la création d’un système financier fort et inclusif, est conditionnée par le développement de capacités institutionnelles qui touchent aux ressources humaines, aux moyens technologiques et aux infrastructures physiques.
Les travaux de renforcement des infrastructures physiques de la BRH regroupent deux catégories d’activités. Les réaménagements et rénovations, d’une part, et les nouvelles constructions d’autre part. Dans le premier cas, outre les investissements qui se réalisent dans l’aire métropolitaine, des travaux importants sont engagés aux Cayes et au Cap-Haitien. Dans le second cas, outre l’accroissement des infrastructures de contingence, un immeuble moderne est en phase de construction pour décongestionner le bâtiment principal en accommodant le fonctionnement de 164 employés.
Au niveau des moyens technologiques, les efforts consentis touchent tout le spectre des activités de la banque centrale :
- En matière de gestion administrative on peut citer : La mise en place d’un nouveau logiciel de gestion des ressources humaines : « Talent Management System (TMS) », la gestion électrique des documents et la digitalisation des archives, le renforcement du système de télésurveillance de la BRH.
- Sur le plan du déploiement de la Stratégie d’inclusion financière on note : Le centre de Contact de la BRH, l’Application BRH Mobile et Le site Internet rénové.
- Sur le plan de nos partenariats avec le secteur public et le système financier on peut citer : Le système de transfert automatique des chèques entre le Ministère des Finances et la BRH, les avancées dans le système de paiement et dans la facilitation des opérations financières.
Dans le cas des ressources humaines, tous les efforts sont déployés pour mettre l’institution en phase avec les défis de l’heure. La formation continue touche tous les niveaux de gestion de la banque et l’Institution de Formation de la Banque Centrale est doté de moyens de plus en plus adéquats pour étendre son action aux groupes cibles qui rentrent dans la responsabilité sociale de la BRH et dans sa stratégie de communication.
La création récente de la Direction de Communication et des Affaires Publiques et la mise en place du Fonds pour la Recherche et le Développement bientôt opérationnel participent de cette vision d’une banque centrale qui s’implique sans perdre de vue ses repères.
Mesdames Messieurs,
Je vous fais grâce des autres projets en cours et des détails de ceux que je viens d’exposer. Mes propos de ce jour ne constituent ni un étalage ni un exercice de promotion mais l’engagement documenté d’une institution qui se donne les moyens d’une contribution majeure au saut qualitatif et quantitatif que nous voulons imprimer à notre pays. Comme je l’ai dit plus haut, les contraintes au redémarrage économique sont de nature d’abord conjoncturelle. Nous sommes assez réalistes pour en tenir compte, en même temps, suffisamment profond pour regarder bien au-delà.
Les quarante dernières années de notre vie de peuple ont montré que chaque période de crises prend fin sur une fenêtre d’opportunité que nous peinons à exploiter. La façon d’y arriver est de se préparer à l’aurore qui devra pointer. Nous y croyons au point de vouloir vous contaminer de notre optimisme.
Merci
Madame, Monsieur les Membres du Conseil d’Administration de la BRH ;
Mesdames, Messieurs les représentants des Banques Centrales de la Caraïbe
Mesdames, Messieurs les représentants des Banques Commerciales d’Haïti
Mesdames, Messieurs les représentants des Caisses Populaires
Mesdames, Messieurs en vos rangs, grades et qualités,
19 ans après la 1ère conférence en juin 2000, la Banque de la République d’Haiti est heureuse de vous accueillir à nouveau à l’occasion de la vingt-neuvième Conférence Annuelle des Spécialistes des Systèmes d’Information des Banques Centrales de la Caraïbe.
Au nom du Conseil d’Administration de la BRH, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue en Haïti.
Je tiens à vous remercier d’avoir bien voulu accepter notre invitation et je salue l’effort de dépassement de vos dirigeants respectifs qui vous ont encouragé à nous rejoindre en dépit des contre-temps et des changements que nous avons été contraints d’opérer dans la programmation de cette conférence.
La présence en Haïti des délégations des banques centrales de la Caraïbe témoigne donc d’une préoccupation commune sur un thème jugé d’intérêt général à savoir « Le futur des Systèmes de Paiement dans le contexte de l’inclusion financière ».
Avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de situer cette conférence et de faire un rappel sommaire des enjeux liés au développement des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’ensemble des pays de la Caraïbe.
Mesdames et Messieurs,
Cette conférence s’inscrit dans le cadre du quarantième anniversaire de la BRH. C’est l’occasion pour nous de dresser, en quelques mots, le bilan manifeste de l’institution au regard du thème de la conférence et de dégager les perspectives. C’est aussi l’occasion de mesurer le chemin parcouru par la BRH dans sa quête de progrès et de modernité.
Beaucoup de changements ont marqué la vie de l’institution depuis notre conférence qui avait coïncidé avec le bug de l’an 2000. Au cours des 20 dernières années, les TIC constituent le domaine où les mutations technologiques ont été les plus marquantes.
En effet, sous l’influence des TIC, de nouveaux modèles d’affaires ont été proposés tant au niveau de l’intermédiation bancaire qu’à celui de la mutualisation des risques.
Aujourd’hui, on utilise une approche qui permet de revisiter les processus d’affaires d’une entreprise pour les rendre plus efficaces et plus efficients : la réingénierie des processus d’affaires.
De même, dans les grands groupes autant que dans les start-up, le Lean management (gestion sans gaspillage) a été inventé pour améliorer la qualité et la rentabilité de la production.
Les systèmes d’information ont aussi favorisé le développement des outils de travail collaboratif en passant du workflow pour l’enchaînement automatisé des étapes de validation d’une tâche complexe au groupware pour le partage des documents à distance.
Nous avons également la possibilité d’utiliser aujourd’hui une messagerie collaborative pour la gestion des tâches et des projets de la BRH.
En dehors de ces aspects organisationnels, les systèmes d’information servent à assurer :
• la gestion des risques à travers le contrôle des grands ratios pour les banques et les assurances ;
• le pilotage financier à travers la rentabilité, les fonds propres et le coefficient d’exploitation.
Ces systèmes d’information incluent aussi l’analyse des données volumineuses (Big Data Analytics) ainsi que les programmes d’intelligence artificielle dénommés « systèmes experts ».
Ces développements illustrent l’évolution significative observée dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication.
Au niveau des banques centrales de la Caraïbe, la sécurité des systèmes de paiement et l’inclusion financière représentent les grands enjeux de l’heure.
Sur le plan de la sécurité des systèmes de paiement, le développement des monnaies virtuelles comme les bitcoins posent un problème de contrôle pour les banques centrales de la région, car les transactions s’effectuent en dehors du système bancaire formel et sans recours à la compensation bancaire. A cet égard, Il est important de s’assurer que la modernisation des moyens de paiement et l’émergence d’une monnaie virtuelle ne privent les banques centrales du privilège traditionnel de contrôle indispensable pour la régulation monétaire et la stabilité financière régionale.
En effet, il y a moins de 20 ans, on parlait simplement de réseaux de communication, d’Internet, de commerce électronique (e-commerce) et de Système de paiement dans la Caraïbe. Aujourd’hui on parle de modernisation du système de paiement, de banque mobile, de paiement mobile, de Big Data, de Blockchain, de Fintech, de l’intelligence artificielle et de monnaie digitale etc…
Les banques centrales doivent donc s’adapter à ces récents développements technologiques qui inexorablement vont concourir à une nouvelle dynamique économique et financière.
En ce qui concerne l’inclusion financière, les gouvernements de la région et les institutions financières déploient, de nos jours, des efforts considérables pour atteindre le plus grand nombre possible de citoyens, pour leur offrir des services financiers et un accompagnement en termes d’education financière même dans les coins les plus reculés. Toutefois il faut noter que les TIC ont facilité largement le déploiement des services financiers et l’éducation financière qui sont les fondements d’une politique d’inclusion financière.
Dans ce contexte, le thème retenu pour cette année, à savoir « Le futur des Systèmes de Paiement dans le contexte de l’inclusion financière », répond aux engagements des banques centrales à enrichir les réflexions en vue de faire à ces nouvelles réalités.
Du côté de la Banque de la République d’Haiti, un long chemin a été parcouru avec nos partenaires (les Banques Commerciales, les Coopératives d’Epargne et de Crédits et les institutions de Micro-Finance) pour mettre sur pied un système de paiement moderne caractérisé par la compensation électronique des chèques, un système de paiement interbancaire (SPIH), un processeur national de paiement (PRONAP), pour ne citer que ceux-là.
Sur le plan de l’Inclusion Financière, la Banque de la République d’Haïti, en 2014, a, de concert avec le Gouvernement, défini la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière pour répondre à la situation criante du nombre d’exclus aux services financiers dans le pays.
L’objectif est d’améliorer l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des services financiers aux populations exclues ou insuffisamment servies. Par cette démarche, la BRH compte favoriser aussi l’émergence de nouveaux entrepreneurs en contribuant à réduire les contraintes structurelles, notamment la carence des infrastructures physiques et institutionnelles.
La BRH a aussi institué dans son organigramme une unité dénommée «Unité d’Inclusion Financière ». Cette structure a pour rôle d’une part, d’assurer la coordination, la mise en œuvre et le suivi des actions déterminées par la BRH visant à favoriser l’inclusion financière et d’autre part, à collaborer, sur le plan institutionnel, avec les acteurs impliqués dans la politique d’inclusion financière au niveau national.
Cette unité d’inclusion financière a mis à la disposition du grand public un outil informatique (la Cartographie des points de services financiers) permettant d’identifier les services financiers offerts dans les différentes régions du pays. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision en faveur des agents économiques dans le cadre de la stratégie d’inclusion financière. Au-delà de ce dispositif, la BRH a mis en place un ensemble de projets dont les plus notoires, l’Application BRH Mobile, le Centre de Contact, contribueront à réduire le pourcentage d’exclus des services financiers actuellement à 46% de la population active.
La BRH compte sur les externalités positives liées à l’accès à l’internet et à l’éducation financière, pour améliorer l’utilisation des services financiers. En outre, elle continuera de jouer son rôle auprès du gouvernement dans ses efforts de mise en œuvre de la Stratégie nationale d’inclusion financière.
Mesdames, Messieurs,
Je suis convaincu que les TIC vont continuer à jouer un rôle prépondérant dans l’atteinte de l’objectif d’inclusion financière durant les prochaines années. Le recours de plus en plus grandissant aux nouvelles technologies devrait jouer un rôle déterminant dans la bancarisation de la population haïtienne.
Dans la même veine, la banque et le paiement mobiles présentent tous les atouts pour permettre aux haïtiens d’accéder aux moyens modernes de paiement compte tenu du niveau de pénétration du téléphone mobile en Haïti qui a atteint 60% de la population âgée de 15 ans et plus.
J’espère que les discussions sur les différents sujets qui seront débattus au cours de la conférence vont permettre à chaque participant d’identifier les nouveautés à apporter dans les systèmes de paiement en vue de favoriser un meilleur accès des populations de la région aux services financiers.
Aussi, je déclare ouverte la 29e Conférence Annuelle des Spécialistes des Systèmes d’Information, et je vous souhaite du bon travail.
Madame, Messieurs les membres du Conseil d’Administration de la BRH
Monsieur le PDG du Group Croissance
Mme la Directrice Générale du Bureau Haitien du Droit d’Auteur
Monsieur le Directeur Général du CONATEL
Monsieur le PDG de Profit Development Consulting
Chers étudiants
Chers amis de la Presse,
Mesdames, Messieurs
Au nom du Conseil d’ Administration de la Banque de la République d’Haïti, de Group croissance et de Profin, je prends plaisir à vous souhaiter la bienvenue à la quatrième édition de la FinTech. Les éditions précédentes ont traité, avec succès, de l’impact des TIC sur la finance, du rôle de la technologie dans l’éducation et des enjeux du Bitcoin. C’est ce même succès que nous voulons reproduire cette année à travers les activités inscrites dans le thème « Faciliter l’Inclusion Financière en Haiti à Travers les TIC ». C’est donc un honneur pour moi de lancer ce matin les activités de cette édition.
Le thème retenu pour cette édition 2019 de la FinTech constitue l’un des grands axes d’intervention de la BRH dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière. Faut-il rappeler que depuis 2010, plus de 55 pays ont pris des engagements en faveur de l’inclusion financière et plus d’une trentaine 30 d’entre eux, dont Haïti, ont déjà lancé une stratégie nationale à cet effet.
La BRH a toujours cru qu’un niveau élevé d’inclusion financière en Haïti contribuera à la création de richesses, à l’amélioration des conditions de vie de la population et au développement durable. La Banque mondiale l’a si bien dit dans un rapport, l’accès aux services financiers est considéré comme un facteur de progrès pour la réalisation de sept des 17 Objectifs de développement durable’’. De plus, la technologie financière ‘’FinTech’’ ou encore l’accès à des produits et services financiers facilite le quotidien et aide les ménages et les entreprises à anticiper le financement d’objectifs de long terme et à faire face à des imprévus.
C’est pourquoi, depuis des années, la BRH s’investit dans beaucoup d’actions et programmes en vue de parvenir à un nombre plus important de la population inclus financièrement, contre un taux actuel d’exclusion financière de 46%, selon les résultats de l’enquête nationale sur l’inclusion financière.
Pour faire écho aux propos du Gouverneur dans le discours adressé aux présences assises : « La promotion des activités de la Fintech rejoint les préoccupations d’une forme d’inclusion tout aussi importante que nous qualifierions de technologique et qui trouve une application privilégiée dans le domaine de la finance ». Et, la Directrice Générale de la BRH concluait son intervention, lors de la présentation des résultats de la FinScope Haiti2018, avec l’idée que la meilleure garantie de l’inclusion financière c’est l’inclusion tout court.
Voilà ce qui résume l’essentiel du thème de cette année pour la Fintech et qui pourrait avantageusement conclure mes propos de ce matin.
Mais, je voudrais prendre le temps de rappeler l’engagement renforcé de la BRH auprès du grand public à travers les trois récents produits que notre équipe va vous présenter un peu plus tard. On connaît l’appétit du grand public pour la technologie. Et ce n’est la pas le taux insuffisamment élevé d’alphabétisation, ni le taux définitivement trop élevé de pauvreté qui empêchent le téléphone portable d’être, avec 60% des ménages, le second actif le plus possédé en Haïti.
Cette statistique de l’enquête FinScope nous indique la voie à suivre pour définir un raccourci viable dans notre quête de croissance et de développement. Dans cette aventure technologique passionnante qui veut mettre la finance au service du développement inclusif, la conviction dans la dynamique du changement est un facteur clé qui est souvent, en soi, un sujet de controverse. Je me rappelled qu’ A la fin des années 90, les jeunes économistes que nous étions à la BRH étaient partagés sur les incidences socio-économiques du téléphone portable. D’aucuns y voyaient un outil de paupérisation en raison du poids que représentaient les coûts élevés du crédit téléphonique dans le budget du ménage moyen. D’autres, comme feu Richard Baptiste y voyaient au contraire un facteur de croissance dans les échanges
Aujourd’hui Richard n’est plus ici-bas pour savourer sa victoire. Mais l’esprit de perspicacité dont il a fait preuve est bien évident. A chaque fois que le PDG d’un méga conglomérat grappe son portable pour finaliser une stratégie ou que le petit artisan de bourdon répond à l’appel d’un client, un facteur technologique d’accélération rentre en jeu dans une fonction implicite de production. Le téléphone mobile est devenu un outil indiscriminé de productivité. Il y prend cependant des politiques publiques avisées dans des contextes difficiles, des entrepreneurs industrieux et progressistes dans un environnement compétitif et, pour paraphraser Mme Christine Lagarde, des financiers qui voient bien au-delà de leur raison d’être, pour concrétiser, dans la croissance inclusive et dans la réduction de la pauvreté, la main invisible d’Adam Smith.
Mesdames, Mesdames,
Ce niveau élevé d’inclusion financière dont nous rêvons tous ne peut être matérialisé sans, entre autres, un minimum d’éducation financière et sans la protection des consommateurs. C’est dans ce contexte, à l’occasion de la 4ème édition de la FinTech et de la commémoration du 40ème anniversaire de la BRH, le Conseil d’Administration, auquel j’ai l’honneur d’appartenir, s’enorgueillit et est fier de lancer ce matin, trois projets phares à savoir :
- Le Centre de Contact de la BRH
- L’application BRH mobile
- Et le site internet rénové de la BRH
Je veux profiter de cette occasion pour présenter au nom du Conseil d’Administration de la BRH, mes sincères remerciements à tous les cadres de la BRH qui ont travaillé ardemment d’une façon ou d’une à la concrétisation de ces trois projets.
Le moment ne pouvait être mieux choisi pour lancer ces projets qui ont pour objectifs de :
- Faciliter l’accès aux produits et services financiers ;
- Promouvoir l’éducation financière ;
- Contribuer á la réduction de l’asymétrie de l’information
- Promouvoir l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) pour la prestation de services financiers ;
- Favoriser l’émergence d’un cadre formel de protection du consommateur financier.
En ce qui concerne le Centre de Contact, il s’agit d’une structure centralisée, moderne, globale et cohérente qui doit jouer un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de la politique de communication de la BRH avec le grand public. Sa vocation est de gérer sur place et à distance les relations avec les consommateurs de services financiers, par une communication directe d’une part, et d’autre part, par une communication basée sur le couplage de la téléphonie, de l’informatique et d’autres outils de communication.
Avec le Centre de Contact, la BRH entend, d’une part, informer, assister, accompagner les consommateurs de services financiers, rechercher l’efficacité opérationnelle, et collecter, d’autre part, des informations sur les problèmes ; la gestion des interruptions de service ; le suivi des réclamations ; la gestion des attentes, l’évaluation de la satisfaction des consommateurs de services financiers.
En ce qui concerne l’Application « BRH-Mobile », elle est une plateforme technologique qui permettra au grand public d’avoir accès de façon simplifiée aux principaux contenus et services proposés par la Banque Centrale. L’application BRH Mobile permettra à tout consommateur mobile d’avoir accès à un comparateur des tarifs pratiqués par les entités du système financier et la possibilité pour la prise d’une meilleure décision financière. Cette application contient des informations sur le change avec un calculateur intégré et des capsules vidéo prenant la forme de mini-documentaires sur des thématiques jugées d’intérêt pour le public et pour la BRH, qui mise sur un meilleur fonctionnement des mécanismes de transmission monétaire avec des acteurs économiques mieux informés et donc en mesure de former rationnellement de meilleures anticipations, en dehors des rumeurs et des bruits.
En ce qui a trait au nouveau site internet de la BRH, il s’agit d’une nouvelle structure du site de la banque avec une gamme beaucoup plus importante d’informations et une meilleure présentation des données, facilitant ainsi un meilleur accès au grand public.
Mesdames Messieurs,
L’association de la technologie à la finance est un pari intelligent qui va dans la lignée de l’inclusion financière devant favoriser la stabilité et l’équité des progrès. L’utilisation de la technologie comme les blockchains, les applications mobiles offrant des services financiers aux utilisateurs, sont autant de moyens qui facilitent non seulement les transactions économiques mais aussi l’accès à des ressources financières.
Ce sommet de la Fin Tech tombe donc à point nommé. Il va nous permettre de dégager des pistes de réflexions devant nous guider dans l’implémentation de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière.
Sur ce, Mesdames/ Messieurs, je vous souhaite une bonne journée et une fructueuse participation aux travaux de cette 4ème édition de la FinTech.
Merci,
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances
Madame la Ministre du Tourisme
Mesdames/ Messieurs les Parlementaires
Madame /Messieurs les Membres du Conseil d’Administration de la BRH Messieurs les anciens membres du Conseil d’Administration de la BRH Monsieur le PDG du Group Croissance
Mesdames/Messieurs les PDG des banques commerciales Mesdames/Messieurs
Chers invités
Chers amis
La 9e édition du Sommet de la Finance couvre un thème d’un double intérêt pour l’action de développement en Haïti. Il s’agit à la vérité d’une thématique qui recoupe les deux secteurs d’activités les plus présents dans les documents de politique publique en Haïti. Le secteur agraire dans ses dimensions agricoles et spatiales et le secteur touristique dans les formes différentes d’exploitation qu’il présente.
Rien ne saurait nous interpeler davantage qu’une réflexion sur l’agritourisme qui joint des domaines d’actions incontournables à une politique viable de redistribution dans la création de richesse.
C’est cette vision des choses que caresse le banquier central que nous sommes en cette année du quarantième anniversaire de la Banque de la République d’Haïti.
L’enjeu est de taille parce qu’il nous ramène de façon consciente au besoin de combler un déficit de croissance bientôt vieux de près de quatre décennies.
Cependant, Aussi que énorme soit l’enjeu, il prend un secteur agricole dynamique et une industrie touristique florissante pour contrer la paupérisation à travers notamment la modernisation continuelle de l’espace rural.
J’y vois le savoir-faire de l’entrepreneur agricole associé au savoir de l’agronome.
J’y vois la compétence du développeur touristique associé au génie artistique de nos professionnels de la culture.
J’y vois un environnement institutionnel allègre pour réduire les coûts de transactions et libérer le financement de ces secteurs.
J’y vois un système de sécurité et de justice qui garantit la protection des investissements.
C’est cette vision des choses qui me vaut l’insigne honneur de vous adresser le discours de ce soir.
Mesdames, Messieurs,
Bienvenue au cocktail traditionnel du sommet de la finance qui réunit comme à l’accoutumée le meilleur de nos ressources dans les domaines de la finance, de l’entreprenariat et du savoir académique. Chaque année je vois agrandir le cercle de participation à un horizon de plus en plus large qui couvre autant la diversité des générations que celle des domaines multiples de compétences. Il s’agit, s’il en est besoin d’un indicateur probant de l’intérêt sans partage que suscitent ces assises sur la finance et la technologie.
Cette année, la tenue du Sommet est l’occasion d’une triple célébration. Le double anniversaire des quarante ans de la Banque Nationale de Crédit et de la Banque de la République d’Haïti et celui des vingt-cinq ans d’existence de Group Croissance.
Je me plais à penser que les institutions ont la pérennité des idées qui les font naître. Des fois elles changent de nom en s’adaptant aux exigences de modernité. La BNC a choisi de garder son nom en s’adaptant à ces exigences. On ne se défait pas d’un label qui est tout un patrimoine !
C’est certainement cette logique qui a traversé les vingt-cinq ans de modernité qui font de Group Croissance ce label qui inspire nombre de jeunes entrepreneurs. Je m’associe donc aux autres membres du Conseil d’Administration pour souhaiter à la BNC et à Group Croissance nos vœux de succès continu à l’occasion de leur anniversaire.
J’en profite pour renouveler au grand public notre invitation aux activités qui couvrent toute l’année de commémoration des quarante de la Banque Centrale.
J’adresse une salutation spéciale aux autorités publiques pour le niveau élevé de leur participation à cet évènement. Je me réjouis de cette manifestation d’intérêt. Elle augure de bonnes perspectives pour les dispositions institutionnelles qui devront faciliter la concrétisation des idées que les échanges de ces assises auront fait germer.
Je salue avec emphase la présence des acteurs impliqués dans le développement des activités liées au milieu rural et de celles de l’industrie touristique. Cette dernière connait une année particulièrement éprouvante en raison des retombées négatives des récents événements sociaux.
La tenue des assises de cette semaine est le gage d’une foi profonde dans l’avenir d’une industrie pour laquelle nous avons, en quantité et en qualité suffisantes, les dotations naturelles pour en faire un succès.
J’étends ces salutations à la communauté élargie de la Finance pour l’engagement qu’elle partage avec nous dans le financement de domaines d’activités dont le degré inhérent de risque impose souvent d’évoluer en dehors de la zone de confort de l’orthodoxie.
Je m’en voudrais d’oublier les professionnels de média qui jouent, avec le dosage qu’il faut, ce rôle essentiel de levain pour donner du relief social à la pâte des idées débattues lors de ces assises. Je les remercie au nom des acteurs économiques qui prendront connaissance des réflexions à travers les créneaux médiatiques.
Finalement je clôture la tournée des salutations par les remerciements traditionnels mais toujours mérités à l’endroit des organisateurs. Group croissance et le Comité de la BRH sont cette fois encore à la hauteur de l’événement.
Le Conseil d’Administration de la BRH est manifestement satisfait du déroulement des activités de la 9ème édition du sommet. Je remercie Kesner Pharel pour son sens de leadership et sa vision. Je voudrais qu’il transmette ces remerciements aux cadres de Group Croissance qui ont travaillé à la réalisation de ces assises. A Ronald Gabriel, pour son sens du devoir, un collègue, un ami qui coordonne les activités de participation de la BRH à ce Sommet et aux cadres de l’institution impliqués à un niveau ou à un autre dans leur mise en œuvre, je dis chapeau ! C’est vrai qu’il nous reste de longs mois d’activités pour les 40 ans de la Banque Centrale. Mais je sais, comme toujours et spécialement cette année, que vous y mettrez le cœur à l’ouvrage.
Mesdames, Messieurs
L’Agritourisme renvoie à un ensemble d’activités où le tourisme et l’agriculture se croisent. Les récents développements veulent en promouvoir l’idée d’un domaine de production de biens et services nés de la synergie entre ces deux secteurs pour l’optimisation des valeurs créées au sein d’une économie locale, régionale voire nationale.
Quel que soit le cadre auquel on se réfère pour le définir, le milieu rural demeure la toile de fonds de son contenu. La réflexion sur le financement de l’agritourisme constitue donc l’occasion idéale d’adresser une dimension pas toujours présente dans l’analyse de la problématique du milieu rural en Haïti : Le développement d’activités liées à cet espace dans une perspective d’écosystème et suivant une approche plutôt holistique.
Le thème entier du sommet sied bien cette démarche : Agritourisme, Fintech et Inclusion Financière. On y trouve tous les ingrédients pour promouvoir un système générateur de valeurs avec une logique interne de reproduction et une logique externe d’interaction avec l’espace plus large qu’est l’économie nationale. Citons les facteurs suivants :
- Une agriculture largement biologique.
- Un patrimoine culturel à la fois unique dans ses spécificités et universel dans son syncrétisme et dans les idéaux qu’il charrie.
- Un espace rural qui défie encore les prévisions les plus pessimistes et qui prospèrera si l’on sait inverser la paupérisation ambiante.
- Un système financier de plus en plus ouvert à la novation.
Et c’est là, pour rester dans une note positive, l’enjeu prédominant de toute politique publique actuellement en Haïti : la création durable de richesse pour contrer la paupérisation. A faire l’évaluation de notre diversité écologique ; A faire l’inventaire de nos sites historiques ; A répertorier la grande diversité culturale et culturelle d’un terroir pas plus grand que le nôtre ; je réalise que notre principal facteur d’inhibition à la création de richesse c’est nous ! L’agritourisme, en raison des modalités de production de biens et de services qui le caractérisent et des dotations naturelles dont nous disposons, se prête à une expérience prometteuse en Haïti.
Le succès de quelques activités d’agritourisme en Haïti montre le fort potentiel de ce secteur. La réalisation de ce potentiel nécessite une double démarche :
- Une dynamique institutionnelle publique dans le cadre d’un paquet volontariste. Il va de soi qu’on ne saurait envisager une floraison d’entreprises rentables dans ce domaine sans la garantie du premier des biens publics : la sécurité. Une composante essentielle dans la mise en place de l’environnement institutionnel primordiale à cet épanouissement. Le véritable effet de levier viendra donc de ce paquet de politiques publiques préposé à cet effet et que nous appelons de nos vœux.
- Une dynamique institutionnelle privée qui associe le charme et le savoir traditionnel du milieu rural au savoir-faire de professionnels rompus aux pratiques du tourisme alternatif. L’offre de l’agrotourisme est à la clé de ce partenariat. Nombre des succès de l’agrotourisme dans les économies occidentales sont à la frontière de l’économie solidaire. Cette dernière n’exclue point la recherche d’une rentabilité optimale susceptible d’attirer l’investissement direct étranger. Mais cela implique
au départ une volonté de financement local qui sied au besoin de cimenter ce partenariat.
C’est à ce stade que le leadership du banquier central peut se révéler déterminant et payant. Nous partons de l’hypothèse que la force de notre diaspora et son attachement culturel sont la garantie d’une immense demande pour les produits de l’agrotourisme. Dès lors, la promotion d’un schéma de financement approprié trouvera facilement écho auprès d’investisseurs conscients de ce potentiel de la demande. Voilà ce qui complète le cycle d’une logique interne de reproduction et qui en fait un écosystème viable dont les éléments se déclinent aisément :
- Un domaine de production diversifiée de biens et services catégorisables qui en garantit une offre soutenable.
- Un potentiel important de demande locale et internationale initialement supportée par une diaspora solvable.
- Un espace privilégié qui donne contenu à un label territorial : le milieu rural.
On voit donc que tout y est, y compris la mise en place des facteurs de fluidité des échanges que les modules désormais complets de l’inclusion financière permettra de garantir. Le développement des infrastructures économiques et des infrastructures sociales de base, comme composante essentielle de ces facteurs, ne devrait pas tarder grâce à la création soutenue de valeurs marchandes dans un espace de multiplication des échanges.
Je m’en voudrais de ne pas laisser, les esprits alertes que vous représentez, inférer : `
- les retombées positives pour le reboisement de nos sols, la viabilité de notre habitat et la soutenabilité de notre écologie.
- L’impact progressif mais continu sur la réduction des phénomènes de pauvreté
- Les gains pour l’ensemble du système productif par la dynamisation des chaines de valeurs.
Pour les besoins de politiques publiques de nature sectorielle et macroéconomique, je vois une plus grande richesse d’interaction au sein de la matrice input-output de production. Une dynamique plus large capable de porter les germes d’une croissance endogène et moins vulnérable aux chocs externes. Et c’est dans ce cadre que se manifestera la logique externe d’interaction de l’écosystème avec l’espace plus large qu’est l’économie nationale.
Mesdames, Messieurs,
Le développement de l’agritourisme ne devrait point souffrir d’un manque de ressources financières ni d’une absence de dispositifs sectoriels de financement. Et ce n’est pas sans fierté que la Banque Centrale réalise le caractère proactif des analyses inscrites dans son agenda pro croissance et l’utilité des mesures qu’il préconise. Les domaines d’activités que recoupent l’agritourisme pourra bénéficier rapidement des avantages offerts au secteur agricole par la circulaire 113 et de ceux offerts au secteur touristique par la lettre-circulaire 09-1.
Il est utile de rappeler que, dans le premier cas, les institutions financières éligibles couvrent les Banques et sociétés financières de développement (SFD),
les Coopératives d’Epargne et de Crédit (CEC), les Sociétés de crédit-bail et indirectement, les Institutions de Microfinance. Ce qui ouvre un large champ d’intermédiation aux investisseurs potentiels. Dans le second cas, les prêts aux facilités hôtelières sont bonifiés par des dispositions qui réduisent les coûts d’intermédiation. Il va de soi que les perspectives de développement de l’agritourisme ouvriront la voie à des schémas de financement spécifiquement appropriées à ce domaine.
La mise en œuvre totale des modules de l’Inclusion Financière devrait concourir de façon notable à ce développement. Il est vrai que les ambitions de cette politique d’inclusion sont d’ordre national ; mais ses incidences sont de nature à la fois microéconomique, sectorielle et macroéconomique. L’agritourisme y trouvera d’autant son compte que l’intégration financière de l’économie rurale et tout ce qui s’y rattache est un objectif premier de cette démarche. C’est l’occasion pour moi de saluer la phase d’aboutissement de ce travail immense d’intérêt et d’utilité pour l ?économie nationale ; disons mieux de portée immense pour la société haïtienne.
Dans un registre différent, la promotion des activités de la Fintech rejoint les préoccupations d’une forme d’inclusion tout aussi importante que nous qualifierions de technologique et qui trouve une application privilégiée dans le domaine de la finance. La multiplication des applications que propose la Fintech ouvre la voie à une redéfinition utile des rapports d’un public de plus en plus large avec les institutions financières.
La Banque Centrale s’est déjà embarquée dans l’amélioration de ces rapports à travers l’education financière ou la protection des consommateurs deux des pilliers de la Stratégie Nationale d’inclusion Financière . C’est dans ce contexte que nous introduirons au cours la FINTECH :
-l’application BRH Mobile qui permettra à tout consommateur mobile d’avoir accès à un comparateur des frais pratiqués par les banques et la possibilité de les comparer pour une meilleure décision financière . Des vidéos à visualiser , ou à télécharger , ou à partager sur les différentes fonctions d’une banque centrale ou de banques commerciales. Le taux de change et un calculateur. Ce comparateur s’etendra très vite aux Coopératives d’épargne et de crédit , et les maisons de transfert.
-Un nouveau site brh.ht
-La BRH ouvrira officiellement en mai prochain, les travaux de réflexions sur l’émission d’une gourde digitale.
– Eh bien sur pour ceux que la question pourrait intéresser, l’approfondissement d’un marché financier avance à pas de géant.
Qu’il s’agisse de conseil financier, de protection des consommateurs, d’éducation financière, de financement participatif, d’assurance et du crédit, les solutions innovantes, grâce notamment à la technologie du blockchain, deviennent d’autant plus accessibles que se développent avec force les facilités du téléphone mobile.
L’un des principes de politiques publiques à tirer de ces assises est la promotion des secteurs phares, capables de jouer le rôle de locomotives pour tirer d’autres secteurs à fort potentiel de valeurs ajoutées dans l’économie. Les politiques d’inclusion au niveau financier que technologique devraient porter ces locomotives sur des sentiers de croissance forte et soutenue. Chemin faisant, la politique fiscale s’ouvrirait à la vertu d’un équilibre budgétaire durable, la politique monétaire s’allègerait du poids du déficit d’épargne publique, la politique du commerce extérieur donnerait la mesure de sa compétitivité et la politique du secteur réel deviendrait un vaste champ de restructuration des sphères de production. L’Agritourisme peut être un élément majeur de ce tableau ; si bien sur nous y travaillons.
Mesdames/ Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et une fructueuse participation aux travaux de ce 9ème Sommet International sur la Finance.
Merci
Je vous remercie de cette opportunité de partager avec nos collègues de la chaise quelques informations sur l’évolution de la situation en Haïti. Je sais que vous avez sans nul doute suivi avec intérêt nos récents défis. Comme vous le savez peut-être, au début du mois de Mars nous sommes arrivés à un accord « ad referendum » avec le FMI pour un appui au titre de la Facilité Élargie de Crédit (FEC) qui devrait couvrir les trois prochaines années. Notre objectif avec ce programme, c’est d’accélérer tant que possible nos efforts pour sortir de la fragilité. Ainsi donc, le programme sur lequel nous nous sommes entendus tente de trouver un juste équilibre entre adresser les préoccupations sociales, ou mieux, prévenir la détérioration de la situation sociale et prendre un train de mesures pour garantir la stabilité économique. La consolidation fiscale et le renforcement des filets de sécurité sont au cœur du programme. Il adresse aussi des questions de gouvernance dans le secteur électrique, et d’une manière générale contient des mesures pour accroître la transparence et combattre la corruption. En fait, nous avions pris des mesures bien avant la venue du FMI pour assurer la stabilité macroéconomique. L’une de ces mesures est le cash management qui est un accord signé entre la Banque de la République d’Haïti et le Ministère de l’Economie et des Finances pour limiter la dominance fiscale. Avec cet accord, la discipline fiscale devrait être assurée.
Le changement de Premier Ministre après la clôture des négociations avec le FMI sur la FEC va tout de même reporter l’approbation de l’accord (FEC). Malgré la volonté de l’Exécutif et les assurances du Législatif d’aller rapidement avec le processus, l’accord avec le FMI ne peut être signé avant la formation officielle du nouveau Gouvernement. Cela est nécessaire non seulement pour conforter le FMI mais aussi pour nous permettre de remplir les conditions préalables à l’approbation de la FEC par le Conseil du FMI. Le dépôt du budget de l’exercice en cours au Parlement est une de ces conditions préalables.
Dans le cadre de la FEC nous devrons obtenir du FMI un appui jusqu’à concurrence de 100% de notre quote-part au FMI soit environ 229 millions de dollars avec deux décaissements au cours de l’exercice en cours. L’Union Européenne et la BID attendent le signal du FMI pour aussi octroyer également des appuis budgétaires totalisant environ 75 millions de dollars. Ces appuis sont indispensables pour implémenter les programmes sociaux devant mitiger l’impact potentiellement négatif des mesures structurelles du programme sur les couches les plus vulnérables de la population.
Comme les mesures incluses dans la FEC font partie du programme du Gouvernement, nous continuons à la mettre en œuvre, bien que l’accord ne soit pas encore officialisé avec le FMI. Nous pensons aussi que cela devrait permettre qu’il n’y ait pas de report dans les deux décaissements prévus avant la fin de l’exercice, soit avant fin Septembre 2019.
Je ne saurais terminer sans remercier au nom du Ministre et en mon nom propre, l’Administrateur. M. Tombini et son Adjoint M. Saraiva (Bruno) qui se sont personnellement impliqués pour arriver à cette étape de conclusion d’un accord au titre de Facilité Élargie de Crédit que nous recherchons depuis près de deux ans.
Mesdames, Messieurs, les Membres du Gouvernement,
Mesdames, Messieurs, les Parlementaires,
Messieurs, les Membres du Conseil d’Administration de la BRH,
Mesdames, Messieurs, les Membres du Corps diplomatique et des institutions internationales,
Mesdames, Messieurs, les Représentants des institutions financières et partenaires de la BRH,
Mesdames, Messieurs, les Représentants des organisations de la société civile, des institutions universitaires et des organismes culturels,
Distingués Invités,
Mesdames, Messieurs,
Au nom du Conseil d’Administration que j’ai l’honneur de présider, je tiens d’abord à vous remercier d’avoir répondu positivement à notre invitation à l’occasion de cet événement qui s’inscrit dans la foulée des activités commémorant le 40e anniversaire de la création de la Banque de la République d’Haïti. Je remercie aussi les auteurs et les maisons d’édition qui ont travaillé d’arrachepied pour produire et imprimer les livres qui font aujourd’hui l’objet de cette vente-signature.
Je voudrais, en particulier, exprimer mon respect et mon admiration pour le travail accompli, dans des conditions parfois difficiles, par les auteurs dont nous célébrons les travaux aujourd’hui, je cite Guerdy Lissade, Daniel Supplice, Jean- Hérold Pérard, Max Étienne, et tous les écrivains qui ont collaboré sous la direction de l’historien Pierre Buteau à la réalisation du livre « Le Sud dans la diversité de son patrimoine ».
J’unis dans le même témoignage de remerciements les hommes et femmes de culture qui ont déjà contribué à enrichir nos collections dans le cadre d’une coopération étroite avec le musée numismatique de la BRH, soit par une production conjointe, soit par la réédition d’oeuvres méconnues.
Distingués Invités, Mesdames et Messieurs,
La rencontre de ce soir est un événement qu’il convient de bien situer par rapport à l’esprit qui lui a donné naissance.
Comme je l’ai indiqué tantôt, notre rencontre participe de la panoplie d’activités culturelles planifiées afin de marquer le 40e anniversaire de la BRH. Mais, au-delà de cet aspect, elle reflète surtout la volonté de la Banque Centrale d’inscrire son mécénat et sa programmation culturelle dans le sens d’un intérêt préférentiel pour les oeuvres qui concordent avec sa mission et son histoire.
Je suis particulièrement inspiré par le ton et le contenu du 32ième « Tacitus Lecture » que Madame Christine Lagarde, Directrice générale du FMI, a donné à Londres le 28 février dernier et dans lequel, elle enjoint la finance internationale à redéfinir un « secteur financier qui voit au-delà de sa raison d’être ». C’est ce type de discours qui alimente l’action du Conseil que je préside et qui motive l’arbitrage que nous faisons entre l’exigence de rigueur du banquier central et l’obligation d’ouverture sur le tout social du serviteur public.
Notre action en la matière repose sur des principes simples et universellement établis, que l’on peut énumérer comme suit :
- Favoriser le développement du patrimoine culturel de l’État haïtien;
- Préserver ce patrimoine et y donner accès au public le plus large possible aux fins d’éducation et d’édification ;
- De manière plus spécifique, mettre ce patrimoine à profit afin de promouvoir l’éducation financière et les connaissances de base en économie.
Sur le premier point, celui ayant trait au développement du patrimoine culturel de l’État haïtien, la BRH dispose déjà d’un fond historique et artistique important qui héberge toute une collection de tableaux ainsi que d’autres oeuvres d’art originales. Elle détient également une collection numismatique qu’elle s’attache à enrichir. De plus, l’on se souvient qu’en 2014 nous avions mis en circulation un choix de livres qui firent partie intégrante de la Collection des 35 ans de la BRH. Parmi ces livres figuraient notamment ceux de Frédéric Marcelin, d’Anténor Firmin, de Vilfort Beauvoir, de Raymond Renaud et de Joseph Châtelain.
Chacun de ces livres évoque des moments importants de notre histoire telle que reflétée à travers l’évolution de notre monnaie, de nos institutions et de nos relations économiques avec nos partenaires.
Le 10 juin 2017, la BRH procédait à la vente signature du livre « Haïti à travers sa monnaie », réalisé sous la direction de l’écrivain Michel Soukar. Il s’agissait d’un formidable travail de recherche présentant les témoignages d’acteurs qui avaient marqué des siècles d’histoire monétaire haïtienne, de Moreau de Saint- Méry à Claude Moïse, en passant par Perceval Thoby et John Spencer.
Le 6 avril 2018 vint le tour de « Les trésors de la République », une oeuvre issue du partenariat entre la BRH et le Musée du Panthéon National. Ce livre se veut le résultat d’une combinaison judicieuse des collections respectives du MUPANAH et du Musée numismatique de la BRH.
Venons-en maintenant au 2e principe qui inspire le mécénat et la programmation culturelle de la Banque Centrale d’Haïti. Il s’agit du principe de préservation et de vulgarisation du patrimoine culturel de l’État haïtien.
Les graves dégâts causés par le tremblement de terre du 12 janvier 2010 incluaient l’endommagement d’importants objets culturels. Sans tarder, la BRH s’engagea dans une campagne de restauration qui bénéficia de l’assistance technique de la France. De nombreux tableaux purent être réparés, dont « Le Serment des Ancêtres ».
S’agissant du 3e principe – l’éducation économique et financière –, en dehors des journées portes ouvertes, nous profitons de chaque événement important pour inviter les écoles à participer à nos activités. Ainsi, bien que le musée numismatique de la BRH ne soit pas encore totalement ouvert au public, plusieurs écoles ont eu l’occasion d’en visiter la salle d’exposition. Ces visites ont offert l’occasion à la BRH d’organiser des ateliers pour les jeunes sur l’histoire de la monnaie et les missions de la BRH.
Au bout du compte, notre ambition est de promouvoir l’éducation économique et financière à travers la mise en place d’un espace muséal dédié à l’interaction de la BRH avec les écoliers et les universitaires.
Voilà, Distingués Invités, Mesdames–Messieurs, le chemin déjà parcouru en matière d’enrichissement de nos collections.
Et cela nous amène à l’objet de la rencontre de ce soir : la collection de livres du 40e anniversaire de la BRH. Je sais que les auteurs vont faire un exposé plus complet sur les livres en signature, mais permettez-moi d’en dire quelques mots.
Commençons avec le livre conçu sous la direction de l’historien Pierre Buteau, et intitulé « Le Sud dans la diversité de son patrimoine ». Ce livre fait ressortir la part de l’errance afro-latine et l’importance du principe de la réciprocité dans la lutte acharnée pour la liberté en Amérique Latine, quelques années après l’indépendance d’Haïti. Et, au-delà du passage de Simon Bolivar dans le Sud de notre pays, il rappelle la promesse faite par le Libertador au président Alexandre Pétion d’abolir l’esclavage partout où il aura triomphé. De plus, la faune, la flore, les festivités, les mouvements sociopolitiques sont présents dans cette oeuvre, sans oublier la cuisine, la musique et les artistes peintres originaires du Sud. Tant d’éléments trouvent une place de choix dans cette belle célébration de la grandeur, de la diversité et de la fierté de cette région du pays.
Le livre de Guerdy Lissade, « Les billets de banque de la République d’Haïti », nous raconte, à travers la monnaie, la transition difficile du système colonial à la souveraineté de l’État haïtien qui en était issu. Du billet de caisse au papier monnaie, le récit nous entraîne dans les méandres de l’histoire monétaire d’un État meurtri et divisé après la mort de Jean-Jacques Dessalines. De la Révolution de 1843 au second empire de Soulouque, pour aboutir à la Restauration de 1859, puis au triumvirat de papier et au temps des réformes, cet ouvrage nous permet de comprendre le parcours historique qui, en 1915, aboutit à l’occupation américaine. Dans ce coffret de trois pièces, c’est toute la culture de la monnaie haïtienne qui est à l’honneur. Vous êtes tous invités à voyager dans l’univers de la monnaie, avec des informations de première main et des pages très bien illustrées. Quant au livre de Daniel Supplice, « Haïti – Histoire et Constitutions », il présente l’intérêt d’offrir au lecteur une documentation abondante sur les Constitutions haïtiennes pour la période allant du 8 juillet 1801 au 9 mai 2011. C’est un document historique que nous offre l’auteur, un guide pour répertorier l’ensemble des Constitutions de la République d’Haïti. Ce travail ne peut que renforcer le patrimoine documentaire haïtien.
De son côté, Jean-Hérold Pérard nous invite à faire un tour dans la vie, l’histoire et l’oeuvre de Henry 1er dans son livre : « Henry Christophe – Un grand méconnu ». Il s’agit du plus récent livre de référence sur le sujet, et je ne doute pas qu’il va contribuer à la commémoration, en 2020, du bicentenaire de la mort du grand Roi Bâtisseur. Quelles sont les leçons politiques, les vérités et les informations les plus pertinentes à découvrir sur Henry Christophe ? Ce livre est davantage une interrogation sur l’homme qui nous a légué les sites les plus imposants du patrimoine bâti haïtien, qu’un jugement sur un roi que l’on dépeint souvent comme un « dictateur progressiste ».
Enfin, le livre de Max Étienne, intitulé « Code monétaire et financier », est une nouvelle édition que beaucoup de professionnels de la finance et du droit ont intérêt à consulter. Ils y trouveront toute l’information nécessaire à bien naviguer le quotidien des affaires, et pourront s’en servir comme un outil de travail pour s’imprégner du cadre législatif et réglementaire de notre système financier.
Distingués Invités, Mesdames et Messieurs, Votre présence ici, ce soir, témoigne de votre intérêt pour l’histoire, l’économie, et aussi pour la richesse culturelle de notre pays. La BRH est fière de pouvoir satisfaire votre curiosité intellectuelle en organisant la vente-signature de ces livres qui vont s’inscrire et dans le patrimoine littéraire du pays, et dans la documentation nationale sur l’art et la science numismatiques.
Cet événement est un témoignage de l’engagement culturel et éducatif de la BRH. Car, en dehors de la collection du 40e anniversaire, il s’agit d’un projet de diffusion de la culture basé sur la nécessité d’éduquer nos concitoyens sur l’histoire de notre monnaie, cette grande école qui les éclaire sur nos contradictions, nos forces et nos faiblesses.
Je vous invite donc à redécouvrir l’histoire d’Haïti à travers sa monnaie, à travers les règles de son système financier, à travers ses rois, ses Constitutions et la région du Sud en vous procurant ces livres qui vous offriront l’occasion d’aider un jeune compatriote à s’instruire et à se cultiver.
En faisant l’acquisition de ces livres pour vous-même ou en l’offrant à un proche, vous créerez une nouvelle occasion d’enrichissement intellectuel. Vous pourrez ainsi vous rapprocher davantage d’une personne que vous aimez et contribuer du même coup à la promotion d’une oeuvre littéraire, artistique, historique, sociologique, scientifique et numismatique.
Comme l’a si bien dit Émile Zola : « Il n’y a jamais trop de livres ! Il en faut, et encore, et toujours! C’est par le livre et non par l’épée que l’humanité vaincra le mensonge et l’injustice, conquerra la paix finale de la fraternité entre les peuples ! »
Je vous souhaite une bonne soirée et, bien sûr, bonne lecture!
M. Le Ministre de l’Agriculture ;
M. le Chargé de la Coopération Canadienne du Canada en Haïti ;
Mme l’Ambassadrice de Suisse en Haïti ;
Madame, Messieurs les membres du Conseil de la BRH ;
M. Le Directeur-Général du FDI ;
M. le Directeur-Général du BCA ;
M. Le Directeur du Projet SYFAAH ;
Madame, messieurs les cadres du MEF, de la BRH et du FDI ;
Distingués invités,
C’est avec grande satisfaction que je participe à cette cérémonie qui va consacrer le transfert des fonds du projet SYFAAH, qui arrive à terme ce 31 mars 2019, au Fonds de Développement Industriel (FDI).
La BRH, dès le début, a toujours travaillé en synergie avec le Ministère de l’Agriculture, le SYFAAH et les autres acteurs institutionnels, dans la mise sur pied de l’écosystème requis pour le développement du financement agricole en Haïti. Elle s’engage à rester proactive dans le processus, en jouant un rôle central dans la consolidation des mécanismes développés avec l’accompagnement du SYFAAH. Ces derniers ont porté respectivement sur le financement, des outils de mitigation de risque via l’ASREC et des garanties partielles de crédit (FAPAAH).
Nous nous attèlerons donc à pérenniser ces acquis en vue de la mise en place, de manière structurante, d’un environnement institutionnel fiable pour soutenir le financement de l’Agriculture.
Pour impacter, de manière substantielle, l’accès élargi au crédit dans le pays, ce cadre devra prévoir comme préalable, la commercialisation de l’assurance récolte. Cet instrument a été éprouvé à travers une phase pilote du projet, pour la filière riz, dans le département de l’Artibonite. Il a donné des résultats probants. La couverture de risque qu’il offrait a poussé des institutions financières à élargir l’accès au crédit au bénéfice de petits producteurs. Le résultat était un WIN-WIN, à la fois pour les institutions financières et les débiteurs. Ces derniers, lors de la matérialisation des aléas naturels, à l’origine de pertes matérielles importantes, recevaient une compensation qui leur permettait de repartir en affaires et de restructurer leurs prêts. En même temps, les institutions créancières avaient l’assurance que leurs ressources ne seraient pas mises à mal par leurs décisions d’octroi de crédit à cette catégorie de débiteurs réputés vulnérables.
La commercialisation de l’assurance récolte implique comme préalable la mise sur pied d’un fonds de réserve, pour pallier l’absence de couverture de réassurance agricole en Haïti. Ce fonds pourra contribuer à permettre au portefeuille de crédit agricole d’atteindre une taille critique suffisante pour attiser l’appétit de réassureurs agricoles envers le marché haïtien.
La BRH, comme facilitateur au Ministère de l’Agriculture, a toujours œuvré dans l’encadrement et la stimulation du secteur agricole en vue :
- D’identifier les filières porteuses connectées à des marchés viables via le financement d’études;
- De faciliter des synergies entre les acteurs opérant dans les chaines de valeur via l’organisation de tables sectorielles de concertation autour des filières porteuses ;
- D’augmenter les financements par l’introduction de mécanismes financiers incitatifs portant principalement sur l’exonération de réserves obligatoires (circulaire 108), l’octroi d’avances de fonds aux institutions financières à des taux très bas (circulaire 113). Ces incitations ciblent les producteurs et exportateurs de produits agricoles. Elles sont adaptées aux besoins de court, moyen et long termes du secteur ;
La BRH ambitionne de voir le FDI jouer un rôle moteur dans l’expansion du financement agricole et agroindustriel, à travers le pays. Dans ce contexte, elle accueille favorablement le transfert du reliquat des fonds du SYFAAH ainsi que les transferts de compétences réalisés depuis quelques mois.
Je profite de l’occasion pour saluer les efforts de l’équipe de dirigeants, en particulier de M. Jeudy, pour améliorer la gouvernance de l’institution. La BRH accompagnera le FDI dans son renforcement. A la lumière de rapports d’évaluation récents réalisés respectivement par le SYFAAH, la BID et le Frankfurt Institute, ce dernier mandaté par la Banque Européenne d’Investissement (BEI), nous avons déjà entamé le processus de support à une gouvernance améliorée du FDI, à travers notamment :
- La supervision, sur place et sur pièces, du FDI, au même titre que les autres institutions que nous régulons ;
- L’affectation, en permanence, d’un cadre de notre Unité d’Audit Interne au FDI ;
- Des appuis ponctuels axés sur la fourniture de supports techniques spécifiques, notamment dans les processus d’élaboration et de contrôle budgétaires ;
Par lettre datée du 20 mars courant, adressée à DID Desjardins, la BRH a confirmé son engagement à supporter l’environnement institutionnel requis pour un financement agricole amélioré. Par la même occasion, elle a mis en exergue les contributions financières de l’Etat, à l’ASREC et au FAPAAH, de 80 millions de gourdes en 2017-18. Ce montant représente les dividendes que la BRH verse au Ministère de l’Economie et des Finances, tous les ans en fonction d’une obligation légale. Elle a aussi fait mention des supports financiers qu’elle octroie au secteur à travers les institutions financières. Cet engagement porte sur un montant plafond de 5 milliards de gourdes par an.
Je vais conclure en remerciant le Canada, DID Desjardins, tout le staff du projet SYFAAH, en particulier, son directeur, M. Charland, la Coopération Suisse pour leurs contributions à la genèse d’un embryon d’écosystème de financement agricole et de couverture des risques associés, en Haïti. Nous allons œuvrer pour que cette initiative soit pérenne et pour qu’elle s’étende sur tout le territoire et s’élargisse à l’ensemble des filières porteuses du pays.
Nous encourageons à la fois le Gouvernement Central et les bailleurs bilatéraux et multilatéraux à financer ou à augmenter leurs financements à l’assurance récolte et à la garantie partielle de crédit. C’est ainsi que l’Agriculture pourra jouer son rôle de moteur de la croissance économique soutenue et durable avec des incidences notamment sur :
-
- La baisse de l’inflation et la stabilité macroéconomique en général ;
- Des rentrées de devises importantes résultant des exportations agricoles ;
- L’augmentation des revenus en régions rurales ;
- Des créations massives d’emplois ;
- Une réduction significative de la pauvreté et un élargissement de la classe moyenne ;
- La réduction des vulnérabilités de l’économie par rapport aux chocs externes ;
- Des retombées positives sur des secteurs transversaux tels le tourisme.
Merci de votre attention
Port-au-Prince, le 27 mars 2019
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Président du Conseil d’Administration de l’IAI-Haïti
Messieurs/Mesdames les Présidents des Banques Commerciales et Institutions Financières
Monsieur le Coordonnateur du Forum Économique
Monsieur le Président sortant de l’UFAI
Mesdames & Messieurs les Représentants de la presse parlée, écrite et télévisée
Mesdames et Messieurs.
C’est toujours un plaisir de participer à la réunion annuelle de l’Institut des Auditeurs Internes d’Haïti, un forum technique périodique de réflexion visant le renforcement et la promotion de la fonction d’audit interne au sein de nos institutions respectives. L’IAI-HAÏTI, depuis sa fondation en 2003, a acquis des galons certains qui honorent ses membres et toute la communauté de spécialistes financiers du pays. Et comme vous le comprenez bien, la BRH, de par son rôle central dans le système financier, reste une fière partenaire de l’IAI et de la semaine de l’audit, chaque année depuis le début. Une fois de plus, le thème de « de-risking » retenu par le Conseil d’Administration de l’IAI se révèle des plus opportuns et des plus pertinents. Son importance est difficile à évaluer pour la BRH comme pour toutes les banques centrales du monde particulièrement celles de la CARICOM.Aujourd’hui, comme les orateurs précédents l’ont illustré, l’opinion publique est convaincue que la corruption et son corollaire, le blanchiment des avoirs, ont un impact négatif sur l’économie et le tissu social d’un pays, et particulièrement sur le nôtre. Une analyse effectuée par Price Waterhouse Cooper (PWC) en 2016 montre que sur l’index de perception de la corruption de Transparency International qui va de 0 à 100, une augmentation d’un point de l’indice correspond à une baisse de $380 du PIB per capita. Dans une étude réalisée aussi en 2016, le FMI, quant à lui, a estimé, qu’en matière de pots-de-vin uniquement, le coût de la corruption mondiale s’établit autour de 2% du PIB mondial soit de US$1,500 à US$2,000 Milliard. Comme vous pouvez le constater c’est énorme ! Ces deux indicateurs à eux seuls montrent l’ampleur du problème auquel nous faisons face.
Donc non seulement la corruption et le blanchiment des avoirs accentuent les inégalités et augmentent les risques de tensions sociales, mais ils renforcent le caractère informel de l’économie d’un pays et ainsi constituent un frein à l’inclusion financière. En ce sens la lutte contre la corruption et le blanchiment des avoirs se retrouve au centre des efforts de stabilisation, de modernisation et d’expansion du système financier du pays. Aussi aucun effort n’est ménagé par la BRH afin qu’Haïti adopte et applique au mieux toutes les dispositions de prévention, de détection et d’investigation en matière de blanchiment d’argent dans son domaine de compétence. Parmi ces initiatives on peut souligner le fait que, depuis 2008, à travers plusieurs circulaires relatives à la surveillance réglementaire (par exemple, la Circulaire #95-1), la BRH fait obligation à toutes les institutions financières sous sa supervision d’obtenir de sa clientèle une déclaration de la provenance de fonds à partir d’un seuil de 400 Mille gourdes. Le cadre réglementaire exige aussi de ces institutions financières la mise en place d’un département de conformité chargé de la gestion du respect des dispositions réglementaires en général et les dispositions sur le blanchiment en particulier incluant la responsabilité de faire des déclarations de soupçons à l’UCREF toutes les fois où elles le jugent nécessaire. La BRH quant à elle s’assure à travers l’inspection régulière des institutions financières que toutes ces dispositions sont respectées.
Également, comme membre actif du Comité National de Lutte contre le Blanchiment des Avoirs (CNLBA), l’organe de gouvernance de l’UCREF, la BRH joue un rôle direct dans la gestion stratégique de la politique nationale en matière de blanchiment. Parallèlement, la BRH est à l’avant-garde des efforts visant à garantir le respect d’Haïti à ces engagements auprès du Groupe d’Action Financière de la Caraïbe (GAFIC), particulièrement en matière d’adoption de textes législatifs. On se rappelle la conférence du 26 août 2016 où la BRH, conjointement avec le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique, a réuni tous les acteurs nationaux en vue d’adapter les mécanismes légaux de prévention, de détection et de répression du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. On peut aussi citer la réalisation de séances de sensibilisation auprès de journalistes sur la question du blanchiment. La liste des initiatives est longue et je m’arrêterai aux plus récentes et aux plus significatives.
En ce qui concerne la lutte contre la corruption, et la promotion de la bonne gouvernance, la BRH agit à la fois à l’interne et au niveau des institutions règlementées. A l’interne depuis 1995 la banque centrale a mis en place une fonction d’audit interne indépendante qui a, entre autres missions, la prévention, la détection et l’investigation de fraudes. Cette fonction a été renforcée en 2007 en la rapportant au Comité d’Audit composé quant à elle d’une majorité de membres externes. De plus, en matière de passation de marchés, la BRH a établi en son sein une Commission Spécialisée de Marchés Publics (CSMP) chargée d’organiser l’octroi de tous les marchés supérieurs au seuil fixé par la loi et qui doivent faire l’objet d’autorisation en amont et en aval par la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP). Afin de garantir son indépendance, aucun membre du Conseil d’Administration ou de la haute direction de la Banque (Gouverneur, Gouverneur-adjoint, Directeur Général) ne peut faire partie de la CSMP. Dans le but de renforcer les capacités de cette dernière les cadres de la BRH reçoivent des formations spécialisées allant de séminaires locaux et internationaux jusqu’à l’obtention de la certification de Manager Spécialiste en passation de Marché Public (MSMP) délivrée par la Banque Mondiale. Sur les quatre MSMP en Haïti, la BRH en compte la moitié.
Toujours en termes d’action anti-corruption, depuis 1998 (Circulaire 89), les banques commerciales sont obligées de se doter d’une fonction d’audit interne. Cette initiative a contribué non seulement à l’amélioration de la gouvernance des institutions financières mais également à l’émergence de cette communauté de spécialistes qui forment aujourd’hui l’IAI-HAÏTI. La banque centrale est donc fière d’être à la base de l’établissement de ce métier en Haïti et, par ricochet, d’avoir contribué à la lutte contre la corruption.
Pour résumer, en ce qui a trait à la bonne gouvernance, la transparence et la prévention de la corruption, nous pouvons dire sans prétention que la BRH et les institutions financières supervisées peuvent servir de modèle pour le secteur public comme pour le reste du secteur privé haïtien. Et ceci particulièrement dans la conjoncture actuelle. A cet égard nous devons rendre un grand hommage aux institutions règlementées en général et particulièrement aux banques qui, sans relâche, font la preuve quotidienne de leur engagement à la bonne gouvernance et au respect de la loi. En témoigne le fait que sur les 20 plus grands contribuables haïtiens 4 sont des banques commerciales (il faut noter que le 21ème plus grand contribuable est également une banque et une banque d’État de surcroît !). Par leur exemple ces intermédiaires financiers prouvent qu’il est possible d’être profitable, même très profitable tout en respectant la loi et en observant la bonne gouvernance en Haïti.
Quant au financement du terrorisme, ne nous méprenons pas. Il s’agit d’un fléau auquel sont exposés tous les pays. Qu’ils en soient directement victimes ou non, les Etats ont le devoir moral de jouer leur partition afin que leur territoire et système financier ne soient utilisés à cette fin. Dans un monde qui tend vers la polarisation et le repli sur lui- même, le recours à la violence et au terrorisme risque malheureusement d’être le choix de certains. Il nous revient d’être vigilant afin de ne pas être complice de leurs actes soit par inaction soit par manque de rigueur. Soyons-en conscients et encore, restons vigilants. La BRH de son côté continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour jouer pleinement son rôle et coopérer avec toutes les juridictions lorsqu’on fera appel à elle et s’assurer qu’Haïti ne soit pas un maillon faible du système financier international.
Il y a lieu de souligner fortement que la résistance à ces fléaux ne peut pas être menée uniquement par le secteur financier; un système judiciaire indépendant, efficace et efficient, doté de ressources humaines, techniques, financières et matérielles, est une condition nécessaire au succès de ce combat contre les crimes financiers. Pour cela, la BRH se tient prête à faire tout ce qu’elle peut dans les limites de ses attributions légales, à travers le CNLBA et toutes autres initiatives ou dispositions prises par les autorités et nos partenaires internationaux.
Il revient alors à nous de nous armer de courage et de détermination afin de continuer cette lutte. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une bonne semaine de l’audit et une excellente soirée. A l’année prochaine !
Merci!
Port-au-Prince, le 12 novembre 2018
1 https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/cost-of-corruption.html
2 https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Corruption-Costs-and- Mitigating-Strategies-43888
3 https://lenouvelliste.com/article/194065/les-200-plus-grands-contribuables-pour-lexercice-2017-2018
Centre de Convention et de Documentation de la BRH
13 avril 2018
Honorable Sénateur Patrice Dumont,
Monsieur le Gouverneur de la BRH,
Mesdames/ Messieurs les Membres de l’ équipe de la FINTECH,
Mesdames/Messieurs,
Chers invités,
Chers amis,

FINTECH, dois- je le rappeler, est une contraction de deux mots anglais : Finance et Technology. « C’est une nouvelle industrie financière qui utilise les nouveaux moyens de la technologie pour proposer des services financiers tels que la banque en ligne, les paiements mobiles, le financement participatif (CROWDFUNDING), moins coûteux et plus efficaces pour les consommateurs ». Elle est utilisée également, par extension, pour désigner des compagnies, appelées « STARTUP », qui maitrisent bien les TIC et qui bouleversent complètement le monde classique de la finance en tentant de capter des parts de marché des entreprises traditionnelles souvent peu innovantes ou en retard sur l’adoption des nouvelles technologies comme moyens de transformation.
Quand nous faisons des échanges sur FINTECH à la Banque Centrale, nous insistons surtout sur des aspects tels : innovation, flexibilité, simplicité, efficacité, mobilité, personnalisation, accès à distance, réactivité. La plupart de ces caractéristiques trouvent leurs échos dans au moins deux piliers de notre Stratégie Nationale d’Inclusion Financière : le Pilier 1 – Des services financiers pour faciliter l’inclusion et la réduction de la pauvreté et le Pilier 3 – Des services financiers de proximité.
Dans cet ordre d’idées, le Conseil d’Administration a demandé à nos responsables de réaliser pendant l’évènement une démonstration pour montrer le rôle que jouera le Processeur National de Paiement (PRONAP) dans l’inter-opérabilité entre les différents moyens de paiement et les différents acteurs financiers.
Pourquoi c’est important d’organiser FINTECH régulièrement ?
Quand on considère les caractéristiques mentionnées précédemment, il nous paraît évident que les impacts de telles activités sur le secteur de la finance se feront sentir bientôt chez nous. Déjà, dans les autres pays avancés, les banques et les compagnies d’assurance ont commencé à repenser leurs activités et leur mode de fonctionnement. De plus, il faut trouver des réponses à certaines questions qui reviennent régulièrement : « Les Fintech sont -elles un risque de rupture ? Sont-elles des opportunités ou des sources de risques ? ». Les présentateurs et panélistes ne manqueront pas de vous apporter des réponses extensives et éclairantes. Devrais- je seulement souligner que La FINTECH est quand même exigeante. Elle requiert un excellent système d’éducation, l’esprit d’entreprise et la disponibilité de capitaux, pour arriver à construire des réseaux de clients à moindre coût, à réduire les coûts de fonctionnement, à utiliser les données de façon innovante et à être en conformité avec la réglementation.
Les investissements dans la FINTECH globalement sont de l’ordre de quatre milliards de dollars en 2013, 12 milliards en 2014, 19.7 milliards en 2015, les États-Unis avec la plus grande part, mais l’Europe expérimente la plus forte croissance au cours des dernières années. Nous sommes évidemment très loin en matière d’ investissement dans ce domaine en Haïti. On avait découvert avec plaisir lors de la première édition de FINTECH en 2016, des produits innovants de certaines entreprises haïtiennes. Kesner Pharel, PDG du Group Croissance, disait à cette époque que : « Nous n’avons pas le choix, nous sommes obligés de faire le choix de la technologie et il nous faut même des pas de géant dans le domaine pour que le pays soit au rendez-vous de l’avenir ». Il y a eu d’autres activités comme, par exemple, « Haiti Startup Talent », ou encore « Haiti Tech Summit ». Dans les autres pays, ce n’est pas encore le cas chez nous, ces entreprises, ces startup perturbent le secteur de la finance en créant des services très différents de ceux qui existaient avant, axés sur la technologie et qui aident tous les clients à vivre une expérience différente même s’ils ne sont pas bancarisés. BITCOIN-BLOCKCHAIN se présente comme l’une de ces technologies, qui va faire l’objet, un peu plus tard dans la matinée, de présentations et de panels de discussions par Messieurs Patrick Attié, Carl H. Prophète et Yves Nithder Pierre.
Chers invités, je vous laisse avec les ingénieurs et techniciens spécialisés en TIC, les économistes, les financiers, pendant ces deux journées et j’espère que vous allez passer d’excellents moments. Je termine en rappelant une déclaration qu’avait faite en 2016 le Gouverneur de le BRH, Jean Baden Dubois, lors du salon de l’économie numérique, à savoir : « Pour que tout un chacun puisse vraiment profiter de cette économie numérique, il faut que nous arrivions à réduire le gap de production lié très souvent au niveau d’apprentissage, aux défis de l’analphabétisme et à la carence d’infrastructures ». C’est ce qui constitue le crédo, le rationnel de notre agenda monétaire pro-croissance avec l’emphase mise par l’institution sur les deux principaux facteurs de toute fonction de production : le capital humain que nous encourageons à travers nos nombreux programmes de formation et le captal financier dont le déficit, en matière de financement des projets, est adressé, en partie, à travers nos multiples programmes d’incitations aux secteurs à forte génération de valeurs ajoutées.
Je vous remercie de votre attention.
Centre de Convention et de Documentation de la BRH
03 mai 2018
Mesdames/Messieurs,
Chers collègues,
Chers invités,

La Banque de la République d’Haïti (lance) initie officiellement aujourd’hui une activité riche en promesses pour la réflexion et l’action dans l’orientation et la conduite des politiques publiques ainsi que dans la gouvernance du secteur privé. Il s’agit d’un espace de diffusion de connaissances et d’échanges (d’idées) sur des problématiques qui touchent à l’économique, au social, à la science et à la technologie. La conférence du jour est la deuxième d’une longue série d’interventions de nature préférablement prospective où les membres de la communauté académique, les praticiens des secteurs privés et publics et les professionnels des institutions de développement trouveront et exposeront les substances qui inspireront leurs actions.C’est dans ce cadre-là, qu’au nom du Conseil d’Administration de la BRH et de l’Institut de Formation de la Banque Centrale, je souhaite une chaleureuse bienvenue à chacun des participants à ce forum. Le thème des réflexions de ce jeudi est majeur pour qui veut scruter la frontière des nouveaux horizons de l’activité humaine : « Transformations Globales et Nouveaux Risques », devrais- je rappeler que les risques sont une combinaison des enjeux et des aléas. C’est à cet exercice passionnant que nous invitent les intervenants de ce jeudi. Le choix du thème est à la mesure des compétences choisies pour développer les sujets qui seront couverts. Et c’est avec emphase que je salue nos conférenciers en leur disant combien nous sommes tout ouïes.
Mesdames, Messieurs,
On se plait souvent à dire que le présent c’était hier et que le futur c’est aujourd’hui. Pour être économiste, je connais la frustration de devoir projeter le futur à partir de la mémoire – j’allais dire du passé – dans un monde en constante accélération technologique. Ce qui ferait dire (l’humoriste), parlant de l’économiste, que le futur c’était hier. Pourtant un palliatif existe dans le domaine de la prospective même si, dans l’état actuel de l’art, ce qui fait la force des outils de politiques publiques, c’est le réalisme de leur condition d’application. Il doit donc nécessairement exister un lieu contemporain d’arbitrage entre la boite à outils bien ficelés du policy maker et les domaines futurs d’application que les technologies nous permettent d’augurer. Une façon de donner ancrage à notre rêve de développement. C’est dans ce sillon que s’inscrit cet espace d’échange, auquel vous tous ici présents, allez contribuer pour renforcer l’économie du savoir et du savoir-faire.
Cette initiative vient à point nommé pour fixer une activité récurrente dans le défilement des nombreux événements dont le Centre de Convention et de Documentation sera l’hôte. Il s’agit, dans notre entendement, d’un moment renouvelé de la réflexion pour relever le niveau du dialogue dans notre communauté. Il s’agit aussi de renforcer le poids des problématiques économiques et techniques dans les discussions sur les choix de société donnant ainsi à l’action politique les moyens de son objectif. Une telle démarche a la vertu d’ouvrir les champs d’action de développement des acteurs sociaux dans un environnement où la politique surdétermine le tout social. Il s’agit finalement d’encourager et de faciliter la diffusion de connaissances pour éclairer les choix de politiques publiques de manière optimale. Le savoir et le savoir-faire sont des facteurs de production d’autant plus déterminants dans le relèvement de l’activité économique en Haïti que le déficit de capitaux est extrêmement pesant.
Mesdames, Messieurs Ce nouvel espace de réflexions du jeudi perdrait de sa portée utilitaire si les échanges qu’il engendre ne se transforment en idées qu’un environnement adéquat canalisera en actions de développement. La limitation actuelle des ressources préposées à la prospection intellectuelle nous impose d’optimiser l’existant pour en tirer un produit qui sied à la fois les besoins de la réflexion pure et ceux de son application pratique dans un souci de transformation socio-économique. L’objectif d’une croissance économique forte et autoentretenue est au cœur de cette démarche. C’est à ce carrefour fondamental que ce nouvel espace d’échanges rencontre notre Agenda Monétaire Pour La Croissance et l’Emploi. C’est également ce qui motive la modeste contribution de la Banque de la République d’Haïti à la mise en place d’une politique viable de Recherche et Développement lorsque les conditions le permettront.
Cette activité de réflexions et d’échanges étant lancé, il appartient à la communauté des travailleurs intellectuels de se l’approprier. Il s’agit d’un jalon posé, à côté de tant d’autres, dans la constitution d’une pensée critique qui soit suffisamment autonome et féconde pour répondre aux spécificités que l’action de développement en Haïti ne cesse de soulever.
Sur le plan de l’organisation, cet espace sera animé par un ensemble de ressources nationales et internationales d’horizons divers: académiques, policy makers, chercheurs, acteurs des secteurs public et privé. La BRH honore ses devanciers et invite la communauté intellectuelle et professionnelle à multiplier les initiatives du genre. Elle formule le vœu, qu’à terme, cet espace de réflexions évolue vers un THINK TANK qui serait un bien public au service des politiques publiques.
Nous avons donc désormais notre rendez-vous du jeudi. Et c’est déjà un bien commun, une obligation partagée.
Mesdames, Messieurs,
Je vous prie de vous joindre à moi pour remercier, vous, les invités et.. les conférenciers venus de loin.
Bonne participation
Politique monétaire, Trois axes d’action de la BRH dans la perspective d’un développement de l’Agro-business et de la Technologie blockchain
Mesdames, Messieurs,

Voici revenu le temps des semences prometteuses. Cette année encore, à travers le foisonnement d’idées les unes plus égales que les autres mais jamais à court d’inspiration et de novation. Cette année, pour conduire la réflexion, au propre comme au figuré, en donnant à la semence des idées les propriétés qui feront germer les semis en récoltes fructueuses pour le secteur agricole.
Et ça tombe bien ! Le mois d’avril est celui de notre sommet de la finance mais c’est aussi la saison des espaces ensemencés. Un sommet de la finance pour alimenter la réflexion autour du financement de l’agri business en Haïti… Cette démarche s’inscrit dans un contexte thématique plus large. Il y associe la réflexion sur les perspectives à dégager autour du Bitcoin mais surtout de la technologie blockchain. C’est donc un signe patent que la porte à l’ innovation reste grande ouverte.
Mesdames, Messieurs,
Vous comprenez donc l’immense intérêt que je veux partager avec vous autour de ce sommet qui, comme chacun des précédents, porte le sceau d’une certaine particularité. La particularité, dans ce cas, c’est qu’il porte sur ce qu’il y a de fondamental dans la chaine des activités humaines de production: le secteur primaire. Vous me permettez de ne pas faire l’économie de rappeler qu’en Haïti ce secteur tourne pour l’essentiel autour de la branche agriculture. Il y a de ces évidences que l’on se plait souvent à évoquer mais que le cerveau semble cacher à notre champ visuel ou rayer de notre champ d’action. Ce n’est pas une redondance coupable si je renchéris pour dire qu’Haïti est un pays agricole. Cependant, force est de constater que cette leçon transmise à plus de deux siècles de générations de femmes et d’hommes est restée plutôt stérile. Comme un slogan sans substance qui n’aurait servi qu’à donner bonne conscience à notre conscience nationale.
C’est sur cette toile de fonds que je veux souhaiter la bienvenue à ce réservoir d’idées que vous représentez et à cette énergie renouvelée que vos actions sont capables d’entretenir. J’adresse une salutation spéciale aux autorités de l’Etat qui rehaussent par leur présence la cérémonie d’aujourd’hui. C’est une manifestation d’intérêt qui nous encourage à croire que les considérations et les propositions qui sortiront des échanges prendront progressivement corps dans les agendas de politique publique.
C’est cette perspective qui justifie d’ailleurs la chaleureuse bienvenue que nous adressons à la communauté des acteurs impliqués dans les chaines d’activités liées au secteur agricole. Je veux parler des investisseurs de l’agri business et de l’agro-industrie ; des exploitants agricoles et des professionnels de tous bords intéressés à cette problématique. J’étends ces salutations avec la même emphase aux professionnels des média qui donneront cet incontournable effet de levier dans la diffusion des idées qui seront produites. Au reste de l’auditoire, acteurs présents avec nous ou qui prendront connaissance des réflexions à travers les créneaux médiatiques, je dis à vos marques car ces idées ne serviront à rien si vous ne savez pas les traduire en actions entrepreneuriales.
Permettez-moi finalement de placer des remerciements mérités à l’endroit des organisateurs. Cette année encore, le groupe croissance et le Comité de la BRH ont sorti le grand jeu. La richesse des échanges qui ont conduit au choix des thèmes et qui ont abouti à la mise en place des activités du Sommet témoigne de ce savoir-faire qui ne s’est jamais démenti et qui prend désormais allure de passion. Je voudrais que le PDG Kesner Pharel trouve ici et transmette au Groupe Croissance, l’expression de la satisfaction manifeste du Conseil d’Administration de la BRH de ce partenariat fructueux dont les résultats sont à la mesure des promesses. Je voudrais également remercier les cadres de la BRH impliqués à un niveau ou à un autre dans les activités d’organisation de ce Sommet de la Finance pour la diligence et la compétence qu’ils y mettent. Le pari, partagé avec vos paires du Groupe Croissance, de faire cohabiter le financement de l’agri business avec les perspectives de la technologie du blockchain est celui de l’intelligence et de la foi dans l’avenir.
Mesdames, Messieurs,
La question du financement de l’économie haïtienne a toujours été au coeur de la problématique des politiques publiques. Et la question corollaire de la mobilisation des ressources préposées à cet effet trouve une origine lointaine dans le premier arbitrage majeur qu’a dû opérer les politiques entre honorer la dette de l’indépendance et financer le développement des infrastructures économiques et sociales d’une nation fraichement issue d’une guerre émancipatrice mais dévastatrice. Ce qui crédibilise l’idée que le développement du pays est grevé d’un passif initial très lourd.
Les politiques inspirées des différents paradigmes qui ont traversé l’ordre économique international durant la période qui a précédé les accords de Bretton Woods comme celle qui les ont suivis n’ont pas conduit à une transformation durable des structures économiques en Haïti. Aujourd’hui encore, et davantage que dans le passé, on est réduit à constater un passif économique lourd dans l’ensemble du panorama socioéconomique haïtien. L’écart tendanciel entre un profil démographique exponentiel et un profil économique stagnant sur les dernières décennies exprime globalement ce constat. Mais l’illustration la plus frappante est sectorielle. Elle renvoie à la situation de la branche agriculture et à celle des filières qui y sont liées.
Il s’agit d’un secteur auquel on crédite encore près de la moitié de la population occupée mais qui a vu sa part dans la production globale du pays passée de plus de 40 % à environ 25 % sur les dernières années. Je ne ferai pas l’affront aux experts qui vont vous parler avec autorité de la problématique du secteur de vous rapporter davantage de statistiques qui tiennent désormais de lieu commun. Mais je pointerai du doigt, avec les précautions qui s’imposent, la faiblesse de productivité que cette baisse de valeur ajoutée infère en présence d’un taux aussi élevé d’occupation. J’irai un peu plus loin plus en suggérant une confrontation plus serrée de cette baisse avec l’hypothèse d’une croissance non négative de la population rurale à travers les deux considérations qui suivent :
Si la croissance démographique compense l’effet réducteur de la mobilité du facteur travail et des phénomènes migratoires sur le niveau de la population rural, le nombre de personnes occupées dans le secteur agricole serait au moins égal au niveau qu’il était 25 ans auparavant.
Comme de plus, la baisse de la part de la valeur ajoutée du secteur agricole s’est réalisée dans un contexte de stagnation de la valeur ajoutée globale donc du Produit Intérieur Brut (PIB) cela suppose un repli absolu de la production agricole sur cette période.
L’analyse jointe de ces deux dynamiques devrait donc renforcer les préoccupations quant à la faiblesse des productivités dans les filières de la production si l’on veut assurer le financement de l’agri business dans des conditions de rentabilité qui l’affranchisse des pièges de la subvention durable.
C’est dans cet état d’esprit que la BRH aborde la question du financement de l’Agri Business en Haïti. La productivité comme leitmotiv permet d’envisager le développement du secteur agricole et des filières apparentées sous un angle qui mette en relief le besoin d’éviter les erreurs institutionnelles du passé et les coûts qui y sont liés, de réduire les risques d’intermédiation pour les institutions de financement et de rendre l’environnement du domaine agricole plus perméable aux facteurs d’efficience que sont les innovations technologiques. Finalement, elle permet d’aménager plus facilement les nécessaires voies de sortie là où il s’avère souhaitable pour l’autorité monétaire (les autorités publiques) de faire des incursions sectorielles dans les sphères du secteur réel.
Ce dernier aspect revêt une importance capitale pour (L’autorité monétaire) le banquier central contraint à un arbitrage continuel entre sa mission de stabilité et le partage des responsabilités de croissance et d’emplois. Le tout avec des outils en nombre limité par les frontières même de l’orthodoxie financière qui en assurent d’ailleurs la force et la crédibilité. Dans une économie de marchés oligopolistiques, de déséquilibres internes et externes structurels comme celle d’Haïti, l’adoption d’un sentier de productivité sur un horizon raisonnable peut tempérer les critiques de l’interventionniste sur les postures de prudence et raisonner l’impatience de l’orthodoxe face à certaines latitudes.
L’expérience des politiques non conventionnelles conduites après la crise de 2008 dans les grandes économies de marché comme dans les économies de moindre échelle ont renforcé notre conviction que les frontières de l’orthodoxie n’étaient pas immuables. Le renversement de cette posture quelques années plus tard suggère l’idée que la flexibilité même de ces frontières en tant que facteur de conditionnement de la politique monétaire est elle-même objet d’arbitrage. Voici pourquoi les nécessaires efforts de maintien de la stabilité macroéconomique en présence des déficits jumeaux importants de l’économie haïtienne n’excluent pas l’aménagement de canaux de soutien à la croissance tant que les critères de rentabilité et d’efficacité déterminent les secteurs des interventions et leur horizon temporel. Voici donc les considérations liminaires qui militent en faveur d’une Agenda Monétaire Pro-Croissance.
Aujourd’hui, les problèmes inhérents au secteur agricole et aux filières qui y sont liées appellent à des réflexions profondes si l’on veut que ce large domaine d’activités profite des facilités que permettent les dispositions de notre agenda dans des conditions qui sied les nouvelles donnes d’efficacité de la politique monétaire. Le sommet de la finance de 2018 offre ce cadre de réflexion. La cohabitation du thème de financement de l’agri business et de celui de la technologie du blockchain ouvre la voie à un regard prospectif sur la recherche de synergie dans l’articulation des chaines de valeurs créées à travers les activités primaires secondaire et tertiaire qui tournent autour des filières agricoles. Cette cohabitation devrait permettre aussi de produire des réflexions sur les leviers nécessaires au relèvement de la productivité dans le secteur.
Je vous souhaite une bonne participation et de fructueux échanges.
Mesdames, Messieurs,
Le financement de l’agri business et la mise à profit des facilités technologiques du blockchain s’insèrent aisément dans le canevas des actions de la BRH bâti autour des trois axes d’interventions qui permettent de donner corps à sa stratégie de croissance:
Le développement des marchés financiers pour favoriser la création d’outils financiers capables de mobiliser l’épargne et d’accroitre les options de financement de l‘économie. Il s’alignera sur la stratégie nationale d’inclusion financière;
L’inclusion financière pour élargir l’accès et la disponibilité des produits et services financiers définis comme des leviers dans le développement de l’activité économique.
L’agenda pro-croissance pour promouvoir le cadre incitatif destiné à orienter les investissements vers les secteurs à forte valeur ajoutée.
L’articulation de ces axes est vue comme un système générateur qui s’accommode des particularités sectorielles et des environnements technologiques qui supportent leur développement. Et dans chaque cas, il se profile les contours d’un cercle vertueux à la faveur des synergies que se transmettent les composantes de ce système élargi. L’idée d’un équilibre propre à une dynamique d’écosystème sied bien notre propos. Dans le cas qui nous concerne ici, l’agri business supporté par les facilités technologiques du blockchain verrait croitre en quantité et en qualité les signaux incitateurs transmis vers des ressources financières en quête d’investissements générateurs de valeurs productives donc de croissance. Le tout selon des schémas d’interrelation à l’intérieur des composantes et entre les composantes du système.
Voici, avec un brin de sophistication que je suis loin de rechercher, la démarche autour de laquelle la BRH espère voir tourner les réflexions qui vont foisonner lors de ces assises. Ces dernières représentent une opportunité de plus pour la Banque Centrale d’influencer les actions qui permettent de libérer la politique monétaire des conditions adverses qui l’assaillent. Ces conditions, comme vous le savez, sont de nature institutionnelle et structurelle et elles tiennent des actions tant du secteur privé que du secteur public. Leur prévalence contraint la Banque Centrale à se retrancher dans une attitude défensive qui apparente la stabilisation à une posture à priori. Or la stabilité recherchée est la résultante d’un équilibre vertueux qui concoure à créer de la richesse que seuls les flux de croissance savent alimenter de façon durable et auto-entretue.
Voici pourquoi notre posture de stabilité est loin d’être celle qui restreint la circulation des flux d’activité. D’où le besoin d’affirmer notre crédo dans une croissance saine et renouvelée. Voici aussi pourquoi notre agenda pro croissance est loin d’être une invitation à l’activisme monétaire. D’où le besoin d’inscrire dans les faits la promotion d’un environnement macro financier stable. L’équilibre, dans un tel contexte structurel, est au fil du rasoir. Notre démarche est donc d’éviter à l’autorité monétaire la torpeur du funambule accroché à sa perche, en transformant cet équilibre en sentier praticable où les politiques publiques sont à leur aise. Un élément clé à l’aboutissement de cet effort est l’adoption d’une attitude prospective à laquelle les innovations technologiques peuvent donner fruit. C’est dans cette optique que l’analyse des créneaux d’insertion de l’agri business dans le canevas d’interventions de la BRH et celle du rôle catalyseur de la technologie blockchain dans ce processus constituent un domaine d’intérêt pour la réflexion et l’action.
Mesdames, Messieurs,
La contrainte de ressources a toujours été perçue comme prédominante dans la mise en oeuvre des politiques de développement en Haïti. Cette assertion n’est cependant pas exclusive du problème d’adéquation des politiques publiques et de celui plus large d’une démarche holistique qui sait pondérer et inter relier les dimensions multiples de la problématique du développement. C’est pour cela d’ailleurs que l’aide économique au développement, malgré son utilité, est limitée dans sa portée parce qu’elle ne sait pas créer un processus intergénérationnel de création de richesse. On comprend alors pourquoi l’effort d’approfondir et d’élargir l’existant en matière de système financier constitue les bases d’un objectif plus large de développement des marchés financiers qui soit concomitant de celui des secteurs porteurs de l’économie.
La mise en branle du Système National d’Inclusion Financière est là pour donner son poids socioéconomique à cette démarche. Et c’est ce large dispositif de nature financière qui devrait bénéficier au financement de l’agri business tout en profitant. Car il s’agit de donner à l’Etat stratège les moyens de promouvoir l’ensemble du système économique selon une démarche qui joint l’ensemble de ses composantes multiples. Je vois donc avec bonheur un processus de diversification de produits financiers qui permettent :
De financer les besoins de trésorerie des différents chainons d’activités de l’agri business
De financer la capitalisation d’entreprises agricoles et agroindustrielles à travers des prises de capital et de titrisation de dettes de long terme
D’introduire des titres publics destinés au financement des infrastructures du secteur agricole.
Dans le même temps, la valeur ajoutée générée dans l’agri business devra renforcer les revenus distribués dans les filières agricoles et agroindustrielles à travers une meilleure rémunération des facteurs employés. La transmission de la valeur gérée ne s’arrête pas là. Elle devrait alimenter la demande de produits financiers et susciter l’innovation dans des marchés financiers plus approfondis grâce notamment :
A la création d’un marché secondaire des titres financiers publics et privés
Au développement de la réassurance pour les entreprises du secteur
A une meilleure évaluation et mitigation des risques que permettra une base plus large de clientèle et de transactions entre les entreprises du secteur et le système financier.
L’environnement institutionnel qui servira de lien à ce processus d’incubation est en train progressivement d’être mis en place. Les facilités de financement que la BRH met à la disposition des filières agricole et agro-industrielles à travers l’intermédiation bancaire représentent déjà un premier acquis. De façon plus large, la BRH a entrepris une série d’initiatives qui devraient progressivement tisser de nouveaux réseaux d’interactions entre les acteurs concernés. Citons parmi les plus importantes :
L’accompagnement de programmes d’assurance agricole;
Le renforcement des caisses populaires en milieu rural;
La réalisation de tables sectorielles autour de différentes filières agricoles;
La multiplication des consultations avec les autorités budgétaires et fiscales en vue du développement d’un marché des titres publics;
La mise en place d’une législation permettant la création d’institutions financières habilitées à émettre des titres pour le compte d’entreprises privées.
Mesdames, Messieurs,
Nos réflexions ne sortiraient pas des sentiers battus si elles ne s’y associaient le facteur important qu’est la novation technologique. Le développement des instruments de financement ne pourra pas aider à renforcer les liens dans la chaîne de valeur et à augmenter la valeur ajoutée du secteur si l’amélioration de la productivité des facteurs n’est pas au rendez-vous tant dans les sphères réelle que financière de production de biens et services liés au secteur. Deux considérations liminaires retiennent mon attention. Quel est, au stade actuel de son développement, les potentialités d’exploitation de cette technologie au profit du secteur ? Comment éviter de sombrer en conjecture stérile sur les vertus du blockchain et de décrédibiliser notre démarche en nous exposant aux risques d’une technologie dont les avis sur l’utilisation qu’on en fait dans le domaine financier restent encore largement partagés ? D’entrée de jeux, je dirais que nous sommes suffisamment armés en tant que banquier central pour anticiper et gérer ces risques sans réduire notre vue prospective sur le potentiel d’exploitation de cette technologie.
Donnons-nous une compréhension suffisamment simple de cette technologie pour faciliter la réflexion sur la place qui lui est réservée dans l’écosystème évoqué précédemment. Le blockchain est un domaine virtuellement illimité de registres hautement sécurisés d’information de natures diverses avec le degré de détails qui sied les besoins de transparence d’une activité spécifique. Son utilisation peut donc être de portée immédiate en aidant à alléger nombre de contraintes de nature institutionnelle ou à creuser certains goulots d’étranglement qui grèvent la création de valeurs productives de coûts de transactions souvent prohibitifs pour l’investisseur. L’exemple qui nous vient tous à l’esprit dans le domaine de la production agricole est la facilité d’utilisation de cette technologie en matière de traçabilité et de certification de produits. Une possibilité de grand intérêt dans le cadre d’une stratégie de développement de l’agriculture bio d’exportation. Cette facilité peut doter les filières de l’élevage des mêmes effets de levier.
L’utilisation de la technologie du blockchain peut-être aussi de portée structurelle. Dans cette optique, elle est pleine de promesses pour des domaines aussi divers que l’identification de titres de propriété, élément central dans tout processus efficient de modernisation de secteur agricole, notamment par rapport au problème de financement qui le grève. Elle a les qualités d’un raccourci technologique important qui permette d’améliorer la productivité dans des champs qui couvrent un large horizon temporel d’activités. Les produits financiers qui pourraient servir au financement des filières liées à la production agricole en font largement partie. Et fort heureusement. Car dans un contexte institutionnel où l’intermédiation bancaire est prédominante sinon exclusive, le blockchain crée pour l’agri business la perspective de financement direct dans le cadre de schémas d’investissement souvent déconseillés à la banque conventionnelle astreinte à des normes prudentielles plus contraignantes. Citons les quelques schémas suivants :
La levée des fonds à travers des Initial Coin Offerings (ICO). Il s’agit de… ) d’un processus moins coûteux, plus accessible et plus rapide que la mobilisation de ressources à travers un financement bancaire ou des fonds de capital-risque;
La création de produits d’assurances et de couverture de risques à travers des contrats dont l’honnêteté est garantie par la vérification informatique en temps réel de leur processus d’exécution. Dits smart contracts , ces schémas peuvent ainsi être utilisés pour assurer l’exécution de contrats d’assurance indicielle dans le secteur agricole en particulier en raison de leur cout réduit et leur moindre vulnérabilité par rapport à la fraude.
La facilitation des transferts de fonds en réduisant notamment le coût des transactions.
La nature même du BlockChain en fait une technologie applicable dans presque tous les domaines d’activités. Et les controverses qu’elle suscite peuvent se révéler salutaire pour un développement rapide de ses potentiels dans le cadre d’une utilisation normalisée. Il est souhaitable que les institutions nationales qui ont les moyens suffisants et les compétences adéquates dans les technologies de l’information s’intéressent de plus près au blockchain. La BRH se trouve déjà en mode veille dans le domaine. Il s’agit de se doter des capacités nécessaires à l’exploitation efficiente des opportunités qu’elle offre tout en évitant les pièges liés à une utilisation déviante et les coûts indus liés à la fraude. Il s’agit, sur une base plus large, de faire profiter l’économie des vertus de cette technologie dans le cadre d’une attitude proactive et stratège et non passive comme a été le cas avec l’internet dans le milieu des années 90.
Si les effets induits par cette technologie sont à la mesure des espérances, « des pans entiers de l’économie dans des domaines aussi divers que la finance, l’informatique, la logistique ou l’agriculture sont appelés à être affectés par cette technologie avec des possibilités de création d’emplois, de nouveaux champs de métier et d’opportunité d’affaires. De ce point de vue le blockchain est un outil technologique plein de promesses pour le développement des activités économiques. A ce titre cette innovation peut jouer un rôle important dans l’agenda pro-croissance de la BRH et est susceptible de mettre un nouvel outil technologique au service de la création de richesse de manière durable et équitable. » Gardons donc les pieds sur terre en scrutant avec méthode l’horizon technologique.
Mesdames, Messieurs,
Un discours ne saurait faire le tour de la problématique de financement de l’agri business en Haïti. Un champ d’activités inter sectorielles qui tourne autour du secteur stratégiquement et socialement le plus important pour le pays : celui de l’agriculture. Je me tiendrais rigueur de ne pas développer assez certains aspects de l’idée d’écosystème que nous voulons promouvoir si je n’avais pas la certitude de leur développement dans les discussions approfondies qui vont courir sur les prochaines jours des sessions.
Certains aspects qui ont à voir avec les interrelations entre le financement de l’agro business et notre agenda monétaire pour la croissance doivent être rigoureusement analysés si l’on veut faire du schéma de financement que nous proposons une expérience pilote. L’idée d’écosystème cadre bien avec notre propos. Elle configure avec justesse l’angle de vue que nous voulons voir traverser dans l’action de développement du secteur où cette notion trouve son expression la plus entière.
Je suggèrerais bien la nécessité de deviser sur les controverses suscitées par le foisonnement d’activités qui gravitent autour du blockchain. Ce ne serait qu’un pavé dans la marre si je n’étais pas acquis à l’idée, qu’en matière précisément d’idées, le meilleur confort vient de la confrontation. Ces controverses viennent donc à point nommé dans cette phase de maturation de cette technologie. Elles en garantissent une plus forte viabilité si elle tient la route par rapport aux attentes qu’elle suscite.
Mesdames, Messieurs,
Nous voici donc partis pour la collecte des idées. Mon début de discours voyait plutôt dans ces assises un espace de semence des idées. Puissante nature qui fait de la poule l’oeuf qu’elle pond. Aussi de la semence à la collecte il y a l’espace matriciel de la maturation. Le sommet de la Finance est devenu cet espace de maturation d’idées. Et il sème à tout vent pour emprunter cette image du petit Larousse des années d’antan.
Je vous invite donc à trinquer au succès de ces assises. Car le meilleur cru se boit à la période des grandes récoltes. Que les réflexions de cette semaine nous conduisent à l’ère des récoltes fructueuses pour le secteur agricole. Je voudrais ici exprimer le voeu de chacun des multiples participants à cette 8ième édition du Sommet de la Finance. Et c’est aussi mon voeu le plus précieux.
Merci!
Monsieur l’ancien Premier Ministre,
Messieurs les anciens Gouverneurs,
Chers collègues du Conseil d’Administration de la BRH,
Mesdames/ Messieurs les représentants du système financier et du secteur privé des affaires,
Mesdames/Messieurs les représentants du secteur public,
Mesdames/ Messieurs,
Chers invités,

Au nom du Conseil d’ Administration de la Banque de la République d’Haïti et de la Coordination de l’Institut de Formation de la Banque Centrale, je vous souhaite la bienvenue au Centre de Convention et de Documentation de la BRH et à cette conférence sur un thème d’importance stratégique à plusieurs points de vue.D’abord, il est au cœur de l’action de l’Administration Centrale pour les préoccupations liées à la production et à la nécessité de réduire le déséquilibre de la Balance commerciale.
Ensuite, la problématique du secteur agricole et de son financement est l’un des piliers de la stratégie pro-croissance de la BRH qui explique la mise en place par l’institution de maintes initiatives en faveur de ce secteur générateur de valeurs ajoutées de bonne qualité.
Devrais-je rappeler ici que l’agriculture est un secteur considéré en général par de nombreux pays dans leur stratégie de création de richesse, de croissance et de réduction de la pauvreté.
C’est ce qui suscite et justifie tant de recherches et de réflexions au niveau des états, des universités et d’institutions internationales et ce matin au Centre de Convention et de Documentation de la BRH où nous inaugurons, avec cette conférence/débats, un nouvel espace d’échanges pour relever le niveau du dialogue dans la communauté sur des thèmes d’intérêt collectif et sur des questions qui intéressent les politiques publiques. Et ceci en prélude aux “Jeudis de la BRH” qui débutera officiellement le 3 mai 2018 avec le professeur Nathalie de Marcellis-Warrin de l’École Polytechnique de l’Université de Montréal.
Je vous souhaite une bonne participation et de fructueux échanges.
Merci
Honorables Parlementaires
Mr le Secrétaire d’Etat aux Finances
M. Le Directeur Général de la Natcom
Chers collègues du Conseil d’Administration de la BRH
M. le Directeur Général du CONATEL
Mesdames, messieurs les membres de la Presse
Distingués invités,
Aujourd’hui est un pas important qui est franchi après 7 ans de collaboration entre la Natcom et l’Etat Haïtien. Car cette compagnie dont l’etat en possède 40% effectue pour la première fois sa déclaration de dividende à l’Etat Haïtien, à travers la BRH, dont j’ai l’honneur de présider le Conseil d’Administration.
Mesdames, Messieurs
Permettez-moi de saluer le travail effectué par toute l’équipe de la Natcom qui a su, avec dynamisme et professionnalisme, faire de l’institution ce qu’elle est aujourd’hui sur le marché de la téléphonie mobile.
Qu’il me soit permis de remercier le Conseil d’Administration de la NATCOM représenté par la Viettel et la BRH qui a œuvré à la mise en place de politiques stratégiques visant à améliorer la qualité des services offerts à la population et aussi présenté des plans intéressants destinés à toutes les bourses.
Travailler dans l’intérêt commun, fournir un service de qualité a un prix accessible tel doit être le crédo de la Natcom et c’est pour cela que nous sollicitons la collaboration de tout un chacun pour rendre la Compagnie plus solide et plus rentable. Natcom appartient aussi à Haiti ! C’est une compagnie nationale. Chaque haïtien a intérêt à s’approprier de cette société mixte pour qu’elle puisse rapporter des dividendes à l’Etat Haïtien et contribuer à l’augmentation des recettes fiscales.
Aujourd’hui, la Natcom veut aussi contribuer à doter le pays de cadres qualifiés, ainsi le Conseil d’Administration a soutenu fermement et obtenu de Viettel l’octroi de trente bourses d’etudes pour des formations d’ingénieur à des jeunes haïtiens qui auront la possibilité de se spécialiser dans les domaines du Génie et de la technologie dans des Universités Vietnamiennes internationales. Ce projet dont les modalités seront définies par Viettel et l’Etat Haitien est pour nous à la Banque Centrale très important car ces jeunes étudiants auront l’opportunité de se familiariser avec la culture entrepreneuriale du Vietnam, pays qui connait une croissance économique de plus en plus soutenue. La formation de ces étudiants dans des Universités Vietnamiennes doit aussi favoriser l’intégration Haïtienne sur le plan technique dans l’entreprise.
Encore une fois, je vous invite chers (es) concitoyennes et concitoyens à utiliser les services de la Natcom, dont l’Etat haïtien détient 40% des actions à travers la BRH.
Je vous remercie
Jeudi 25 janvier 2018
Chers Collègues du Conseil d’Administration,
Mesdames, Messieurs Les Directeurs Généraux des Institutions Financieres
Monsieur le Directeur de Turbo System,
Chers Collaborateurs,
Chers invités
Mesdames /Messieurs
Après des décennies dans le développement de systèmes informatiques et de technologies de l’information, comme dans l’univers financier national, à la fois dans le secteur privé et à la BRH, j’éprouve un plaisir tout particulier à introduire le Bureau d’Information sur le Crédit, notre BIC, à cette nouvelle étape de son expansion au bénéfice d’une croissance saine et durable de l’économie à travers la distribution du crédit.En décembre 2013, j’avais eu l’insigne honneur, comme Directeur Général de la BRH, de présider à la cérémonie de lancement des premiers essais de soumission de données avec les banques de la place. En quatre ans, le BIC a fait du chemin, ayant gagné la confiance des intermédiaires financiers et aussi une place stratégique dans le développement futur du système des paiements et, par conséquent, de l’économie.
Je me permets de vous rappeler brièvement que le Bureau d’Information sur le Crédit, initié par la Banque de la République d’Haïti dès 1999, a pour principale mission d’opérer un système d’informations sur les antécédents de crédit des agents économiques du système financier haïtien. L’idée de mettre en place le premier Bureau de Crédit vise à favoriser le partage de l’information sur le crédit et permettre ainsi aux diverses Institutions financières d’avoir une meilleure approche de l’octroi du crédit.
Les objectifs de cette nouvelle agence s’inspirent de la politique générale et de l’action à long terme du Conseil d’Administration de la BRH qui veut s’attaquer au défi majeur de démocratiser le crédit tout en limitant les risques. Le BIC est appelé également à jouer un rôle majeur dans la politique d’inclusion financière de la banque centrale, conjointement avec les autres pouvoirs publics.
Mesdames, Messieurs,
Je vous disais que le Bureau d’Information sur le Crédit a grandi. Le nombre de rapports de crédit sollicités (par les offreurs de crédit) est passé de 5683 en juillet 2017 (début des opérations) à 12333 quatre mois après (en décembre), pour atteindre 62096 à date. Un tel dynamisme reflète l’intensité du marché du crédit ainsi que l’importance de l’information pour la gestion des risques et, par conséquent, l’importance croissante du BIC. Dans une perspective de moyen et long termes, des institutions comme le Bureau d’Information sur le Crédit (BIC), le Fonds de Développement Industriel (FDI), sont appelées à jouer des rôles stratégiques extrêmement importants dans l’économie et la BRH est prête à consentir tous les efforts pour leur permettre de faire face aux défis susceptibles d’affecter leurs performances.
Pour le BIC spécifiquement, nous anticipons une amélioration continue de leur base de données ainsi que l’incorporation de certaines fonctions de l’ancienne Centrale des risques. Il est prévu également l’intégration de trois institutions financières non bancaires, le FDI, la Sohfides et la Ayiti Leasing, et le démarrage d’un projet pilote d’admission des caisses d’épargne. Le BIC va également développer pour le système financier de nouveaux produits, c’est-à-dire, de nouveaux rapports sur le crédit comme la cotation de crédit ou le credit scoring, un outil, permettant une évaluation numérique du potentiel risque de prêter à un client, ce qui facilitera les prises de décisions d’octroi de prêt de manière rapide et équitable. Ce produit sera développé avec la firme FICO, le leader mondial dans le domaine des logiciels analytiques, grâce à un partenariat technique avec la firme Turbo System.
A cette phase des débats, comme le projet de credit scoring est l’objet de notre rencontre ce matin, je passe la parole à M. Darbouze, de Turbo System.
Merci !
Madame, Messieurs les Membres du Conseil d’Administration,
Monsieur le Directeur Général du Ministère de l’ Économie et des Finances,
Mme le Représentant Résident de la Banque Mondiale,
Monsieur le PDG du Groupe Croissance,
Mesdames, Messieurs les Directeurs de médias,
Mesdames, Messieurs les Directeurs et Cadres de la Banque de la République d’Haïti,
Mesdames, Messieurs les formateurs et Conférenciers,
Mesdames et Messieurs, les journalistes / participants du programme de formation,
Chers invités
Mesdames /Messieurs
J’inscris à dessein la cérémonie d’aujourd’hui dans la perspective plus large des interventions qui ont marqué ces neuf mois de formation pour porter l’accent sur le fait établi que, pour le praticien comme pour l’académique, la compréhension satisfaisante des phénomènes socio-économiques résulte d’un apprentissage continuel qui trouve ancrage dans la maîtrise et le renouvellement des connaissances sur une réalité elle-même en mutation constante. Il ne saurait donc être autrement pour le journaliste qui assure le relais entre le décideur de politiques publiques qu’est le praticien, et le bénéficiaire de politiques publiques qu’est le public, la communauté. L’éditorialiste, le communicateur, le chroniqueur l’analyste ou en général le directeur d’opinion que vous êtes, est un personnage essentiel de ce corps noble de métier qui donne substance à ce qu’on a convenu d’appeler à juste titre le champ des politiques publiques.
Vous comprenez donc l’insistance que je mets à faire transpirer l’idée que cette cérémonie consacre une porte ouverte à une démarche d’apprentissage continu à une époque où la rapidité, la complexité, la densité et l’horizon virtuellement infini des informations disponibles forcent à la réflexion et l’action novatrices davantage aujourd’hui par rapport à hier et davantage encore lorsqu’il s’agit de mettre en perspective ce que nous voulons tous de notre société de demain.
Mesdames Messieurs,
Bienvenue à la cérémonie de clôture de la première édition de notre programme d’ « Economie pour Journalistes ». J’en appelle à votre indulgence de ne vous adresser mes salutations d’usage qu’à ce stade un peu tardif de mon discours, diriez-vous à juste titre.. J’ai voulu que mes propos d’introduction soient suffisamment liminaires pour interpeller chacun et de façon singulière — passez-moi la redondance — pour interpeler donc chacun sur le besoin d’améliorer notablement la diffusion, la compréhension et l’efficacité de nos politiques publiques.
Permettez-moi de remercier avec emphase les grands commis de l’Etat et les responsables de média qui ont répondu à notre invitation. Ils représentent le premier niveau de leadership dans la chaine de transmission des signaux émetteurs et responsifs de politiques publiques. Je m’empresse en second lieu de saluer les cadres des administrations et les journalistes des différents média. Ils sont la cheville ouvrière de cette transmission.
Au nom du Conseil d’Administration, j’adresse mes félicitations aux formateurs de ce programme pour avoir été à la hauteur des attentes et aux journalistes récipiendaires dont l’intérêt et l’ esprit incisif ont permis de relever la qualité des échanges et le niveau de formation. Nous voici rentrés dans une ère de coopération qui déborde le champ strict des activités orthodoxes d’une Banque Centrale en matière de gestion de la cité. Cité évidemment prise dans son sens étymologique.
« Economie pour Journalistes » est une grande première. Je suis fier d’avoir la chance d’être un acteur de cette initiative qui ouvre la voie à ce champ de coopération et je voudrais que cette fierté soit contagieuse.
Mesdames, Messieurs,
La cérémonie d’aujourd’hui perdrait de son objet si elle ne met pas l’accent sur les attentes de l’autorité monétaire de ce champ ouvert de coopération avec les média. C’est une obligation de poids car, comme promis dans mes propos liminaires, je veux inscrire la cérémonie d’aujourd’hui dans la perspective plus large des interventions qui ont marqué ces neuf mois de séances fructueuses de formation. Aussi, permettez-moi d’expliciter les objectifs poursuivis par la Banque de la République d’Haïti à travers cette initiative.
- Premièrement, il s’agit de relever le niveau de dialogue entre l’ensemble des décideurs du système financier et le public par la mise en place d’un espace viable d’intermédiation dans la (dissémination) transmission de l’information économique et financière. Dans les prochains jours Mesdames et Messieurs et tout au cours de l’annee 2018, la BRH va s’evertuer a relever le niveau du dialogue dans le public en general a travers un programe tres mediatique d’Education Financiere, qui fait partie integrante de notre Strategie Nattionale d’Inclusion Financiere.
Aujourd’hui le couronnement de neuf mois de formation dans le cadre du programme « Économie pour Journalistes » porte la barre à un niveau plus élevé. Il dévoile la mise en place d’un pan nouveau et important des activités de la Banque Centrale dans sa quête renouvelée d’efficacité de la politique monétaire et de développement du système financier.
Nous sommes conscients du rôle fondamental que l’information bien traitée et bien digérée est appelée à jouer dans l’amplification de mesures bien pensées de politique publique. Elle contribue à raccourcir les délais de réaction et à conditionner les réflexes dans le sens espéré de ces réactions. Elle contribue également à pondérer ces réactions en fonction du degré des enjeux en présence, notamment, en ramenant les emballements souvent injustifiés du marché à des proportions plus raisonnables. Un public discipliné, éduqué et bien informé est donc un atout majeur pour le policy-maker averti et bien outillé. La Banque Centrale a travaillé à porter cette démarche au rang de stratégie. La création au debut de cette annee 2017 de la Direction de Communication répond à cet impératif.
- Deuxièmement, il s’agit de réduire l’asymétrie de l’information pour favoriser une meilleure formation des anticipations et de créer les conditions qui permettent aux politiques publiques de bénéficier assez rapidement des fruits d’une démarche de communication érigée en fonction stratégique.
L’un des enseignements fondamentaux de l’endiguement des premières vagues d’assaut de la crise financière de 2008 aux Etats-Unis d’Amérique a été l’importance de la fonction de communication dans l’efficacité de la Persuasion Morale érigée en instrument dans le domaine de politique publique. En Haïti, la résolution de crises monétaires d’ampleurs variables qui ont couru sur les vingt dernières années confirme l’importance de la fonction de communication dans la boite à outils du banquier central. Ces épisodes de crises ont montré la capacité de la persuasion morale à contenir les anticipations négatives principalement mues par des mésinformations volontaires et des considérations de nature extra économique. Autant d’expériences qui ont alimenté ce fond d’analyse qui nous vaut aujourd’hui la systématisation de cette démarche de service à la communauté de la Banque Centrale.
En inscrivant cette approche dans la permanence institutionnelle, la Banque de la République entend introduire un facteur d’échelle dans la conduite des politiques qui répondent à ses missions.
A un moment où nous voulons de la politique monétaire une posture plus engageante par rapport à l’environnement de croissance, la Banque Centrale ne saurait faire l’économie d’une fonction aussi importante que celle de la communication. Et nous en attendons fermement les dividendes quant aux effets de synergie et d’amplification recherchés dans la mise en œuvre des mesures inscrites dans notre vision de la politique monétaire.
Vous êtes donc, chers récipiendaires, en première loge d’une démarche qui fait de vous des partenaires privilégiés d’une nouvelle donne dans la conduite de la politique monétaire en Haïti.
Vous aurez donc à sensibiliser objectivement et sans parti pris les acteurs économiques sur le rôle de l’information en général et de l’information économique en particulier dans le processus qui conduit à la prise de décision. Ce faisant, vous vous taillerez une place de choix dans la démarche continuelle qui vise à réduire l’asymétrie de l’information économique et financière pour une meilleure formation des anticipations et des motivations qui orientent les choix des consommateurs comme des investisseurs. Si seulement 20% des transferts sans contrepartie pouvaient etre investis dans la production en lieu et place de la consommation, notre environnement economique s’en trouverait grandement ameliore.. Ce serait des investissements directs de plus de 400 millions de dollars chaque annee…De loin superieur a toute l’aide recue pour l’annee fiscale 2016-2017 (387 millions de dollars incluant l’appui budgetaire)
Enfin, dans la lignée des FED Watchers qui travaillent à décoder les signaux lancés par la Federal Reserve aux Etats-Unis pour les mettre à la portée des acteurs économiques, j’entrevois avec bonheur, la création, à terme, d’un groupe de BRH Watchers et plus largement de Public Policy Watchers appelés à informer les acteurs économiques haïtiens sur les tenants et aboutissants des éléments explicites comme des non-dits des mesures de politique publique.
Mesdames, Messieurs,
Il est donc évident que nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous comptons continuer nos activités d’information et de formation non seulement dans la capitale, mais aussi dans les différents départements du pays. Nous envisageons déjà pour cette première promotion de 17 journalistes des séances de rappel, de renforcement et de renouvellement des connaissances acquises. La perspective d’un cours niveau II, de séminaires animes par des experts de niveau international ainsi que d’autres projets est aussi envisagée.
Je veux avant de terminer réitérer mes remerciements à tous les professeurs et conférenciers qui ont eu à intervenir dans le cadre de ce programme et spécialement à l’ IFBC qui a conçu, planifié et mis en ouvre ce programme avec professionnalisme et passion. Je veux remercier de maniere particuliere Monsieur Ronald Gabriel qui a ete au niveau du Conseil d’Administration la cheville ouvriere de cette formation et je vous demande de l’applaudir.
J’adresse encore une fois toutes les félicitations du Conseil d’Administration aux récipiendaires et aux directeurs de médias qui ont consenti le sacrifice de les avoir rendu disponibles pour notre programme.
Merci !
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances
(Madame), Messieurs les membres de la délégation de l’IFAC
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Administration de l’OCPAH
(Mesdames), Messieurs les Représentants de l’Association Professionnelle des Banques,
(Mesdames), Messieurs les Représentants des autres secteurs de la finance,
(Mesdames), Messieurs les Représentants du Forum Economique,
Mesdames, Messieurs,
Chers invités,
Aux remerciements je voudrais ajouter les félicitations pour cette initiative d’ ailleurs très opportune parce que ce sommet sur la comptabilité coïncide avec l’adoption par la Banque de la République d’Haïti et ses partenaires d’un ensemble de mesures visant la modernisation de la pratique comptable et d’audit en Haïti.
L’objectif des états financiers, selon l’International Accounting Standards Board (IASB), « est de fournir une information sur la situation financière, la performance et les variations de la situation financière d’une entité, qui soit utile à un large éventail d’utilisateurs pour prendre des décisions économiques ». En effet, les normes comptables sont des règles qui font autorité en matière d’information financière. Elles précisent de quelle façon les opérations et autres événements doivent être constatés, mesurés, présentés et communiqués dans les états financiers. Elles visent à fournir aux investisseurs, prêteurs, créanciers et autres de l’information financière utile pour évaluer la capacité de l’entreprise à générer de la valeur.
La normalisation comptable permet donc d’édicter des méthodes, des conventions, des règles et des principes communs qui sont censés s’imposer à toutes les entités économiques. Elle offre une certaine rationalité apportant des gages de sérieux et de rigueur aux évaluations mais elle fournit les bases à partir desquelles les usagers pourront fonder leur jugement sur la qualité de l’information comptable. Autant dire que la normalisation est le pilier de tout système comptable, en ce sens qu’elle codifie le processus de production comptable, les mécanismes de contrôle et de vérification.
Les International Financial Reporting Standards –ou IFRS en bref- favorisent, ou tout au moins accompagnent, une économie financiarisée sans frontières. Orienté particulièrement vers les besoins d’information des actionnaires et des investisseurs boursiers, ce reporting financier constitue un instrument de contrôle et d’évaluation des décisions des dirigeants.
Mesdames, Messieurs
L’importance de la comptabilité a maintes fois été illustrée ces dernières années, souvent par des scandales à grand retentissement comme les affaires Enron, WorldCom, AIG ou Parmalat. C’est dans ce contexte que M. Hank Paulson, ancien Secrétaire au Trésor américain (entre juillet 2006 et janvier 2009), a qualifié la comptabilité de «fluide vital des marchés financiers ». Dans un monde où la complexité des opérations financières devient de plus en plus impressionnante, la comptabilité fournit les bases de la confiance sur laquelle reposent les marchés de capitaux. Quand on ne peut plus se fier aux données financières, c’est tout l’édifice des marchés qui est menacé. L’élaboration des normes comptables s’apparente donc à une forme de politique économique car à mesure que l’économie se complexifie, le choix de ce qui est mesuré devient de plus en plus difficile et déterminant.
La comptabilité, autrefois considérée comme un simple moyen de preuve, est devenue un outil indispensable au service de l’information dont l’objectif ultime est d’aider et de faciliter la prise de décisions. La qualité de l’information financière se retrouve en première place parmi les facteurs de choix des investisseurs. Cette information étant pour une grande part comptable à l’origine et, c’est tout naturellement que l’on cherche à développer des normes internationales qui permettront en plus d’obtenir des informations mais également des objets des transactions.
En ce sens, les normes comptables internationales revêtent une importance capitale pour le secteur financier, dépassant le cadre purement comptable pour toucher aux exigences de gouvernance d’entreprise et, en particulier, au besoin de rendre compte des actions effectuées, des décisions prises et de leur impact sur la création de valeur économique.
Mesdames, Messieurs,
Moderniser et stabiliser l’économie nationale et en particulier le secteur financier sont des objectifs primordiaux pour la Banque de la République d’Haïti. Un certain nombre de mesures prises jusqu’à date permettent à la BRH de s’assurer que la règlementation en vigueur au niveau du secteur bancaire est en harmonie avec certaines bonnes pratiques internationales en matière de comptabilité. Il reste que la pratique comptable en Haïti nécessite un renforcement significatif en vue de promouvoir un climat des affaires favorable à l’investissement privé et l’accès des entreprises au crédit et au financement à long terme. L’action de la BRH s’inscrit donc dans cette volonté de faciliter une meilleure transparence de l’information financière qui passe inévitablement par l’adoption et l’application de normes comptables qui correspondent un peu plus aux réalités économiques actuelles.
Etant donné la mondialisation, l’adoption de normes comptables reconnues internationalement favorisera l’accès des entreprises haïtiennes aux marchés des capitaux mondiaux, sans les débours importants que nécessiterait le retraitement de leurs états financiers. Depuis une vingtaine d’années, la mondialisation des échanges et des marchés financiers a modifié les méthodes de gestion des actifs financiers, éliminé les barrières entre les marchés et augmenté les choix des investisseurs. Nos entreprises ont là une opportunité de se développer grâce aux capitaux venant d’un plus grand éventail d’investisseurs, avec des effets positifs sur le développement économique du pays. Les entreprises, particulièrement les entreprises financières, désireuses d’attirer des capitaux ont intérêt à présenter et communiquer leurs informations financières dans un référentiel facile à lire et à interpréter.
En définitive, les entreprises du secteur financier qui veulent accéder au marché mondial des fonds pour leur croissance et leur expansion devraient appliquer au plus vite les normes internationales. La mondialisation financière nous pousse à changer de paradigme et nous voulons annoncer aujourd’hui un changement de cap en ce qui a trait à l’adoption des normes comptables internationales ou l’adaptation de celles-ci à notre réalité économique car tous les acteurs concernés doivent conjuguer leurs efforts en vue de doter le pays d’un référentiel comptable approprié proche des IFRS ou de les adopter purement et simplement.
Nous savons, en effet, que l’adoption des normes IFRS sur le plan national, particulièrement au niveau du système bancaire rentre dans le cadre d’un vaste chantier qui doit naturellement se faire par étapes et suivre une séquence d’actions appropriées incluant des actions prioritaires et des objectifs à moyen et long terme. Néanmoins, sur la base de diagnostics déjà établis et des recommandations formulées, nous pensons qu’il y a lieu de procéder rapidement à un état des lieux afin d’identifier les actions prioritaires à entreprendre à court, moyen et long terme. C’est dans cette perspective que la Banque centrale, de concert avec les entités concernées (le MEF et l’OCPAH), va travailler à la mise en place d’un plan d’action national qui fixera les principaux objectifs à atteindre de manière à doter le pays d’un cadre comptable pouvant contribuer à l’amélioration de la transparence financière des entreprises.
La BRH planche déjà sur une stratégie visant l’amélioration des pratiques comptables et d’audit en Haïti. Les principaux objectifs poursuivis sont le renforcement des capacités organisationnelles de l’OCPAH et l’ouverture du marché de l’audit (financier et technologique). Le but recherché ici c’est d’avoir dans ce secteur une offre de service de qualité qui contribuera à stabiliser le système financier et faciliter l’accès au crédit aux petites et moyennes entreprises.
En somme, Mesdames, Messieurs, dans son souci de développer, de moderniser et de renforcer le marché financier national, la BRH commence déjà à poser les jalons en vue de la création d’un marché de capitaux en Haïti. Tout comme l’adoption d’un référentiel comptable, il existe des contraintes structurelles et institutionnelles qu’il va falloir lever pour favoriser l’accès des entreprises haïtiennes aux capitaux internationaux. Il est donc essentiel que les entreprises commerciales, financières ou autres qui voudront faire appel à l’épargne privée nationale et/ou internationale communiquent aux investisseurs et autres parties prenantes des informations chiffrées, aussi objectives que possible, permettant à ces derniers d’apprécier la quantité et la qualité de valeur créée. Dans cette optique, les normes comptables internationales sont d’une importance capitale pour le secteur financier en ce sens qu’elle peut faciliter la mobilisation de capitaux pour les entreprises et contribuer à création de valeur économique.
De ce fait, il s’avère plus que nécessaire que des mesures diligentes soient prises pour l’amélioration de la pratique comptable dans le pays. Comme j’ai mentionné plus haut, il faut convenir que les chantiers sont grands mais à la faveur d’une conjugaison des forces et des moyens de tous les acteurs concernés, nous pourrons parvenir à initier tous les changements susceptibles de nous conduire vers une convergence avec les normes internationales.
La Banque de la République d’Haïti fait déjà et fera tout ce qui est en son pouvoir pour renforcer la profession comptable en Haïti et améliorer le climat global des investissements. Elle continuera à accompagner le secteur financier en créant un cadre propice à l’épanouissement des entreprises de ce secteur.
Je reste persuadé que les prises de position exprimées au cours de ce sommet feront œuvre qui vaille et que les résultats des travaux qui suivront seront palpables dans peu de temps.
Je vous remercie.
Jean Baden Dubois
Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti
Mesdames et Messieurs les membres des trois Pouvoirs ;
Monsieur le Maire de Port-au-Prince ;
Chers Collègues du Conseil d’Administration de la BRH ;
Monsieur le Président de la Fédération Nationale des Maires d’Haiti ;
Madame l’Ambassadeur de France en Haïti ;
Monsieur le Président du Groupe-pays Haïti ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des institutions et organisations partenaires ;
Mesdames et Messieurs, les Représentants de la presse ;
Mesdames et Messieurs les participants ;
Honorables invités ;
Mesdames et Messieurs
Et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Banque de la République d’Haïti (BRH) s’associe à cette initiative en tant que partenaire et hôte de cet événement qui bénéficie du soutien du Président de la République qui a tenu à rehausser de sa présence les assises de ce matin.
Nous accueillons avec autant de chaleur les éminentes personnalités étrangères qui, une fois de plus, nous ont témoigné leur amitié en venant participer à ces échanges, ici, au Centre de Convention de la BRH.
Je voudrais remercier particulièrement l’Ambassadeur de France, Madame Elisabeth Beton Delegue, d’avoir bien voulu seconder l’intérêt que nos élus locaux attachent aux accords de coopération auxquels donneront lieu ces Assises.
J’unis dans le même témoignage de remerciement la Fédération des Maires d’Haiti (FENAMH), le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) ainsi que les cadres haïtiens qui vont se prêter à cet exercice d’échanges d’expertise et de connaissances lors des séances thématiques et des ateliers prévus..
Honorables Invités ;
Mesdames et Messieurs ;
L’organisation de ces Assises dans cette enceinte est pour nous un motif de fierté dans la mesure où le tremblement de terre avait laissé un champ de ruines au centre-ville. Non loin du siège central de la Mairie de PAP, ce bâtiment et sa particularité architecturale sont devenus aujourd’hui le signe d’un engament ferme dans la revitalisation du centre commercial et administratif de la capitale et dans tout le processus de reconstruction du pays auquel toutes les municipalités ont leur rôle á jouer.
La tenue de ces travaux est, certes, un moment privilégié de cordialité bienveillante et de rencontres inédites, mais elle constitue aussi, à mes yeux, la réaffirmation de la volonté de nos collectivités de renforcer le réseau d’entraide sur des questions d’intérêt majeur pour nos deux pays et pour l’environnement.
Il s’agit de questions qui touchent à l’essentiel, au futur de notre planète, et qui figurent au premier rang des préoccupations de tout gouvernement responsable, qu’il soit local ou national : le changement climatique et la prévention des risques naturels, l’aménagement du territoire, le patrimoine touristique et culturel, l’éducation et la formation professionnelle, la mutualisation des moyens et des ressources, la gestion de l’eau et de l’assainissement, la société civile et la démocratie, la gestion des déchets, l’agriculture, l’agro-écologie et le développement rural, la fiscalité locale et l’autonomie des territoires, la coopération transfrontalière, les enjeux et la spécificité de la coopération régionale caribéenne.
Tous ces thèmes sont importants. Cependant, je voudrais faire quelques observations sur un point qui ne semble pas être au menu de ces Assises et qui mériterait d’être débattu. Il s’agit de la migration interne, c’est-à-dire les mouvements de population à l’intérieur du pays. Il me semble que les maires des grandes villes devraient considérer que la part importante qu’ils détiennent dans le budget national est un attrait de plus vers les grandes agglomérations avec tous les risques que cela représente.
J’encourage donc le gouvernement central et la FENAMH à aider les villes (attenantes) proches les moins pourvues à se doter de moyens adéquats dans le cadre d’une péréquation juste et équitable. Le développement doit être d’abord rural si l’on veut éviter les concentrations de populations de plus en plus vulnérables dans les zones urbaines.
Deux des thèmes cités plus haut sont au cœur de la problématique haïtienne: la prévention des risques naturels, l’éducation et la formation professionnelle. Sur le premier thème, la marge de manœuvre de la BRH est limitée, sur le plan légal, au regard de ses missions statutaires. Néanmoins, le support au secteur privé à travers, entre autres, l’accès de la jeunesse haïtienne à l’éducation et à une formation professionnelle et académique de qualité et de haut niveau est l’un des domaines privilégiés d’intervention du Conseil d’Administration que j’ai l’honneur de présider.
À cet égard, la BRH se félicite d’avoir accueilli le 24 août 2017 au Centre de Convention une délégation d’étudiants sélectionnés dans le cadre du programme Bourses BRH de l’amitié France-Haïti, initié par le Parlement haïtien et soutenu par la BRH et la France. A cette occasion, j’ai réitéré l’engagement de la BRH de continuer à investir dans le capital humain en vue de doter le pays de cadres plus qualifiés, au bénéfice d’une meilleure compétitivité et d’une croissance soutenue. Car, notre institution fait partie de celles qui croient que Haïti a besoin de voir émerger de jeunes leaders capables de porter des projets innovants et de montrer la voie vers la prospérité économique et le développement durable.
En d’autres termes, si elle se développe et s’amplifie, la coopération franco-haïtienne décentralisée peut devenir un levier important de l’action que mène la BRH en matière de renforcement des capacités et de développement du capital humain dans son approche de politique monétaire pro-croissance
Honorables Invités ;
Mesdames et Messieurs ;
Ces assises s’offrent donc comme une occasion de plus pour notre institution de prendre la mesure de son apport dans l’amélioration du capital humain dans un contexte où de nombreuses familles haïtiennes consentent d’immenses sacrifices pour financer les études et les frais d’installation de leurs enfants à l’étranger.
En effet, Haïti a transféré durant l’exercice 2016-2017 plus de 250 millions de dollars américains au reste du monde. Ces transferts incluent, pour une bonne part, le financement des études supérieures et techniques. Ce montant peut paraître insignifiant pour un pays comme la France, mais il représente 12.5% du budget national et plus de 8 fois l’investissement réalisé pour la mise en place de l’Université de Limonade dans le Nord.
Autrement dit, si nous pouvions ajouter 3 points de plus à la pression fiscale actuelle pour la porter à 15% du PIB estimé à 8 milliards de dollars, il serait possible d’avoir au moins un grand centre universitaire dans le chef-lieu d’arrondissement de chaque département du pays. Compte tenu des externalités positives associées à l’éducation, cela nous permettrait de produire une masse critique de juristes, de médecins, d’ingénieurs, d’agronomes, d’économistes et de financiers dont la FENAMH a tant besoin pour ses projets de développement local.
Cet effort fiscal est particulièrement nécessaire pour les collectivités locales compte tenu du faible taux de recouvrement observé dans les 146 communes du pays. En effet, l’administration fiscale y est peu performante, et, dans certaines communes, on a observé des variations importantes au niveau des recettes avec l’arrivée de nouveaux dirigeants locaux. Cela veut dire qu’il est absolument important de redresser la situation des finances locales pour permettre aux maires d’investir dans des activités économiques rentables qui vont à leur tour contribuer à l’élargissement de l’assiette de l’impôt local.
De même, comme indiqué plus haut, un effort de péréquation est indispensable pour tenir compte des différences entre le potentiel fiscal des communes riches et celui des communes pauvres afin de favoriser une dynamique d’ensemble dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets de développement et créer ainsi des conditions pour l’inclusion financière des couches vulnérables de la population.
En d’autres termes, le redressement budgétaire et l’équité fiscale sont des biens publics et représentent les seules solutions envisageables si l’on veut protéger les populations et éviter des cas observés ailleurs, où l’État a connu des faillites suite à l’accumulation des déficits budgétaires dans les collectivités locales qui viennent s’ajouter au déficit du gouvernement central.
Ces éléments nous donnent aussi une idée des efforts que nous devons réaliser pour financer le savoir dans le cadre d’une coopération intelligente et axée sur les résultats. Je ne doute pas que nous puissions y arriver, car comme le disait si bien Léopold Sedar Senghor : « dans le rendez-vous du donner et du recevoir, nous ne viendrons pas les mains vides ».
Au regard de ces considérations, Il est tout à fait possible d’envisager la coopération décentralisée comme un puissant outil de développement intégrant non seulement les dons et prêts en appui au budget, mais aussi des choix budgétaires cohérents, des partenariats de type public-privé et la levée de fonds d’investissement à travers des bons municipaux pour les projets d’envergure.
Cela me donne l’occasion de revenir sur les programmes pro-croissance de la BRH qui offrent des opportunités nouvelles aux maires capables d’améliorer la gouvernance dans leur région. Car, en matière de financement, les partenaires potentiels cherchent des « success stories » que la technologie peut relayer à travers les médias sociaux et les Assises comme celles qui nous réunissent dans cet édifice ce matin et toutes les autres qui auront lieu après.
Vous avez donc, Mesdames/Messieurs les maires d’Haïti, des éléments probants de la feuille de route qui devrait vous permettre, au terme de ces Assises, d’assurer dans les meilleures conditions possibles, le suivi et la mise en œuvre des résolutions qui auront été prises.
C’est sur ces mots d’engagement que je termine mon propos en vous souhaitant deux bonnes et fructueuses journées de travail.
Jean Baden Dubois
Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti
Distingués Invités,
Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,
D’abord, elle permet à la Banque Centrale d’Haïti de poursuivre le dialogue qu’elle a entamé avec d’autres entités de la Diaspora haïtienne. Il s’agit d’un échange fructueux, vital faut-il dire, un échange qui envisage, d’une part, comment intensifier le rôle déjà crucial que jouent les Haïtiens vivant à l’étranger dans l’économie d’Haïti. D’autre part, ce dialogue offre une occasion de suggérer à ces compatriotes des voies concrètes propices à une telle intensification de leur participation dans la production en Haïti. Nous voulons, par la valorisation des nombreux potentiels du pays, qu’ils bénéficient des opportunités d’investissement existant dans les secteurs porteurs et compétitifs de l’économie.
D’où le deuxième élément d’importance expliquant la participation de la BRH aux assises qui nous rassemblent aujourd’hui. Nous sommes heureux d’avoir été invités à interagir directement avec les vibrantes communautés haïtiennes évoluant dans les centres urbains majeurs de la vaste zone métropolitaine de New York, et des alentours. C’est donc pour moi une grande joie de saluer les Haïtiennes et Haïtiens ainsi que les amis et partenaires d’Haïti vivant à New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvanie, et même à Boston et le New England, et bien au-delà. Un salut spécial aux jeunes professionnels de la 2e génération, si nombreux dans les rangs de NAAHP, et qui constituent pour notre pays d’Haïti une réserve inestimable, et hautement souhaitée!
Mwen kontan anpil ke m avè nou jodi a !
Chers amis,
La thématique qui sous-tend mon intervention ce midi s’inscrit en ligne droite dans le sujet global de la conférence, à savoir:
Diaspora et croissance économique en Haïti:
Quelles voies d’engagement?
Le développement de notre pays requiert de l’économie d’Haïti une capacité à réaliser une croissance forte et à la maintenir pendant des années, sans fléchir. Sans entrer dans trop de détails, soulignons que les politiques publiques destinées à promouvoir cette croissance vigoureuse et soutenue sont globalement de deux catégories, chacune d’elles dotée d’attributions fondamentales pour toute nation. Il s’agit de la politique fiscale et de la politique monétaire. La politique fiscale est du ressort du Gouvernement et du Parlement. La politique monétaire est de la responsabilité de la Banque Centrale, laquelle a aussi la charge de veiller à la stabilité du système financier national et d’agir comme banquier de l’État. Une telle charge explique que la BRH ne cesse de mener des efforts visant une utilisation accrue des moyens importants dont elle dispose pour remplir sa mission.
Nous nous évertuons à jouer notre partition dans la création de ce climat propice à une croissance économique soutenue et durable par la stimulation de l’investissement privé, dont celui de la Diaspora.
Depuis plus de douze ans, la BRH a contribué au maintien d’un cadre macroéconomique relativement stable. Cependant, les taux de croissance économique élevés, capables de sortir de la pauvreté la majeure partie de nos sœurs et frères, n’ont pas été au rendez-vous.
L’acceptation par la BRH de l’invitation que lui a faite la NAAHP participe précisément de ces efforts. La Banque Centrale conduit sa mission en coordination avec le cadre de politiques économiques mis sur pied par les autorités gouvernementales. Une autre source de collaboration que nous prenons très au sérieux se retrouve dans le secteur privé, à l’intérieur du pays certes, mais aussi dans notre Diaspora toujours fidèlement présente, en solidarité avec la mère patrie. Nous croyons qu’en sus de cette solidarité, par vos transferts, par vos apports en capitaux et en know-how, vous pouvez et devez faire des profits en Haïti et, par la même occasion, favoriser le développement durable de votre pays.
C’est pourquoi nous sommes si heureux de nous retrouver parmi vous aujourd’hui. La Banque Centrale entend profiter de l’opportunité offerte par la conférence de la NAAHP pour partager avec les participants d’utiles informations qui pourront aider à nous mettre au même diapason en ce qui concerne l’évolution générale de la réalité économique haïtienne. De telles informations contribueront à jeter la lumière sur le cadre macroéconomique d’Haïti afin de mettre en évidence les conditions favorisant la maximisation des opportunités d’affaires viables existant dans des secteurs économiques porteurs.
Mais il ne suffira pas de partager des informations, si utiles soient-elles. Une conférence comme celle-ci fournit des possibilités de découverte, à divers niveaux, d’affinités multiples et de modalités de collaboration. Sur la base des informations fournies et des expériences déjà acquises sur le terrain en Haïti, ces possibilités devront permettre à nos sœurs et frères de la Diaspora, et surtout nos talentueux professionnels de la 2e génération, de s’intéresser beaucoup plus aux capacités latentes d’Haïti. Un tel développement est d’autant plus souhaitable que lesdites capacités ne demandent qu’à être fructifiées afin d’alimenter les potentiels du capacity building. De ce point de vue, il faut souhaiter que les jalons posés au cours de cette conférence soient autant de graines qui, semées à bon escient, génèreront les projets qui maximiseront les aubaines d’investissements dont regorge notre pays. Ces dernières ont d’ailleurs été clairement identifiées par des expertises tant nationales qu’internationales.
Distingués Invités,
Mon but aujourd’hui est de partager avec vous des données clés à propos de l’état actuel de l’économie haïtienne. Ce partage d’information vise un double objectif. Je souhaite avant tout qu’il vous porte à apprécier les opportunités d’affaires viables qu’offrent, chez nous, des secteurs économiques porteurs. Ensuite, je souhaite aussi que les détails, que je vais vous fournir, vous convaincront de prendre avantage desdites opportunités.
Mon intervention aura donc trois volets :
- D’abord, un survol du cadre macroéconomique de notre pays sur les derniers trente-cinq (35) ans. Il s’agira de jeter une lumière constructive sur les défis qui se dressent face à nous tous, question d’être bien imbus des efforts qui nous attendent.
- Ensuite, le rappel du potentiel d’investissements existant au sein de l’économie d’Haïti, un potentiel qui abonde en opportunités d’affaires pour une Diaspora dont le niveau sans pareil de transferts privés, et aussi d’autres contributions, en font déjà le pilier de l’économie haïtienne, un réservoir inestimable d’investissements aptes à stimuler le renforcement des capacités.
- Enfin, j’analyserai quelques exemples de projets d’investissement qui ont réussi en Haïti, puis je présenterai des mécanismes d’incitation mis en place par la Banque Centrale en support à des secteurs à forte capacité productive.
S’agissant du premier volet, qui concerne un survol du cadre macroéconomique d’Haïti, je vous invite à considérer deux ensembles d’observation.
Le premier est que de 1981 à 2016, l’économie du pays a connu une croissance moyenne d’environ 0,5% par an, et des épisodes d’inflation plus ou moins forte, surtout pendant les périodes 1992-1994 et 2003-2004. L’économie a aussi subi les effets tenaces de certains déséquilibres, dont celui du compte extérieur, entretenu par les carences des exportations par rapport aux importations ; et aussi le déséquilibre des finances publiques, alimenté par l’insuffisance des rentrées fiscales et la volatilité des flux d’aide externe. À cela il faut ajouter les aléas tels que les évolutions de la conjoncture sociopolitique, les dégâts causés par les catastrophes naturelles et l’impact de chocs externes comme l’embargo de 1992-1994, et aussi les chocs de prix externes, tels que ceux du pétrole et des céréales. Soulignons que ces chocs ont, pour beaucoup, été absorbées par le déficit du Trésor Public, ce qui s’est traduit par des déséquilibres macroéconomiques importants. Enfin, la parité fixe du taux de change, établie par convention depuis 1919 à 5 gourdes pour 1 dollar US, fut abandonnée au début des années 90. Trente ans plus tard, vers la fin de mars 2017, le taux de change effleura le seuil des 70 gourdes pour 1 dollar en raison principalement desdits déséquilibres.
Le deuxième ensemble d’observation est que les programmes de stabilisation mis en place de façon périodique par les autorités haïtiennes ont permis de limiter l’impact délétère de ces déséquilibres et aléas. Et les efforts consentis au cours des dernières années ont conduit à une amélioration relative de la performance macroéconomique. Mais le grand défi, pour nous tous, demeure la nécessité de tout mettre en œuvre, et sur tous les fronts, afin d’accélérer le rythme de la croissance par la maximisation des potentiels de vos investissements dans les secteurs porteurs. Il devrait en résulter une amélioration substantielle du pouvoir d’achat et des conditions de vie de la population sur le long terme.
Chers compatriotes de la Diaspora,
Le pari économique haïtien est de taille, mais les problèmes ne sont pas insurmontables. Il ne faut surtout pas baisser les bras. De son côté, si la BRH se donne une claire conscience des défis qui se posent à notre pays, c’est pour signaler l’urgence de se mettre au travail sans tarder et de redoubler d’efforts afin de relever ces défis, une fois pour toutes. Dans cette perspective, la Banque Centrale d’Haïti se veut simplement une institution au service du progrès de notre pays, dans l’optique d’une Haïti inclusive. Elle se voit comme un maillon au sein d’une grande chaîne nationale, un partenaire parmi tant d’autres, prêt à apporter une franche collaboration à tout effort de développement conforme à ses attributions statutaires.
Et cette idée me fournit l’occasion de passer au deuxième volet de cette présentation, pour rappeler et les bonnes perspectives de l’économie haïtienne, et la place que doit y jouer ce partenaire indispensable qu’est la Diaspora.
S’agissant des bonnes perspectives, considérons les quatre (4) indicateurs de performance suivants :
- Le taux de croissance annuel moyen de l’économie s’est fixé autour de 2% au cours des 5 dernières années, et il est anticipé un résultat plus robuste pour l’exercice fiscal 2017-2018.
- Durant l’exercice fiscal qui vient de s’achever (2016-2017), les réserves de change nettes ont augmenté pour dépasser le seuil du milliard de dollars.
- Le taux de change s’est écarté de la barre de 70 gourdes pour un dollar qu’il avait presque touchée à fin mars 2017, pour décliner graduellement et atteindre 62,47 gourdes pour un dollar à fin juillet, niveau où il s’est relativement stabilisé. Quant à l’inflation de fin de mois évaluée en glissement annuel, quoiqu’étant encore relativement élevée par rapport aux niveaux de 2010 à 2014 (5 % environ), elle est revenue de la pente ascendante suivie de février 2017 (13,9 %) à juin (15,8 %), pour se stabiliser à 15,6 % en juillet et 15,4% en septembre. Notons que ce taux d’inflation est attribuable principalement aux effets rémanents de l’impact de l’ouragan Matthew sur l’offre agricole et à l’ajustement des prix à la pompe des produits pétroliers effectué durant le 3ème trimestre de l’année fiscale écoulée.
- Le financement monétaire du déficit budgétaire a été réduit de plus de moitié sur la période allant de la fin de l’exercice 2015 à la fin de l’exercice 2016. Il est passé de 9,9 milliards de gourdes au 30 septembre 2015, à 4,5 milliards de gourdes au 30 septembre 2016. L’amélioration de la situation des finances publiques devrait se poursuivre, d’une part, avec le maintien de l’accord de cash management établi entre le Ministère de l’Économie et des Finances et la BRH et, d’autre part, avec la baisse progressive des subventions importantes accordées par l’État haïtien sur les achats de produits pétroliers. Soulignons que la stratégie du cash management consiste à poursuivre une gestion efficace, c’est-à-dire sans gaspillage ni excès, des flux de trésorerie et des soldes de trésorerie à court terme du gouvernement.
Les interventions programmées par la Banque Centrale sur le marché des changes devraient, en conjonction avec d’autres mesures tant de la BRH que des autorités de l’État, contribuer à contenir les pressions inflationnistes. De manière plus générale, les mesures en cours ont plus de chance de réussite sur le long terme avec la mise en place d’une stratégie de relance économique tablant sur l’orientation progressive desdites mesures vers la consommation de biens et de services produits localement, plutôt que la consommation de produits importés. Une telle stratégie se fonde sur une conjonction de trois (3) facteurs, à savoir le renforcement de nos institutions, la réduction des imperfections du marché et la minimisation des contraintes structurelles majeures auxquelles est soumise notre économie.
Renforçant les bonnes perspectives, il y a aussi des avantages comparatifs dont notre pays peut se prévaloir au sein de la zone Caraïbe. Du nombre de ces avantages, citons les atouts suivants :
- La proximité de marchés importants, auxquels le pays bénéficie d’un accès avantagé.
- Un capital historique et culturel d’une richesse imposante.
- Un relief frappant, composé par une géographie qui alterne montagnes et plaines majestueuses serties de plages magnifiques, créant un cadre amène pour le développement durable, touristique en particulier, y compris écologique et culturel.
- Une population jeune dont le dynamisme assure le miracle quotidien de la survie à partir de très peu, et qui ne cherche qu’un minimum de possibilités et d’encadrement pour accomplir sur le sol natal les succès que remportent ses compatriotes vivant à l’étranger.
- Une diaspora fiable et fidèle, principale pourvoyeuse du pays en devises fortes et pépinière en puissance d’investisseurs et, surtout, de ressources humaines dans pratiquement tous les domaines. Et là, on n’insistera jamais trop sur le rôle potentiel de la 2e génération, ces jeunes Haïtiennes et Haïtiens très attachés à la terre de leurs ancêtres malgré qu’ils soient nés aux États-Unis et ailleurs.
- La résilience de la population, liée aux valeurs ancestrales, transmises de génération en génération, qui fait d’Haïti, malgré l’image négative qu’on persiste à lui attribuer, l’un des pays les plus sécuritaires du continent, avec un taux de meurtres par 100 000 habitants parmi les plus faibles. D’autres nations de la région s’enorgueillissent de leur performance sur le plan des investissements directs étrangers et du tourisme avec des taux de criminalité beaucoup plus élevés.
Mais, parlant de Diaspora, justement, quelle pourrait être la contribution de celle-ci dans la mise en œuvre des bonnes perspectives et l’exploitation des avantages comparatifs ?
Considérons d’abord la question du rôle de la Diaspora sous un angle historique.
La contribution financière de la Diaspora figure parmi les flux de capitaux les plus importants dirigés vers Haïti, avec une tendance à la hausse depuis le milieu des années 1990 et une nette accélération à partir de 2010. Haïti est le troisième plus grand bénéficiaire de transferts dans la Caraïbe. Les transferts de notre Diaspora sont passés en moyenne de 5% du produit intérieur brut (PIB) durant la période 1992-1996, à près de 23% du PIB sur la période 2011-2016. Dans le même intervalle, l’apport des transferts au financement du déficit commercial d’Haïti est passé en moyenne de 27% à 70%. En 2015, les transferts excédaient le flux d’investissements directs étrangers par un multiple de 20. Depuis le début des années 2000, les transferts des Haïtiens vivant à l’étranger sont devenus la principale composante de l’offre de devises en Haïti.
Au-delà de cette contribution financière très importante, la Diaspora fournit à Haïti un potentiel considérable sur le triple plan de la hausse de la productivité, de la formation du capital humain et de l’essor du secteur du logement. En effet, selon une étude publiée par la Banque Interaméricaine de Développement (BID), l’éducation représente, après l’alimentation, le deuxième poste le plus important dans les dépenses des bénéficiaires de transferts. L’enquête souligne que la contribution de la Diaspora est tout aussi significative dans le secteur du logement.
L’évidence est claire : le caractère unique du poids que la Diaspora en est arrivée à se donner dans la réalité économique de notre pays est incontestable. La question maintenant est de savoir comment assurer un ancrage encore plus profond de la Diaspora en terre natale, particulièrement en termes de participation à l’agenda de croissance forte et soutenue dont il fut question plus tôt.
Ce point nous amène au 3e et dernier volet de mon intervention, lequel dévoilera quelques exemples de projets d’investissement qui ont réussi en Haïti. L’idée est de montrer que, dans notre pays, ce ne sont pas les opportunités d’affaires qui manquent aux investisseurs, de la Diaspora surtout. Ensuite, je décrirai des mesures élaborées par la BRH comme incitation au secteur productif et aux exportations.
Dans le cas des investissements locaux, des montages financiers de qualité ont permis d’intégrer l’apport de partenaires de la Diaspora dans le capital d’entreprises locales. Ces montages ont été réalisés dans trois secteurs clés de l’économie : l’industrie alimentaire, l’hôtellerie et la production d’énergie. De plus, des investissements directs étrangers, ou IDE, ont été effectués, avec pour souci l’intégration de la production locale dans des chaînes de valeur, comme dans le cas de la Brasserie Nationale, ou Brana, et celui du petit mil. D’autres success stories ont été réalisées avec des entreprises fonctionnant dans le secteur de la téléphonie mobile et des établissements hôteliers liés à des franchises internationales.
Nous ne saurons trop exhorter le déploiement des investissements directs étrangers en Haïti. Contrairement aux investissements de portefeuille, les IDE sont peu volatiles. Leur impact sur l’emploi, sur l’assiette fiscale et sur la croissance économique est plus stable. De plus, les IDE occasionnent souvent des apports en nouveaux savoir-faire, en nouvelles technologies, en nouvelles techniques de production et de gestion. Ils contribuent donc à enrichir leurs secteurs d’activité en les rendant plus productifs et plus compétitifs, et en leur facilitant l’accès aux marchés internationaux, souvent à travers leurs réseaux d’entreprises. À titre d’illustration, prenons le business hôtelier qui, de nos jours, relève de réseaux constitués d’agences de voyages (réelles ou virtuelles), d’agences de croisière, de lignes aériennes, de services d’assurance, etc.
La Diaspora a tout intérêt à rechercher des mécanismes susceptibles de générer en Haïti des projets alimentés par des investissements directs étrangers, et aussi par des prêts bancaires transfrontière. Une telle initiative, menée systématiquement sous tous les cieux où se retrouvent des investisseurs potentiels de la Diaspora, aiderait à la mise sur pied du cercle vertueux qui induira l’émergence d’autres success stories à travers l’élaboration d’un cadre où l’investissement public jouera pleinement son rôle de catalyseur de l’investissement privé, notamment, bien sûr, celui de la Diaspora. Ceci est d’autant plus urgent que l’épargne intérieure privée en Haïti est très faible par rapport aux besoins énormes de financement qu’implique le développement durable, tandis que le système financier haïtien ne dispose que d’environ 1,4 milliard de dollars de ressources qui pourraient, lorsque les circonstances le permettront, être orientées vers des projets porteurs viables, présentant un niveau de risque raisonnable.
Quant à l’appel à l’épargne extérieure, laquelle combine les dons officiels, les prêts publics et les prêts privés, il reste conditionné aux exigences des organismes multilatéraux de financement et aux disponibilités que permet la performance économique des bailleurs de fonds bilatéraux. Il y a donc lieu de minimiser certaines contraintes structurelles et institutionnelles afin d’aménager un accès direct à l’épargne privée et, de là, œuvrer à l’approfondissement du marché financier. Par exemple, l’accès aux capitaux internationaux pourrait être favorisé, d’une part, par la mise en commun des ressources locales et de celles de la Diaspora et, d’autre part, par l’élaboration d’instruments de garantie internationale et d’autres mécanismes de mitigation des risques.
Cet ensemble de contraintes peut être transformé en opportunités, pour vous, frères et sœurs de la Diaspora. Permettez que je vous communique, en tant que « policy maker » et acteur évoluant sur le terrain, les pistes suivantes :
- Il y a lieu d’améliorer votre capacité associative autour de projets d’envergure. L’entreprise individuelle, de petite taille, à faible niveau de capital, est très vulnérable aux chocs et est assujettie à des dépenses d’opération élevées ;
- Il y a des opportunités dans des domaines à fort potentiel de demande au sein même de la Diaspora, tels que les développements résidentiels gardiennés (gated residential communities), destinés aux retraités ou à d’autres acquéreurs intéressés
- La diaspora peut investir et participer à la gouvernance, par l’apport en capitaux de long terme ou par l’acquisition d’actions dans des produits d’investissement tels que :
- des entreprises en pleine croissance, notamment les startups, dont l’évolution est limitée par des besoins en capital ;
- des entreprises dont le fort potentiel est affecté par toutes sortes de difficultés, surtout d’approvisionnement en capital ;
- des entreprises en vente ou en transfert de propriété;
- des partenariats public-privé ;
- Les principaux organismes financiers multilatéraux (IIC, IFC) et certains bailleurs bilatéraux disposent d’enveloppes au bénéfice de projets privés porteurs, notamment d’investissements directs étrangers, dont vous pourriez tirer avantage.
C’est dans la perspective de la recherche de nouvelles pistes de solution pour stimuler l’investissement en Haïti que la BRH a mis en œuvre des programmes spécifiques en vue de promouvoir certains secteurs productifs à forte valeur ajoutée, susceptibles d’avoir des retombées directes sur l’emploi et la croissance économique. Ces programmes d’incitation au secteur productif sont les suivants :
- Le programme KAY PAM, mis en place après le séisme du 12 janvier 2010 de manière à stimuler le crédit au logement en faveur de la classe moyenne. Il comporte les caractéristiques suivantes : le taux d’intérêt est compris entre 8% et 10%, et il est fixe sur 10 ans ; le financement est libellé en gourdes, et il porte sur la construction, la rénovation et l’acquisition de maisons.
- Le programme de développement des zones franches, mis en place en décembre 2015, et qui vise essentiellement à augmenter la capacité du pays à bénéficier des lois HOPE II et HELP , lesquelles ont été renouvelées par le Sénat américain en août 2015 pour 10 ans. Créé en partenariat avec les banques commerciales, ce programme permet non seulement d’accroître les exportations et le nombre d’emplois dans le secteur textile, mais aussi aux promoteurs de zones franches de se financer auprès des banques à des conditions favorables incluant un taux d’intérêt maximum de 7%.
- Le programme de financement des exportations établi suite à des protocoles d’accord signés en octobre 2016 par la BRH avec deux sociétés financières de développement, le Fonds de Développement Industriel (FDI) et la Société Financière Haïtienne Industrielle de Développement Économique et Social (SOFHIDES). Ce programme favorise l’accès au crédit pour les entreprises de production de biens et services destinés à l’exportation. Il comprend une fenêtre de refinancement des comptes à recevoir des exportateurs, et une facilité de crédit visant le renforcement des capacités de production des entreprises ciblées. Cela devrait mener à moyen et long terme à la réduction du déficit de la balance des paiements.
- Le programme d’incitation aux secteurs touristique et hôtelier, par lequel les banques sont exonérées de l’obligation de constituer des réserves obligatoires sur les ressources qu’elles utilisent pour financer des projets réalisés dans les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie. Lesdits secteurs peuvent ainsi obtenir du crédit à des taux d’intérêt plus favorables.
D’autres projets sont à l’étude dans le cadre des mesures d’incitation aux secteurs productifs. Il s’agit, notamment, de la promotion de projets de développement immobilier, de la promotion de la copropriété et de zones franches agricoles, et de la mise en place de garanties partielles de crédit et de programmes d’assurance au bénéfice du secteur agricole. Enfin, la BRH s’est récemment engagée dans une série d’activités de facilitation de dialogue et de réflexion entre les acteurs clés de différentes filières d’activité à forte valeur ajoutée. Cet exercice vise le renforcement des politiques et des mécanismes de financement capables d’influencer le développement économique du pays de manière durable.
Chers amis,
Au vu des opportunités d’affaires et des efforts d’accompagnement de l’État que je viens d’évoquer, j’invite la Diaspora à suivre l’exemple des devanciers qui, ayant choisi d’investir en Haïti, ont pour la plupart déjà pris place parmi les plus grands contribuables du pays. La Diaspora a tout intérêt à tirer avantage de formules qui ont donné la preuve de leur efficacité. Sa contribution au développement de la terre natale passerait à un niveau autrement important si elle complétait ses transferts traditionnels avec des initiatives orientées vers l’investissement en Haïti.
Les associations régionales et locales de la Diaspora pourraient s’associer aux autorités haïtiennes, notamment les municipalités, dans une logique de partenariat public/privé destiné à financer les projets de développement régional. Les besoins d’investissement ainsi que les opportunités qui en découlent sont immenses dans les infrastructures socio-économiques de base comme l’éducation, la santé, la distribution de l’eau potable et les énergies renouvelables. La Diaspora pourrait aussi investir directement dans les entreprises qui acceptent d’ouvrir leur capital. Il s’agirait de promouvoir l’expansion ou la création d’entreprises d’économie mixte dans le cadre d’opérations conjointes avec des institutions déjà impliquées dans ce type d’activité comme le Fonds de Développement Industriel (FDI) et la Société Financière Internationale (SFI). Enfin, outre la création de chambres de commerce régionales et la mise en place de réseaux d’affaires, la contribution de la Diaspora peut aussi s’étendre aux échanges commerciaux et aux transferts de compétences et de technologies.
Ce dernier aspect s’adresse particulièrement aux jeunes professionnels de la 2e génération, dont nous avons entendu parler des prouesses sur le marché du travail nord-américain, et jusque dans les salles du conseil d’administration des grandes entreprises, et même dans la Maison Blanche de l’ancien Président Barack Obama. Bref, ces jeunes Haïtiennes et Haïtiens nés en dehors d’Haïti, et dont les succès en terre étrangère font notre fierté à tous.
Voilà, Mesdames, Messieurs, quelques initiatives qui pourraient progressivement permettre à la Diaspora de maximiser les opportunités d’investissement en Haïti. La Banque de la République d’Haïti joue sa partition à travers des mesures pro-croissance destinées à promouvoir le secteur productif et d’exportation, et à aider à transformer le cercle vicieux dans lequel nous sommes en un cycle vertueux de croissance forte et soutenue, de réduction drastique de la pauvreté et d’amélioration substantielle continue du niveau de vie de la population.
Je vous remercie de votre attention.
Jean Baden Dubois
Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti
La BRH reçoit une délégation d’étudiants sélectionnés dans le cadre du programme “Bourses BRH de l’Amitié France-Haïti”.
Ce programme a été initié par le Groupe d’Amitié France-Haïti au Parlement, en partenariat avec la BRH et l’Ambassade de France.
La cérémonie s’est déroulée en présence du Président du Groupe d’Amitié France-Haïti au Parlement, le député Jerry Tardieu, du Conseiller et Chef de coopération et d’action culturelle à l’Ambassade de France, M. Laurent Bonneau et du Conseiller technique international auprès de l’Ambassade de France en Haïti, M. Jean Marie Théodat.
Cette rencontre avec les boursiers a été suivie d’une conférence de presse au cours de laquelle le Gouverneur Jean Baden Dubois a réitéré l’engagement de la BRH de continuer à investir dans le capital humain en vue de doter le pays de cadres plus qualifiés, au bénéfice d’une meilleure compétitivité et d’une croissance soutenue de l’économie.
C’est donc pour moi un immense plaisir de prendre la parole dans le cadre de cet événement prestigieux, qui, sans nul doute, contribuera à mettre en valeur les nombreux potentiels économiques du département de la Grand’Anse. Le département doit se relever des conséquences néfastes de l’ouragan Matthew, par la création d’un climat favorable à l’investissement privé.
Depuis le séisme du 12 janvier 2010, la BRH tente de jouer sa partition dans la relance de l’économie nationale à travers des mécanismes de stimulation du crédit productif, c’est-à-dire, à forte valeur ajoutée et avec des effets induits sur la croissance économique, les exportations et la création d’emplois durables. Sous mon administration, à l’intérieur d’un cadre de politiques publiques qualifié de « pro-croissance », ces mécanismes initiés dans le secteur immobilier ont été renforcés et étendus à d’autres secteurs économiques, notamment l’Agriculture et l’Agro-industrie. C’est donc dans ce contexte particulier que je vais vous entretenir des objectifs visés par ces mécanismes.
La BRH, de par sa loi organique, entend utiliser les moyens dont elle dispose pour conduire la politique monétaire d’Haïti et veiller à la stabilité du système financier national. En exécutant ce mandat, elle s’assure que ses actions sont inscrites dans le cadre de relance défini par les autorités gouvernementales.
Je me réjouis toujours de participer à ces rencontres qui offrent l’occasion d’échanger des idées, de débattre et de partager des réflexions en vue non seulement d’aider à la stabilité macroéconomique, mais aussi de contribuer à une croissance robuste et durable. A l’instar de celle des autres régions du pays, la population Grand’Anselaise estimée, en 2015, à environ 468 000 habitants, est jeune et en quête d’opportunités. Les politiques publiques n’ont jusqu’à présent pas produit le niveau de bien-être collectif auquel elle aspire et auquel elle a droit. Nous voulons, à travers ces mécanismes incitatifs, articulés avec d’autres programmes publics, lui donner la chance de travailler, d’entreprendre, afin de réduire sa dépendance par rapport aux transferts privés de nos sœurs et frères de la diaspora. Nous voyons aussi en notre participation, une occasion d’apprécier, au niveau de la Grand’Anse, la carence d’information qui prévaut à travers le système financier national et qui affecte l’allocation efficiente de l’épargne aux investissements viables. La BRH entend tout mettre en œuvre en vue de rendre disponible les informations relatives à ses politiques, aux mesures adoptées et aux projets sur lesquels elle travaille. Dans cette optique, une nouvelle Direction de Communication y a été créée afin d’améliorer le circuit d’information avec le Grand Public à l’échelle nationale. En conséquence, je vous donne la garantie que la Grand’Anse ne sera pas laissée pour compte dans ce processus.
Sans vouloir réveiller des souvenirs douloureux qui nous ont fait tous souffrir après le passage de l’ouragan Matthew, je dois quand même dire que ces évènements ont été pour moi l’occasion d’apprécier le courage et le sens de solidarité de la population Grand’Anselaise. Permettez-moi de saluer la résilience de cette population qui, en dépit des catastrophes et des situations dramatiques, a toujours su se relever pour construire et se reconstruire. Comme un Phénix, cette population sait comment renaître de ses cendres. Les peuples qui savent construire ne peuvent pas disparaître. C’est cette pensée qui motive les gens à investir et à faire un pari sur l’avenir. Rien de splendide n’a jamais été réalisé, sauf par ceux qui ont osé croire que quelque chose à l’intérieur d’eux-mêmes était supérieur aux circonstances. – Bruce Barton. Aussi, tirons les leçons qui s’imposent et repartons sur de nouvelles bases en faisant mieux cette fois-ci, de manière structurante et pérenne.
Mes chers amis
Nous sommes dans une région qui, à travers l’histoire, a toujours été? considérée comme l’un des principaux greniers du pays, notamment pour la qualité? de ses fruits (café?, cacao et arbre véritable), pour la diversité? de ses tubercules et pour l’abondance de ses côtes en fruits de mer. A cela, il faut ajouter les nombreux potentiels touristiques et éco-touristiques qui jusqu’à date sont quasi-inexploités.
Je salue l’action de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Grand’Anse (CCIGA), qui, a? travers son concept de plan régional intégré? 2012-2014, comptait essentiellement sur les facteurs suivants : un éveil des hommes, une mise en commun des ressources, un alignement des capacités et organismes d’exécution dans le département pour atteindre et alimenter les marchés locaux et régionaux. Beaucoup d’idées contenues dans ce plan sont encore d’actualité et peuvent servir comme base de réflexion dans la mise en place d’un plan de relance de l’investissement dans la région.
Si l’on se base sur les capacités naturelles et autres potentialités de la région, il est à mon humble avis possible d’enclencher une dynamique de croissance nécessaire à l’amélioration du niveau de vie. Il suffit de le vouloir et d’y croire.
Les importations de produits alimentaires connaissent une hausse continue. En 1986-1987, elles représentaient 19,2% des importations totales. Ce ratio est passé à 27,7% en 2014-2015. En parallèle, le poids de l’agriculture ne cesse de baisser dans notre produit intérieur brut et, pour les mauvaises raisons. Il est passé d’environ 42% du PIB en 1970 à environ 20% aujourd’hui. Je dis, pour les mauvaises raisons, car ce déclin du poids de l’agriculture n’est nullement attribuable à une augmentation de celui des industries de transformation, mais à une dépendance accrue par rapport à l’extérieur. Il nous faut impérativement trouver la meilleure formule pour augmenter l’offre de produits et de services, sinon il sera de plus en plus difficile de contenir, à terme, les pressions inflationnistes et les fluctuations indésirables du taux de change. Notons que cette dépendance par rapport à l’extérieur nous a rendus de plus en plus vulnérables aux chocs externes, notamment les chocs de prix – par exemple, les troubles sociopolitiques ou « émeutes de la faim », d’avril 2008, causés par la hausse des prix internationaux de céréales en particulier du riz, dont le cours mondial est passé d’environ 500 à plus de 1250 dollars la tonne métrique durant la période concernée.
Les problèmes de change et d’inflation ne peuvent et ne pourront être résolus de manière définitive par la politique monétaire quand ils sont causés par des facteurs structurels tels que le déficit chronique de la balance des paiements et la diminution continue de la production. Donc, nous devons générer de manière permanente des quantités de devises supérieures ou égales à nos consommations en devises. E la pa gen wout pa bwa, fòk nou rekomase pwodui e rekomanse ekspòte.
Point n’est besoin de rappeler le rôle que doit jouer le secteur privé dans la création de la richesse nationale. L’augmentation de la croissance économique, la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie de la population exigent un secteur privé dynamique constitué d’investisseurs locaux et de la diaspora et d’investisseurs directs étrangers. Pour être efficace il est indispensable que l’investissement public remplisse adéquatement son rôle de catalyseur de l’investissement privé. Le pays se retrouve en situation d’épargne nationale négative avec une composante d’investissement du budget de la République tributaire des appuis internationaux. La création d’un climat favorable aux investissements directs étrangers est donc un passage obligé. Ces derniers qui traduisent en général un intérêt durable de la part du promoteur du projet envers le pays ciblé ont plusieurs vertus. Ils apportent les capitaux, le savoir-faire, de nouvelles demandes, la connexion aux réseaux internationaux. Les grandes chaines d’hôtels internationales font partie de grands réseaux touristiques qui comprennent agences de voyages, lignes aériennes, hôtels, restaurants, compagnies de location d’automobiles, écoles professionnelles, services de loisirs, chaînes d’approvisionnement agricole, etc. et qui viennent avec leur demande. Les Bahamas viennent d’accueillir un investissement direct étranger de 2 milliards de dollars dans le secteur hôtelier, le projet Bahama Mar. La Corée du Sud, fort de sa stratégie axée sur les investissements directs étrangers est passée, du début des années 60 à aujourd’hui, d’une balance commerciale caractérisée par des exportations de produits primaires d’environ 600 millions de dollars à des exportations de produits industriels estimés à plus de 600 milliards de dollars par année. Son PIB per capita est passé de 143 dollars en 1963 à près de 26 mille dollars en 2016 contre moins de 800 dollars pour Haïti et 6.910 dollars pour la République Dominicaine. Nos flux nets d’Investissement Direct Etranger n’ont jamais excédé historiquement 200 millions de dollars par an alors que pour la République Dominicaine et la Corée du Sud, ils ont atteint respectivement 2,5 et 10,8 milliards de dollars en 2016.
Mesdames /Messieurs
En tant qu’entrepreneurs, producteurs, chefs d’entreprises, vous connaissez très bien l’importance du crédit dans le développement de l’activité économique et le lien qui existe entre le crédit, l’investissement, la production et l’emploi. Toutefois, vous conviendrez avec moi que l’augmentation du crédit au secteur privé ne provoque pas automatiquement la croissance économique et la baisse du chômage. Rappelons qu’en 2014-2015 le crédit accordé par le système bancaire a augmenté de près de 20% après avoir crû en moyenne de 30% durant les exercices 2010-2011 à 2012-2013, alors que le taux de croissance économique n’a été que de 1,4% pour une croissance démographique de 1,8 %. Cette croissance du crédit a dans une large mesure favorisé des importations de biens de consommation au détriment de la production locale. Le niveau de pauvreté a donc légèrement augmenté durant cette période.
C’est dans ce contexte particulier que nous accueillons tout effort des autorités visant l’amélioration de la qualité des investissements publics, une meilleure cohérence des politiques publiques et la minimisation des freins structurels à la production, à l’investissement et aux exportations. Le système financier haïtien est très liquide. Il n’attend que cela pour orienter ses ressources oisives vers des projets porteurs capables de changer, de manière pérenne, la destinée de nos frères et sœurs haïtiens.
C’est donc dans cette perspective que la BRH a mis en œuvre des programmes spécifiques en vue de promouvoir certains secteurs productifs clés à forte valeur ajoutée et à fort potentiel, susceptibles d’avoir des retombées directes sur l’emploi et la croissance économique. Ces programmes d’incitation, qui vous seront présentés un peu plus tard, permettent un accès élargi au crédit en monnaie locale et à des conditions abordables. Ils visent notamment :
- L’augmentation de l’offre de logements et la baisse des loyers ainsi que la réduction des coûts de construction et une amélioration de l’urbanisation ;
- La stimulation du secteur de l’assemblage et des exportations et emplois y associés ainsi que l’augmentation du nombre d’espaces industriels disponibles dans le pays ;
- La stimulation des exportations en général, de la production locale et des rentrées nettes de devises de l’économie ;
- Le développement du secteur touristique, principalement à travers sa composante hôtelière ;
Les dits secteurs peuvent ainsi obtenir du crédit à des taux d’intérêt plus favorables.
D’autres projets sont à l’étude dans le cadre des mesures d’incitation aux secteurs productifs. Il s’agit, notamment, de la promotion de projets de développement immobilier ; de la promotion de la copropriété et de zones franches agricoles ; et de la mise en place, au bénéfice du secteur agricole, de garanties partielles de crédit. La BRH encourage tous les acteurs impliqués dans le développement de l’agriculture à mettre sur pied de mécanismes d’assurance, notamment pour les récoltes. Ces derniers doivent jouer un rôle clé dans la mitigation des nombreux risques auxquels est exposé le secteur et qui rendent le coût des crédits trop souvent dissuasif aux yeux des débiteurs.
Enfin, la BRH s’est récemment engagée dans une série d’activités de facilitation de dialogue et de réflexion entre les acteurs clés de différentes filières d’activité à forte valeur ajoutée à travers des tables sectorielles de concertation. La dernière en date, organisée par le Ministère de l’Agriculture, a porté sur la filière cacao. Cet exercice est basé sur l’identification des freins caractérisant les différents maillons de la chaine de valeur et qui en entament l’évolution. Il porte aussi sur l’élaboration de recommandations à l’autorité compétente pour la minimisation des freins identifiés. Il vise donc, le renforcement des politiques et des mécanismes qui favoriseront l’augmentation des financements au bénéfice de projets de plus en plus viables et capables d’influencer le développement économique du pays de manière durable.
La BRH est venue vers vous pour partager ces informations utiles. Elle est convaincue qu’elles seront utilisées à bon escient. C’est en posant ces jalons que nous réussirons à créer dans le département de la Grand’Anse, ce cercle vertueux qui devrait induire :
- l’amélioration de la production et des exportations de biens et de services, notamment les services touristiques ;
- des créations d’emplois soutenus et durables ;
- une augmentation de la productivité de la main-d’œuvre et du capital ;
- un élargissement de l’assiette fiscale ;
- une augmentation soutenue du PIB per capita ;
- un élargissement de la classe moyenne ;
- la projection d’une nouvelle image internationale du département et du pays aux yeux des investisseurs et consommateurs potentiels.
Je vous remercie de votre attention et encore une fois, bonne fête de la Saint-Louis.