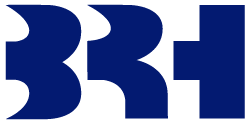Allocution de M. Ronald Gabriel, Membre du Conseil d’Administration de la BRH à l’occasion du forum “Mercredi de réflexions de la BID” au Centre de Convention de la BRH
Mesdames / Messieurs,
Mon propos consistera essentiellement à vous présenter le 3e numéro du Cahier de Recherche de la BRH qui propose au public des réflexions visant à alimenter la discussion sur les problématiques économiques au cœur des choix de politiques publiques. J’aimerais attirer votre attention sur le fait que les textes et les conclusions des investigations ne reflètent pas nécessairement le point de vue institutionnel de la BRH. Ils sont avant tout les résultats des travaux de nos économistes comme contribution aux débats académiques sur les questions de policy (politiques).
Chers amis,
Le dernier cahier de recherche de la Banque de la R épublique d’Haïti tourne autour de la problématique de l’Inflation. Il renvoie donc à la préoccupation fondamentale de toute Banque Centrale dont l’efficacité se mesure à l’aune de sa capacité à stabiliser le niveau général des prix. Cette perception, qui a pris un poids particulier depuis les déconvenues monétaires des années 80, a été quasiment portée au rang de règle dans la communauté des banquiers centraux qui ont suivi cette période. Le ciblage d’inflation dans la conduite de la politique monétaire et les riches débats que cette approche a suscités sont venus consigner ce fait dans le cercle des académiques comme dans celui des praticiens.
C’est donc avec une emphase particulière que les économistes de la BRH soumettent, à ces cercles que vous représentez, ce dernier cahier de recherche dont les travaux se proposent d’apporter un éclairage nouveau sur certains aspects majeurs de la problématique de l’inflation telle que vécue en Haïti durant les quarante dernières années. A ce titre, les réflexions qui traversent ces études constituent une halte de reconnaissance pour analyser (ces) (quatre) décennies de gestion liées à la stabilité des prix depuis la création de la banque centrale en 1979 et (de façon plus rapprochée) plus près de nous, une pause, pour évaluer le chemin parcouru depuis que l’introduction des Bons BRH en 1996 nous a fait faire un saut dans la modernité.
La nature des thèmes développés témoigne de la maturité des réflexions et le caractère utile des préoccupations soulevés. En effet, le choix des sujets traités n’a pas été guidé par le hasard. On y trouve associé une problématique majeure qui, loin de détrôner celle de la stabilité des prix, est venue renforcer son objet. Il s’agit de la croissance. On y trouve donc associé les préoccupations de croissance en tant qu’objectif économique ultime des politiques publiques de nature économique. Les effets et conséquences de la crise de 2008 sont là pour rappeler avec force que l’inflation non désirée est bordée de deux côtés sombres : l’hyper tension des sommets trop élevés et l’hypo tension des creux trop faibles. Les deux également dommageables pour la croissance.
C’est cette considération fondamentale qui motive ma proposition de faire tourner les réflexions, que suscitent les quatre études présentées dans ce dernier cahier de recherche, autour de l’une d’entre elles qui traite de La Nature de la Relation entre l’Inflation et la Croissance. Les trois autres sont tout aussi dignes d’intérêt, à la fois pour leur propre contenu que pour les implications qu’elles permettent de dégager, s’agissant de la problématique de la croissance. La BRH vient de publier d’ailleurs le premier volume de son « Agenda Monétaire pour la Croissance et L’emploi » que je vous invite aussi à lire avec attention.
Permettez-moi donc de citer, en les présentant, les quatre articles qui composent le cahier de recherche No 3:
Un modèle non linéaire du taux de change en Haïti
Cette étude propose une incursion dans la modélisation du taux de change sur la fréquence disponible la plus fine (avec l’approche qualifiée de discrétisation par les économètres et qui donne des résultats généralement assez robustes sur les relations comportementales entre les variables macroéconomiques). Elle couvre ainsi, sur une base journalière, la période inclusive du 3 octobre 2005 au 25 septembre 2009. Évidemment, de 2009 à date, diriez vous, il a pu se produire certaines mutations, notamment après le tremblement de terre de 2010 et l’afflux important des devises étrangères (près de 2 MG de dollars de RIN accumulées) portant certains économistes à évoquer même une situation de « dutch disease » donc, mutations susceptibles de nuancer un peu ou conforter les conclusions de l’investigation. Ce qui fait qu’une suite possible de ce working paper pourrait consister à investiguer la stabilité des résultats et des conclusions au cours de la période qui a suivi le choc de 2010. L’intérêt de l’étude réside dans l’utilisation d’une forme fonctionnelle non linéaire et de techniques d’estimation y relatives pour modéliser le taux de change à partir de sa mémoire chronologique.
A partir de tests probants de non linéarité dans la dynamique du taux de change journalier, l’étude propose un modèle à changement de régime porté par la fonction logistique d’un processus autorégressif. La superposition de la série calculée avec la série observée témoigne de la bonne performance des résultats confortés par des prévisions dynamiques plausibles.
Ces résultats ouvrent la voie vers la prévision et le ciblage du taux de change à travers l’utilisation d’une démarche non linéaire. Cependant, malgré la capacité prévisionnelle souvent limitée des modèles structurels, ces derniers ont la vertu de mettre l’accent sur les relations de causalité du taux de change avec des variables instrumentales qui permettent d’orienter les politiques publiques. La cohabitation des différents types de modèles demeure l’option la plus viable dans l’état actuel des outils d’aide à la décision.
Ratio de sacrifice : Une estimation pour l’économie Haïtienne à partir d’un VAR structurel.
Ce ratio établit fondamentalement le coût économique ultime associé à une baisse de l’inflation non désirée : à savoir la perte de croissance correspondante. Cette étude propose une évaluation de cette relation pour Haïti à travers la quantification des réponses dégagées de fonctions d’impulsions tirées d’un modèle de VAR structurel. Ces réponses ou innovations structurelles sont établies pour l’économie haïtienne sur la période 1986-2015 à partir d’une variante de la courbe Phillips qui permet d’isoler les effets spécifiques des chocs de demande.
L’écart par rapport au PIB potentiel (out gap) est la variable principale sur laquelle porte le choc de demande associé à une politique anti inflationniste ; le niveau des prix et le taux de change étant les deux autres variables qui complètent le modèle. Les résultats sur la période montrent un ratio de sacrifice de 0,97% , interprété comme étant la déviation du PIB réel en deçà de son niveau potentiel suite à une politique préposée à une diminution permanente de 1% de l’inflation non désirée.
Ce ratio de sacrifice est d’un niveau faible même s’il reste dans la lignée de pays comme le Brésil, la Bolivie et le Pérou et est en moyenne plus élevé que ceux enregistré pour la Jamaïque et Trinidad and Tobago. Cette faiblesse du ratio peut être expliquée notamment par le poids élevé des importations de biens de consommation finale dans l’économie et la prévalence concomitante des marges commerciales dans la VA globale (près 50% du secteur 3). La faiblesse du ratio montre aussi le degré important de contraction monétaire à consentir pour contenir les effets inflationnistes dans un environnement faiblement industrialisé et fortement empreinte d’un biais d’inflation.
Effet de seuil dans la relation entre l’inflation et la croissance économique en Haïti
Cette étude cherche à établir l’existence d’une relation non linéaire entre l’inflation et la croissance économique en Haïti dans la lignée des travaux qui soutiennent l’idée d’un seuil en dessous duquel l’inflation entretient la croissance et au dessus duquel elle s’y oppose. Cette investigation est de première importance dans la compréhension et la gestion des politiques macroéconomiques en ce sens que d’abord
- Elle apporte un certain éclairage sur une confusion apparente qui veut que la croissance des prix soit tantôt désirable et tantôt dommageable pour l’activité économique. L’établissement de ce seuil explique en quoi la relation entre inflation et croissance est sujette à un changement de régime qui la fait passer du positif au négatif.
- Ensuite, l’étude propose des balises aux praticiens économistes pour aider à un arbitrage plus rationnel entre inflation et croissance. Elle les force à penser davantage au degré plutôt qu’au sens de la relation en raison du fait empirique que le seuil détermine le caractère positif ou négatif de la relation.
Ce qui fait l’attraction de ce seuil en fait aussi une arme à double tranchant. On se souvient comment une mauvaise appréciation empirique du Max de la Courbe de Laffer aux USA a conduit, dans les années 80, à une application dommageable de la politique de l’offre dans ce pays. C’est pour cela que les travaux approfondis sur le seuil de la relation entre inflation et croissance, bien au delà des efforts de modélisation et des techniques d’estimations, doivent être soumis à des considérations structurelles, sectorielles et multidisciplinaires.
En attendant, l’étude que présente ce cahier de recherche est suffisamment bien étoffée pour retenir l’attention sur les résultats empiriques qu’elle délivre. Le seuil trouvé à la suite d’un processus itératif de régressions séquentielles est de 18%. Elle conclut à l’existence d’une relation dynamique non linéaire entre inflation et croissance économique et à des marges de politiques expansionnistes qualitativement éprouvées jusqu’à concurrence de 18% d’inflation. Enfin… la qualification même de la politique expansionniste est en soi une problématique à investiguer dans le contexte haïtien ou ailleurs.
Estimation de l’impact du financement du déficit budgétaire sur l’inflation en Haïti
Cette étude utilise un modèle VAR pour analyser les créneaux par lesquels le financement du déficit budgétaire agit sur l’inflation. Les résultats des estimations concluent à une relation généralement bien établie entre le financement monétaire du déficit budgétaire à travers le crédit à l’Etat, la masse monétaire M2 et l’inflation.
Des tests de causalité de Granger effectués sur une fréquence mensuelle et couvrant la période de 1982 à 2015 concluent à la séquence suivante : les valeurs retardées du crédit à l’Etat influencent les valeurs présentes et futures de la masse monétaire au sens large qui, à leur tour, agissent sur l’inflation sur une base contemporaine et future. L’étude des fonctions de réponse du modèle confirme cette séquence tout en dégageant la propagation des effets de causalité.
Un autre aspect de premier intérêt de cette étude est une analyse succincte mais suffisamment instructive de l’environnement macroéconomique de la longue période 1980 – 2015 décomposée en cinq sous périodes bien caractérisées.
Je ne vais pas m’attarder davantage sur cet article étant donné qu’il va faire l’objet de la principale présentation du jour après une mise en contexte par Kesner Pharel.
Je vous remercie de votre attention
Messieurs les membres du Conseil d’Administration,
Mesdames et Messieurs,
Ma présence ici aujourd’hui témoigne de la volonté de la BRH de jouer pleinement son rôle de régulateur non seulement du système bancaire, mais du système financier tout entier. Le Conseil d’Administration mise beaucoup sur le secteur coopératif pour confirmer les opportunités à saisir dans une perspective d’inclusion.
La création de la fédération a également permis à la BRH de renforcer les liens avec le secteur coopératif à travers certains projets qui visent à assurer la viabilité des coopératives d’épargne et de crédit.
Mesdames, Messieurs,
La modernisation et la stabilité du secteur demeurent l’objectif principal de la BRH. Le fil conducteur de l’action de la BRH prend essence dans la primauté de l’intérêt collectif et dans le développement économique et social de ceux qui n’ont pas accès au système bancaire traditionnel. Pour cela, le succès du secteur requiert que la fédération soit viable, solide et se conforme aux lois et règlements tout en motivant ses caisses membres au niveau de la formation et en les accompagnant en vue d’une croissance soutenue.
Chers dirigeants de la Fédération et des Coopératives d’Epargne et de Crédit,
Dans un souci d’harmonisation des pratiques et de communication plus efficace et plus efficiente, la BRH souhaite raffermir les liens existants entre les deux institutions.
La BRH souhaite que le modèle des fédérations de coopératives soit plus qu’un regroupement de caisses populaires, mais soit également un canal œuvrant à la promotion de l’inclusion financière pour le bénéfice de tous et particulièrement des plus modestes. La logique des coopératives s’inscrit non seulement dans l’enclenchement des activités pérennes, mais encore dans la conduite et l’organisation du secteur.
Nous voulons voir des caisses mieux gérées et plus prospères, nous voulons voir des caisses réaliser des retours sur investissement dans le même ordre de grandeur leurs pairs du système bancaire…
Au nombre des actions menées par la BRH en vue de favoriser la croissance économique interne, l’inclusion financière occupe une place importante.
Un grand nombre de personnes en Haiti fonctionnent en dehors du système financier et sont par conséquent privés de service financier. Ce qui conduit sur le plan économique à une grande inégalité bien que nous soyons tous égaux devant la loi.
En tant que régulateur du système financier, la BRH tient à faciliter l’adéquation entre l’offre et la demande pour assurer l’accès aux services et produits financiers à la population et ainsi lui faire bénéficier de services et de produits adaptés.
Pour y parvenir, le rôle des coopératives et en particulier de la fédération, se révèle prépondérant.
En offrant ses services aux particuliers et aux PMEs, le secteur des coopératives joue un rôle important en permettant d’avoir des répercussions positives sur la finance accessible à tous et en servant d’outil stratégique majeur pour les décideurs.
C’est ainsi que la BRH a conjugué ses efforts pour mettre à la disposition de la fédération quelques instruments financiers devant permettre de paver la voie au changement et à la modernisation des CEC.
Le SPIH, la Chambre de compensation, le projet de modernisation des CEC et le Bureau de l’Information sur le Crédit (BIC) sont autant d’outils qui dynamisent le secteur et qui le hissent à un niveau enviable. La fédération doit se doter de moyens adéquats et d’infrastructure nécessaire pour mieux étendre ses opérations et satisfaire ses membres dans un environnement dynamique, concurrentiel et exigeant. La BRH vous exhorte à vous armer de rudiments pour rendre les institutions que vous coiffez de plus en plus aguerries.
La BRH, consciente des enjeux et des défis qui guettent le paysage financier et économique, encourage la philosophie de fédération à la faveur d’une efficacité accrue dans la conduite de la gouvernance des coopératives. D’ailleurs, les instruments financiers favorisés par la BRH envoient un message percutant dans le repositionnement et l’avenir des coopératives. La détermination qui m’a animé à l’endroit du secteur, en tant que Gouverneur, est restée intacte.
Donc, inutile de vous dire que Le Levier est appelé à jouer un rôle crucial au regard de la stratégie nationale d’inclusion financière.
A ce moment charnière de notre vie de peuple où la carte économique et financière du globe a été redéfinie ; où les difficultés de notre pays nous interpellent ; où les fondements mêmes de notre pacte social sont vacillés, plus que jamais la fédération doit mobiliser l’ensemble de ses membres au partage, à travailler dans le souci de rendre le secteur plus dynamique et plus soucieux du développement économique des sociétaires.
En terminant, je souhaite que plusieurs autres décennies succèdent à cette première que nous célébrons aujourd’hui.
Joyeux anniversaire.
Madame le ministre des Haitiens vivant à l’étranger, Stephanie Auguste,
Madame le ministre du Tourisme Gessy Menos,
Miami-Dade Commissioner Monestime,
Madame le Directeur Général du CFI,
Madame, Messieurs les membres du Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haïti,
Mesdames, Messieurs les Élus de la Diaspora,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce Haïtiano-Américaine de Floride (HACCOF),
Distingués Invités,
Chers Collègues,
Je salue aussi le support des présidents des deux chambres du Parlement haïtien, lequel participe du désir d’aider au déclenchement, entre les secteurs d’affaires d’Haïti et ceux de la Diaspora et de l’Amérique, de synergies aptes à faciliter la valorisation des nombreux potentiels que recèle l’économie haïtienne. Dans ce sens, il convient aussi de signaler la présence à ce Sommet de personnalités fonctionnant dans les milieux financiers et d’investissement d’Haïti et de la Diaspora.
Je remercie le président de la Chambre de Commerce Haïtiano-Américaine de Floride d’avoir invité la BRH à intervenir aux assises qui nous rassemblent aujourd’hui. Notre acceptation de cette invitation se place dans le contexte global des efforts que, depuis quelques temps, la BRH s’active à mener en vue d’intensifier son utilisation des moyens dont elle dispose en tant qu’institution de l’État haïtien chargée par sa loi organique de conduire la politique monétaire d’Haïti et de veiller à la stabilité du système financier national. Cette mission, dont on ne saurait trop souligner l’importance, exige de la BRH qu’elle reste sans cesse mobilisée afin de jouer, de manière opportune et appropriée, son rôle dans la mise en place et le maintien des conditions nécessaires à la bonne marche de l’économie nationale. En exécutant ce mandat, la BRH fait de son mieux pour apporter une collaboration franche et efficace aux autres organes de l’État impliqués, dont certains en première ligne, dans l’œuvre essentielle de concevoir les actions et politiques susceptibles d’aider à la réalisation de la même mission fondamentale.
En plus des partenaires du secteur public, la BRH demeure aussi constamment attentive aux opportunités de collaboration fructueuse pouvant lui venir des partenaires du secteur privé, tant de l’intérieur du pays que de notre vitale Diaspora.
Oui, je dis bien, notre vitale Diaspora. Les statistiques montrent qu’en l’année 2000, Haïti figurait déjà parmi les pays de la région envoyant le nombre le plus élevé de travailleurs hautement qualifiés. Pour citer Ponce, dans son aperçu sur les migrations sud-sud et le développement d’Haïti, « Pour l’année 2004, 35% des médecins haïtiens ont laissé Haïti pour les Etats-Unis, le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni. En somme, il est estimé que 80% des Haïtiens ayant un diplôme universitaire (licence, maitrise ou doctorat) ne vit pas en Haiti. Donc 80% de l’intelligentsia haïtienne se trouve dans la diaspora… De grâce, mes chers amis et compatriotes, ne laissez pas à seulement 20% de l’intelligentsia haïtienne le soin de développer et de sauver notre chère Haïti que nous disons être notre Patrie. Nous avons certes besoin du capital financier que constitue la diaspora, mais nous avons encore plus besoin de votre capital humain bien formé et expérimenté.
Notre acceptation de l’invitation de la HACCOF se place donc dans ce contexte général. Nous voyons notre participation à ce Sommet d’Affaires comme renfermant un triple potentiel, comme porteuse d’une opportunité à la fois d’information, de collaboration et de promotion.
En premier lieu, la présence de la BRH à des sessions de travail tenues par des compatriotes de la Diaspora en dehors d’Haïti est suffisamment exceptionnelle pour que j’en profite pour partager avec les participants d’utiles informations, lesquelles pourront aider à nous mettre au même diapason en ce qui concerne l’évolution générale de la réalité économique haïtienne. De telles informations contribueront à jeter la lumière sur le cadre macroéconomique d’Haïti afin de mettre en évidence les conditions favorisant la maximisation des opportunités d’affaires viables existant dans des secteurs économiques porteurs.
D’un autre côté, j’anticipe que ce Sommet d’Affaires favorisera la découverte, à divers niveaux, d’affinités multiples et de modalités de collaboration. Sur la base des informations fournies et des expériences déjà acquises sur le terrain en Haïti, ces affinités et modalités devront permettre à nos sœurs et frères de la Diaspora, et aussi à des investisseurs étrangers, de s’intéresser beaucoup plus aux capacités latentes d’Haïti, lesquelles ne demandent qu’à être fructifiées. Il s’agit donc d’œuvrer au déploiement des potentiels du capacity building. De ce point de vue, il faut souhaiter que les jalons posés au cours de ce Sommet soient autant de graines qui, semées à bon escient, génèreront les projets qui maximiseront les aubaines d’investissements dont regorge notre pays.
D’où l’occasion de promotion contenue dans ce Sommet. Pour peu que les bons efforts soient consentis afin d’en assurer le suivi, cette rencontre devrait aider à projeter une image plus cohérente de notre pays à des investisseurs étrangers, américains particulièrement, qui en viendraient à apprécier les opportunités d’affaires viables qu’offrent, chez nous, des secteurs économiques porteurs.
Distingués Invités,
Chers Collègues,
-
Mon intervention s’articulera autour des quatre (4) axes suivants :
- D’abord, je présenterai un survol du cadre macroéconomique de notre pays sur les derniers trente-cinq (35) ans. Il s’agira de jeter une lumière constructive sur les défis qui se dressent face à nous tous, question d’être bien imbus des efforts qui nous attendent.
- Ensuite, je rappellerai le potentiel d’investissements existant au sein de l’économie haïtienne, un potentiel qui se veut autant d’opportunités d’affaires pour la Diaspora. C’est d’autant plus le cas qu’un niveau sans pareil de transferts privés, et aussi d’autres contributions, fait déjà de la Diaspora le pilier de l’économie haïtienne, un réservoir inestimable d’investissements aptes à stimuler le renforcement des capacités.
- En troisième lieu, j’analyserai quelques exemples de projets d’investissement qui ont réussi en Haïti. Cela montrera que, dans notre pays, ce ne sont pas les opportunités d’affaires qui manquent aux investisseurs de la Diaspora, ni d’ailleurs aux investisseurs étrangers.
- Enfin, je terminerai avec la présentation des mécanismes d’incitation mis en place par la banque centrale en support à des secteurs productifs à fort potentiel.
Abordons donc le premier axe, qui concerne un survol rapide du cadre macroéconomique d’Haïti, vu à travers les (3) éléments d’observation suivants :
- De 1981 à 2016, l’économie du pays a connu une croissance moyenne d’environ 0,5% par an, et des épisodes d’inflation plus ou moins forte, surtout pendant les périodes 1992-1994 et 2003-2004.
- Les efforts consentis au cours des dernières années ont permis une amélioration de la performance économique. De tels efforts doivent être renforcés afin de contrecarrer les effets tenaces de certains déséquilibres, dont celui du compte extérieur, entretenu par les carences des exportations par rapport aux importations ; et aussi le déséquilibre des finances publiques, alimenté par l’insuffisance des rentrées fiscales. Il s’agit, pour notre pays, d’une urgence de progrès qui se justifie aussi par la nécessité de parer à des aléas tels que les évolutions de la conjoncture sociopolitique, les dégâts causés par des catastrophes naturelles et l’impact négatif de chocs externes comme les fortes hausses du prix du pétrole survenant pendant des années, et jusque vers le début de l’actuelle décennie. Soulignons que ces hausses ont, pour beaucoup, été absorbées par le Trésor public, dont les ressources ne disposaient pas de la profondeur nécessaire pour assumer durablement une telle charge.
- Les programmes de stabilisation mis en place de façon périodique par les autorités haïtiennes ont permis de limiter l’impact délétère de ces déséquilibres et aléas. Toutefois, le grand défi, pour nous tous, demeure de tout mettre en œuvre, et sur tous les fronts, afin d’accélérer le rythme de la croissance de façon à réaliser une amélioration importante du pouvoir d’achat et des conditions de vie de la population sur le long terme.
Chers compatriotes de la Diaspora,
Le pari économique haïtien est de taille, mais les problèmes ne sont pas insurmontables. Il ne faut surtout pas baisser les bras. De son côté, si la BRH se donne une claire conscience des défis qui se posent à notre pays, c’est pour signaler l’urgence de se mettre au travail sans tarder et de redoubler d’efforts afin de relever ces défis, une fois pour toutes. Dans cette perspective, la banque centrale d’Haïti se veut simplement une institution au service du progrès de notre pays, dans l’optique d’une Haïti inclusive. Elle se voit comme un maillon au sein d’une grande chaîne nationale, un partenaire parmi tant d’autres, prêt à apporter une franche collaboration à tout effort de développement conforme à ses attributions statutaires.
Et cette idée me fournit l’occasion de passer au deuxième axe de cette présentation, pour rappeler et les bonnes perspectives de l’économie haïtienne, et la place que doit y jouer ce partenaire indispensable qu’est la Diaspora.
Comme je le disais tantôt, et il est bon d’y insister, notre économie regorge d’opportunités d’investissements. D’ailleurs, sa performance s’est améliorée récemment, comme le signale les indicateurs suivants :
- Le taux de croissance annuel moyen de l’économie s’est fixé autour de 2% au cours des 5 dernières années, et il est anticipé un résultat plus robuste pour l’exercice fiscal 2017-2018.
- Durant l’exercice fiscal en cours (2016-2017), les réserves de change nettes ont augmenté de 94 millions de dollars É.U. environ, pour atteindre 1,022 milliard de dollars au 24 mai 2017.
- En comparaison à septembre 2016, la gourde s’est appréciée de 4,1% en mai 2017 par rapport au dollar américain.
- Le financement monétaire du déficit budgétaire a été réduit de plus de moitié au cours de la période allant de la fin de l’exercice 2015 à la fin de l’exercice 2016. Il est ainsi passé de 9,9 milliards de gourdes au 30 septembre 2015, à 4,5 milliards de gourdes au 30 septembre 2016. L’amélioration de la situation des finances publiques devrait se poursuivre, d’une part, avec le maintien de l’accord de cash management établi entre le Ministère de l’Économie et des Finances et la BRH et, d’autre part, avec la baisse progressive des subventions importantes accordées par l’État haïtien sur les achats de produits pétroliers. Soulignons que la stratégie du cash management consiste à poursuivre une gestion efficace, c’est-à-dire sans gaspillage ni excès, des flux de trésorerie et des soldes de trésorerie à court terme du gouvernement. Une telle posture de gestion financière s’applique en général tant au sein du gouvernement lui-même, qu’entre le gouvernement et des entités avec lesquelles il est en rapport.
Il est bon de noter que cette évolution favorable de la situation macroéconomique récente dont nous venons de faire état, n’est pas sans lien avec la réalisation des élections présidentielles et législatives, et la mise en place dans un délai relativement court d’un nouveau gouvernement. Cependant, les effets multiples de l’ouragan Matthew ne se sont pas encore dissipés, surtout en termes de compression de l’offre alimentaire locale et de flambée des prix des produits ainsi raréfiés par cette nouvelle catastrophe naturelle.
Néanmoins, les interventions programmées par la banque centrale sur le marché des changes devraient, en conjonction avec d’autres mesures tant de la BRH que des autorités de l’État, contribuer à contenir les pressions inflationnistes. Précisons que ces interventions prévoient des ventes de devises à hauteur de 120 millions de dollars sur la moitié restante de l’exercice 2016-2017. De manière plus générale, les mesures en cours ont plus de chance de réussite sur le long terme avec la mise en place d’une stratégie de relance économique tablant sur l’orientation progressive desdites mesures vers la consommation de biens et de services produits localement, plutôt que la consommation de produits importés. Une telle stratégie devrait se baser sur le renforcement de nos institutions, la réduction des imperfections du marché et la minimisation des contraintes structurelles majeures auxquelles est soumise notre économie.
Ceci dit, quelles sont les perspectives offertes aujourd’hui par l’économie haïtienne ?
Quel rôle nos compatriotes vivant à l’étranger peuvent-ils jouer dans la mise en œuvre de telles perspectives, surtout au vu de leur engagement avéré en support à la terre natale ?
Considérons d’abord la question du rôle de la Diaspora, à la fois historique et à venir.
De nombreuses études empiriques ont démontré les effets positifs directs et indirects des transferts privés sur la balance des paiements et sur la croissance. Les effets des transferts sont observables sur l’épargne et l’investissement, mais aussi dans la formation du capital physique et humain, et encore à travers la hausse de la consommation et la réduction de la volatilité de la croissance. Une étude publiée sous les auspices de la Banque Mondiale en 2003 considère que le niveau de la consommation dans les zones rurales peut avoir un effet multiplicateur au sein de l’économie, dans la mesure où les bénéficiaires des transferts orientent leurs dépenses vers les produits locaux, au lieu des produits importés.
La contribution financière de la Diaspora figure parmi les flux de capitaux les plus importants dirigés vers Haïti, avec une tendance à la hausse depuis le milieu des années 1990 et une nette accélération à partir de 2010. Il est à noter que les transferts de la Diaspora ont un poids relatif plus constant que l’agriculture dans le produit intérieur brut, ou PIB, et un poids plus élevé que celui de l’aide au développement. Haïti est le troisième plus grand bénéficiaire de transferts dans la Caraïbe. Les transferts de notre Diaspora sont passés en moyenne de 5% du PIB durant la période 1992-1996, à plus de 23% du PIB sur la période 2011-2016. Dans le même intervalle, l’apport des transferts au financement du déficit commercial d’Haïti est passé en moyenne de 27% à 70%. En 2015, ces transferts dépassaient le flux d’investissements directs étrangers par un multiple de 20, et se situaient à un niveau proche de celui des transferts de la Diaspora de la République Dominicaine. Depuis le début des années 2000, les transferts des Haïtiens vivant à l’étranger sont devenus la principale composante de l’offre de devises en Haïti.
Au-delà de cette contribution financière très importante, la Diaspora fournit à Haïti un potentiel considérable sur le triple plan de la hausse de la productivité, de la formation du capital humain et de l’essor du secteur du logement. En effet, selon une étude publiée par la Banque Interaméricaine de Développement (BID), l’éducation représente, après l’alimentation, le deuxième poste le plus important dans les dépenses des bénéficiaires de transferts. L’enquête souligne que la contribution de la Diaspora est tout aussi significative dans le secteur du logement. Par exemple, le secteur informel consacre une part importante des montants de transfert reçus de l’étranger, aux constructions résidentielles.
Distingués Invités,
Chers Collègues,
Le caractère unique du poids que la Diaspora en est arrivée à se donner dans la réalité économique de notre pays, est incontestable. Puisque le thème de l’investissement est au cœur de ce sommet, il nous paraît convenable de soulever l’interrogation suivante. Si le plus clair des transferts de la Diaspora n’étaient plus voués à la consommation, comme c’est le cas présentement ; si la Diaspora en venait à accepter l’idée, somme toute raisonnable, que les bonnes occasions d’affaires et d’investissements ne manquent pas dans notre pays ; si, par conséquent, un nombre grandissant d’Haïtiens vivant à l’étranger décidaient d’investir en Haïti des fonds qu’ils comptaient placer sous d’autres cieux, alors, peut-on se demander, qu’adviendrait-il de l’apport de la Diaspora à l’essor durable de l’économie haïtienne ?
Bien entendu, et dans l’hypothèse de la validation des trois prémisses que je viens d’évoquer, il est difficile d’évaluer maintenant l’ampleur de la hausse qui surviendrait, à l’avenir, dans le niveau global des investissements de la Diaspora en Haïti. Toutefois, en l’absence d’une évaluation crédible, on peut raisonnablement supposer un accroissement soutenu, au fil du temps, des initiatives d’affaires des Haïtiens vivant à l’étranger.
Et c’est précisément ce processus d’accroissement soutenu de ses investissements en Haïti, que la BRH souhaite, aujourd’hui, exhorter la Diaspora à déclencher.
D’où les deux derniers axes de mon intervention. D’abord, pour bien convaincre les détenteurs de capitaux de la Diaspora que l’idée d’investir en Haïti n’est pas utopique, je souhaite soumettre à votre esprit d’examen quelques exemples de réussite en matière d’investissements dans le pays. Ensuite, je décrirai des mesures élaborées par la BRH comme incitations au secteur productif et aux exportations.
Dans le cas des investissements locaux, des montages financiers de qualité ont permis d’intégrer l’apport de partenaires de la Diaspora haïtienne dans le capital d’entreprises locales. Ces montages ont été réalisés dans trois secteurs clés de l’économie : l’industrie alimentaire, l’hôtellerie et la production d’énergie. S’agissant des investissements directs étrangers, ou IDE, deux aspects doivent être considérés : les montages financiers et l’intégration de la production locale dans des chaînes de valeur, comme dans le cas de la Brasserie Nationale, ou Brana, et celui du petit mil. Nous parlons ici de success stories qui ont été réalisées dans l’industrie alimentaire et avec des entreprises fonctionnant dans le secteur de la téléphonie mobile et des établissements hôteliers opérant dans le cadre d’une franchise internationale.
Il convient de souligner que les investissements directs étrangers traduisent un intérêt durable envers le pays de destination, et ils présentent l’avantage d’être peu volatiles, contrairement aux investissements de portefeuille. Leur impact sur l’emploi, sur l’assiette fiscale et sur la croissance économique est plus stable. De plus, les IDE sont souvent assortis d’apports en nouveaux savoir-faire, en nouvelles technologies, et en nouvelles techniques de production et de gestion. Ils contribuent donc à enrichir leurs secteurs d’activité en les rendant plus productifs et plus compétitifs, et en leur facilitant l’accès aux marchés internationaux, souvent, à travers les réseaux d’entreprises dont font partie les IDE. À titre d’illustration, prenons, le business hôtelier qui, de nos jours, fait partie de réseaux constitués d’agences de voyages (réelles ou virtuelles), d’agences de croisière, de lignes aériennes, de services d’assurance, etc.
Il est donc impératif de travailler à la mise sur pied du cercle vertueux qui induira l’émergence d’autres success stories à travers l’élaboration d’un cadre où l’investissement public jouera pleinement son rôle de catalyseur de l’investissement privé, notamment celui de la Diaspora. Ceci est d’autant plus urgent que le pays fait face désormais à une double réalité. D’un côté, l’épargne intérieure privée en Haïti est très faible par rapport aux besoins énormes de financement qu’impliquent le développement durable et la réduction significative de la pauvreté. Le système financier haïtien ne dispose que d’environ 1,4 milliard de dollars de ressources qui pourraient, lorsque les circonstances le permettront, être orientées vers des projets porteurs viables, présentant un niveau de risque raisonnable. D’un autre côté, le financement des investissements à partir des fonds de PetroCaribe a été réduit à presqu’au cinquième de ce qu’il était il y a trois ans environ. En effet, les fonds PetroCaribe disponibles sont passés de près de 15 milliards de gourdes en 2013, soit près de 4% du PIB, à 3 milliards de gourdes en 2016, soit 0,65% du PIB.
Quant à l’appel à l’épargne extérieure, laquelle combine les dons officiels, les prêts publics et les prêts privés, il reste conditionné aux exigences des organismes multilatéraux de financement et aux disponibilités que permet la performance économique des bailleurs de fonds bilatéraux. Il y a donc lieu de minimiser certaines contraintes structurelles et institutionnelles afin d’aménager un accès direct à l’épargne privée et, de là, œuvrer à l’approfondissement du marché financier. Par exemple, l’accès aux capitaux internationaux pourrait être favorisé, d’une part, par la mise en commun des ressources locales et de celles de la Diaspora et, d’autre part, par l’élaboration d’instruments de garantie internationale et d’autres mécanismes de mitigation des risques.
Il est donc souhaitable de rechercher non seulement une complémentarité entre l’épargne disponible et les transferts privés sans contrepartie, mais aussi d’envisager de nouvelles pistes de solution pour stimuler l’investissement en Haïti. Point n’est besoin de souligner, encore une fois, que dans la poursuite d’un tel objectif, la quête de l’engagement le plus entier de la Diaspora doit rester une finalité majeure.
C’est donc dans cette perspective que la BRH a mis en œuvre des programmes spécifiques en vue de promouvoir certains secteurs productifs clés à forte valeur ajoutée, susceptibles d’avoir des retombées directes sur l’emploi et la croissance économique. Ces programmes d’incitation au secteur productif, qui visent à faciliter le crédit au secteur privé, sont les suivants :
- Le programme KAY PAM, mis en place après le séisme du 12 janvier 2010 de manière à stimuler le crédit au logement en faveur de la classe moyenne. Il comporte les caractéristiques suivantes : le taux d’intérêt est compris entre 8% et 10%, et il est fixe sur 10 ans ; le financement est libellé en gourdes, et il porte sur la construction, la rénovation et l’acquisition de maisons.
- Le programme de développement des zones franches, mis en place en décembre 2015, et qui vise essentiellement à augmenter la capacité du pays à bénéficier des lois HOPE II* et HELP** , lesquelles ont été renouvelées par le Sénat américain en août 2015 pour 10 ans. Créé en partenariat avec les banques commerciales, ce programme permet non seulement d’accroître les exportations et le nombre d’emplois dans le secteur textile, mais aussi aux promoteurs de zones franches de se financer auprès des banques à des conditions favorables incluant un taux d’intérêt maximum de 7%.
- Le programme de financement des exportations établi suite à des protocoles d’accord signés en octobre 2016 par la BRH avec deux sociétés financières de développement, le Fonds de Développement Industriel (FDI) et la Société Financière Haïtienne Industrielle de Développement Économique et Social (SOFHIDES). Ce programme favorise l’accès au crédit pour les entreprises de production de biens et services destinés à l’exportation. Il comprend une fenêtre de refinancement des comptes à recevoir des exportateurs, et une facilité de crédit visant le renforcement des capacités de production des entreprises ciblées. Cela devrait mener à moyen et long termes à la réduction du déficit de la balance des paiements.
- Le programme d’incitation aux secteurs touristique et hôtelier, par lequel les banques sont exonérées de l’obligation de constituer des réserves obligatoires sur les ressources qu’elles utilisent pour financer des projets réalisés dans les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie.
Les dits secteurs peuvent ainsi obtenir du crédit à des taux d’intérêt plus favorables.
D’autres projets sont à l’étude dans le cadre des mesures d’incitation aux secteurs productifs. Il s’agit, notamment, de la promotion de projets de développement immobilier ; de la promotion de la copropriété et de zones franches agricoles ; et de la mise en place, au bénéfice du secteur agricole, de garanties partielles de crédit et de programmes d’assurance. Enfin, la BRH s’est récemment engagée dans une série d’activités de facilitation de dialogue et de réflexion entre les acteurs clés de différentes filières d’activité à forte valeur ajoutée. Cet exercice vise le renforcement des politiques et des mécanismes de financement capables d’influencer le développement économique du pays de manière durable.
Chers amis,
L’efficacité de toutes les mesures que je viens de résumer va de pair avec l’accompagnement de l’État à travers des réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires en Haïti. Cependant, il est indéniable que les opportunités d’affaires existent déjà dans le pays. L’exemple du succès des entreprises locales et multinationales que, sans les citer nommément, je viens d’évoquer en fournit l’évidence. Ayant choisi d’investir en Haïti, elles ont pour la plupart déjà pris place parmi les plus grands contribuables du pays.
J’invite donc les compatriotes vivant à l’étranger à suivre les exemples de ces devanciers en utilisant les formules qui ont donné la preuve de leur efficacité. La Diaspora a tout intérêt à en tirer avantage. Sa contribution au développement de la terre natale passerait à un niveau autrement important si elle complétait ses transferts traditionnels avec des initiatives orientées vers l’investissement en Haïti.
Les associations régionales et locales de la Diaspora pourraient s’associer aux autorités haïtiennes, notamment les municipalités, dans une logique de partenariat public/privé destiné à financer les projets de développement régional. Les besoins d’investissement ainsi que les opportunités qui en découlent sont immenses dans les infrastructures socio-économiques de base comme l’éducation, la santé, la distribution de l’eau potable et les énergies renouvelables. La Diaspora pourrait aussi investir directement dans les entreprises qui acceptent d’ouvrir leur capital. Il s’agirait de promouvoir l’expansion ou la création d’entreprises d’économie mixte dans le cadre d’opérations conjointes avec des institutions déjà impliquées dans ce type d’activité comme le Fonds de Développement Industriel (FDI) et la Société Financière Internationale (SFI). Enfin, outre la création de chambres de commerce régionales et la mise en place de réseaux d’affaires, la contribution de la Diaspora peut aussi s’étendre aux échanges commerciaux et aux transferts de compétences et de technologies.
Voilà, Mesdames, Messieurs, quelques initiatives qui pourraient réduire progressivement les obstacles à l’investissement en Haïti, et transformer le cercle vicieux dans lequel nous sommes, en un cycle vertueux de croissance forte et soutenue, et d’amélioration substantielle continue du niveau de vie de la population.
La Banque de la République d’Haïti joue sa partition à travers des mesures pro-croissance destinées à promouvoir le secteur productif et d’exportation. Elle continuera d’encadrer le système financier à travers une réglementation et une supervision adaptées.
Je suis certain que les débats qui vont suivre seront de qualité, et je formule le vœu que les travaux de ce Sommet soient couronnés de succès.
Jean Baden Dubois
Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti
Madame Daniella Jacques, Presidente de la Chambre de Commerce des Femmes entrepreneures d’Haiti.
Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualites..
S’il est une évidence qui fait l’objet du consensus le plus large et en Haïti, et dans les sphères globales liées au développement économique, c’est bien celui du rôle capital que joue la femme entrepreneure dans la structure et le fonctionnement réussi des divers processus économiques et sociaux à travers le monde. Malgré la domination encore forte de l’héritage patriarcal, les contributions productives et génératrices de revenus des femmes demeurent très visibles et, à n’en pas douter, vitales à plus d’un titre. Désormais, la prospérité durable des nations paraît pratiquement impossible si la femme est exclue des mécanismes du marché et de production, ou encore si des restrictions sont imposées à son accès aux ressources disponibles.
C’est pourquoi, depuis la fin du 20e siècle, l’approche Genre et Développement met l’accent sur les relations entre hommes et femmes pour, à la fois, promouvoir le développement économique et social, et poursuivre une réduction soutenue de la pauvreté. De nos jours, le concept de développement durable ne peut se concevoir que dans une perspective de genre, laquelle exige non seulement une vision d’intégration des droits fondamentaux de toutes et de tous, mais encore la poursuite systématique de politiques équitables et non-discriminatoires, particulièrement en ce qui concerne le genre. Cette perspective de genre s’épanouit désormais à travers une notion que la langue anglaise définit comme gender mainstreaming, c’est-à-dire la recherche de l’égalité des sexes. Une telle notion préconise que l’effort de mise en œuvre de tout programme de développement soit fondé sur l’essor des questions de genre, au même titre que sur la promotion des droits de l’homme.
Il faut s’entendre sur un point essentiel. Le fait d’œuvrer à assurer à la femme une place de première ligne dans le projet de développement économique ne répond pas seulement à un élan humanitaire, ni à un simple souci de réparation d’une injustice historique universelle. Les sociétés contemporaines n’ont d’autre alternative que de donner une place de choix à la femme au sein de l’agenda économique parce que la femme est indispensable pour un tel agenda. Les recherches empiriques ne se comptent plus, qui font la preuve du succès économique nettement plus grand des sociétés qui traitent l’homme et la femme de manière plus équitable. Les nations qui ont fait le choix opposé ont enregistré une croissance économique moindre, ainsi qu’une capacité restreinte à réduire la pauvreté.
De même, les disparités sociales basées sur le genre ont, à travers l’histoire, produit des résultats économiques inefficaces. Par exemple, une analyse publiée en 2003 par un groupe d’étude de la Banque Mondiale a estimé que si, entre 1960 et 1992, les pays d’Afrique avaient réduit l’écart hommes-femmes en matière de scolarisation au même rythme que les pays de l’Asie de l’Est, il en aurait résulté, sur la trentaine d’années, un doublement du revenu par habitant de la région africaine.
D’ailleurs, la réputation de fiabilité et de crédibilité que se sont donné les femmes en ont fait la main-d’œuvre de prédilection dans les industries transnationales du textile et de l’électronique. Déjà les programmes de microfinance un peu partout dans le monde, et certainement chez nous en Haïti, ont manifesté une option préférentielle pour les femmes parce que celles-ci se sont révélées de bonnes gestionnaires financières qui n’ont pas leur pareil pour rembourser les prêts avec discipline, selon le calendrier convenu. L’argument selon lequel la femme doit être placée au cœur du développement économique se justifie aussi par la capacité avérée de la femme à être une distributrice plus judicieuse de biens et de services au sein du foyer.
S’agissant de notre pays, spécifiquement, la réputation d’agent économique d’avant-garde des femmes n’est plus à faire. L’image de la marchande portant son panier de provisions sur la tête, ou encore tenant des étalages de produits alimentaires dans des marchés publics, est devenue symbolique, très caractéristique de l’activité économique informelle, majoritaire en Haïti. La commercialisation d’une grande partie de la production rurale passe par les « Madan Sara », cette entrepreneure emblématique dont les succès d’affaires tiennent des fois du miracle. Ce n’est pas sans raison qu’on fait souvent référence à elle pour caractériser l’économie haïtienne. Nombreuses sont ces femmes qui, souvent partie d’un commerce très minime, arrive à subvenir aux besoins de leurs enfants et à en faire des professionnels de premier ordre.
N’hésitons pas à le dire : fanm ze zo rèl do ekonomi ak sosyete peyi d’Ayiti.
Dès lors, il convient d’offrir à nos femmes, dont beaucoup sont des fanm vanyan, un cadre de fonctionnement meilleur que celui qui existe actuellement, et qui se caractérise par des limites telles que
- l’insécurité,
- une rentabilité faible,
- la marginalisation comme secteur informel pas toujours bien vu,
- et j’en passe.
Il convient d’œuvrer a? une meilleure valorisation et une plus grande organisation des activités des femmes, surtout dans le monde agricole où leur dynamisme les fait jouer un rôle de levier.
Une telle démarche ne peut pas faire l’économie de l’approche entrepreneuriale. L’entrepreneuriat féminin est une des meilleures stratégies susceptibles de valoriser le statut socioéconomique des femmes, de les faire cesser d’être des agents économiques de seconde zone cantonnés dans des activités économiques informelles.
Dans une perspective de décentralisation économique et de création de la richesse dans un contexte de développement durable et de réduction de la pauvreté, l’utilisation de la technologie parait une solution de premier choix. Il s’agit, dans le cas spécifique des femmes entrepreneures, de mettre à contribution les nombreuses opportunités qu’offrent les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) en termes d’amélioration de la performance des entreprises en général. Il faut envisager comment utiliser des outils comme les smartphones, les tablettes, etc., et aussi des logiciels comme les applications de marché ou les applications sur le Cloud, pour tirer parti des opportunités d’efficacité qu’offrent les technologies en question.
Les NTIC permettent à long terme d’exploiter le potentiel d’une entreprise, de structurer le système d’information, de gagner en performance et en productivité, et de prendre avantage des plus récentes innovations. En outre, grâce à l’internet, l’entreprise s’ouvre sur le monde et peut se faire connaitre.
Le visage de l’entreprenariat change et évolue grâce à la technologie qui permet de se créer une part de marché plus facilement, et aussi d’exploiter au mieux les potentiels et les talents. Évidemment, l’atteinte d’un tel objectif de prospérité et de productivité n’est pas aisé, et les femmes entrepreneures devront surmonter de nombreux obstacles et contraintes. Elles devront relever bien des défis comme :
- les problèmes de manque d’inclusion financière ;
- et aussi les insuffisances de la législation concernant le monde informatique, le commerce électronique et d’autres domaines connexes ;
- et enfin les carences en termes d’éducation financière qui empêchent de prendre des décisions optimales en matière de choix de services financiers ou de moyens pour mieux offrir des services
Il est d’autant plus souhaitable d’envisager une voie nouvelle pour les femmes entrepreneures d’Haïti que leur situation courante est très difficile. Ne pouvant pas répondre aux exigences des institutions financières formelles, les femmes entrepreneures ont souvent recours aux circuits financiers informels, tels que les prêts accordés par des proches, par un « notable » de la région ou par un usurier ; les « sol », etc. Le microcrédit octroyé par des institutions de microfinance est également largement utilisé par les femmes entrepreneures pour de faibles montants, ceux de moins de 100 mille gourdes.
Il est énorme, le travail qui nous attend tous, y compris l’État haïtien. Pour sa part, la BRH s’est engagée résolument dans une stratégie d’inclusion financière visant la protection et du consommateur, et du producteur. Nous voulons accorder une attention particulière aux femmes entrepreneures afin de leur faciliter l’accès au crédit et à d’autres services financiers. Ce faisant, nous nous penchons sérieusement sur cet objectif du document de stratégie nationale qui prévoit la promotion de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) pour la prestation de services financiers. À travers les différentes actions à mettre en œuvre, l’objectif final est d’ouvrir le marché financier aux femmes entrepreneures grâce aux NTIC et à une règlementation adaptée à leurs besoins tout en tenant compte des obstacles structurels du pays.
Conjuguons donc nos forces et nos moyens afin de mettre nos femmes entrepreneures en mesure d’accéder pleinement à la place que, depuis toujours, leur a méritée leur contribution extraordinaire au fonctionnement quotidien de la communauté haïtienne toute entière.
Je vous souhaite donc à toutes et à tous un fructueux colloque.
Jean Baden Dubois
Gouverneur
Honorables parlementaires,
Monsieur le Secretaire General de la Primature,
Monsieur le President de la Cour Superieure des Comptes et du Contentieux Administratif,
Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,
Madame le Représentant résident de la Banque Mondiale,
Monsieur le représentant du Fonds Monétaire International,
Monsieur le representant résident de IFC,
Messieurs les représentants des organisations internationales,
Mesdames, Messieurs les Maires de la zone métropolitaine,
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux,
Mesdames, Messieurs les Représentants de l’administration publique,
Chers Collègues du Conseil d’Administration,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Distingués Invités,
Mes propos de remerciement vont également à l’endroit de tous ceux qui ont supporté l’organisation d’un tel atelier, nous voulons parler du Groupe de la Banque Mondiale.
Permettez-moi tout d’abord de situer un peu le contexte de cet atelier. La réflexion autour de la bonne gouvernance s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles et surtout de la volonté des dirigeants de faire de cette problématique la cheville ouvrière d’un état moderne et efficace.
L’environnement économique et social actuel caractérisé particulièrement par : une dégradation sensible du niveau de vie des ménages, une hausse des prix des produits de consommation de base, une récurrence des catastrophes naturelles et des chocs externes multiplie les défis auxquels l’Etat central se trouve confronté.
Malgré les efforts consentis et réalisés au sein des différentes institutions publiques et des collectivités territoriales, la question de la gouvernance est significative pour l’Etat.
Si les débats sur la gouvernance d’entreprise, synonyme de l’art de mieux gouverner, remontent aux années 30, ce concept se cherche encore en Haiti et la tenue de cet atelier traduit nos préoccupations.
Gérer les affaires économiques, publiques et privées grâce à des institutions, des mécanismes et des procédures connues, dans l’efficience et l’équité en vue d’un bien-être des individus et des collectivités. C’est là une définition de la bonne gouvernance.
Le développement d’Haiti passe par le renforcement de l’Etat et l’adoption de bonnes pratiques en matière de gouvernance. Cela exige un engagement politique fort des autorités qui doivent les expliciter et dégager les moyens nécessaires pour leur succès. Nous sommes convaincus que le renforcement des bonnes pratiques en matière de gouvernance des institutions haïtiennes contribuera plus efficacement à l’amélioration de leur performance et, partant, à l’essor économique de notre pays. Le renforcement des capacités des institutions est donc nécessaire.
Mesdames et Messieurs,
La gouvernance renvoie aux règles, pratiques et normes observées dans la gestion d’un pays. Une bonne gouvernance respecte les valeurs de transparence et d’éthique et se conforme aux exigences légales en vigueur dans le pays concerné. Une gouvernance saine et transparente exige donc des pratiques rigoureuses reposant notamment sur l’obligation de rendre des comptes à intervalles réguliers. Elle vise également à combattre la corruption, qui par essence contourne et travestit les règles établies.
Les règles font également appel à la responsabilité de tous à commencer par les dirigeants au plus haut niveau, notamment les Conseils d’Administration et, dans une certaine mesure, les Directions Générales.
Aussi, est-il important que les dispositions soient prises afin de s’assurer de la mise en place d’une politique nationale qui nécessitera une collaboration étroite entre plusieurs groupes d’intervenants, chacun avec un ensemble de rôles et responsabilités principales.
Mesdames et Messieurs,
Il est temps d’aligner nos visions du développement économique et social. La production de richesses et la création d’emplois sont des conditions prioritaires pour viabiliser les réformes déjà entamées et pour soutenir une relance économique durable. Ainsi, les mobilisations de ressources et les efforts qui sont consentis ne pourront pleinement réussir qu’avec une politique de bonne gouvernance.
Je voudrais terminer en vous invitant à tirer meilleur profit du présent atelier pour renforcer les dispositifs de gouvernance au sein de vos structures respectives.
Merci
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances,
Honorables Parlementaires,
Madame, Messieurs les maires,
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux,
Mesdames, Messieurs les représentants du système bancaire et financier,
Au nom du Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haïti et en mon nom propre, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à ce forum dédié aux enjeux économiques de la copropriété.
Mesdames et Messieurs,
L’urbanisation croissante de nos chefs-lieux de départements et de la capitale requiert de nouveaux aménagements du territoire et des plans de développement durable. L’occupation de l’espace des villes doit être pensée et repensée de manière plus fonctionnelle si l’on tient compte de l’existant.
Le développement de façon verticale est la seule manière de faire face à la problématique du logement. Il faudra bien sûr tenir compte des impacts socio-économiques, culturels et environnementaux.
Au niveau légal, la loi du 13 août 1984 organisant le régime de la copropriété et l’arrêté du 15 décembre 2011 fixant la procédure et les modalités d’application de la loi du 13 août 1984 constituent le cadre juridique de base. En outre, en 2013, le secteur de l’immobilier a été déclaré prioritaire en vertu des dispositions du Code des investissements afin d’appuyer la politique nationale de promotion des logements. A cet effet des avantages incitatifs ont été accordés aux entreprises éligibles.
Malgré ce dispositif qu’on pourrait qualifier d’embryonnaire, il n’existe pas réellement de projet immobilier majeur à voir le jour dans le pays. Certes, des projets de construction de logements sociaux et d’appartements ont été initiés ces vingt dernières années. Cependant, ces initiatives ont montré leur limite avec la rareté des espaces à usage d’habitation.
Par ailleurs, la BRH, tout en menant une politique monétaire globalement restrictive pour lutter contre la volatilité de la gourde et combattre l’inflation, a mis en place et renforcé plusieurs programmes visant à faciliter, le financement de certains secteurs productifs clés à forte valeur ajoutée et pouvant influer fortement sur la quantité d’emplois créée et sur la croissance économique, ce, en collaboration avec les institutions financières.
C’est ainsi que, depuis 2011, la BRH, en tandem avec la plupart des banques de la place, exécute avec un certain succès, un programme de refinancement de l’immobilier résidentiel pour stimuler le crédit bancaire au logement, combler le déficit de logement et faciliter l’accès à la propriété. L’idée est essentiellement d’agir sur la disponibilité du crédit, de réduire les coûts financiers des fonds empruntés et de rendre les prêts immobiliers plus intéressants pour les particuliers et pour les institutions financières.
Le programme, dénommé Kay Pa’m, a aidé les banques à financer des constructions résidentielles avec :
- un taux d’intérêt qui varie entre 8 à 10%
- un taux d’intérêt fixe sur 10 ans, et
- un financement exclusivement en gourdes.
Le succès du programme Kay Pa’m s’est traduit par l’augmentation du nombre d’institutions participantes et des produits hypothécaires offerts à la clientèle. Les dernières données suggèrent une progression significative des prêts à l’immobilier résidentiel, consécutivement à l’expansion de ce programme. Cependant, c’est loin d’être suffisant. A partir de sources combinées, il a été estimé un déficit d’offre de logements de 300,000 unités en 2009 sur un stock de logements de 2,1 millions d’unités occupées. Le séisme de 2010 est venu creuser encore plus ce déficit. Une statistique venant de l’état haitien estimait en 2013 que « la zone métropolitaine de Port-au-Prince à elle seule nécessitera au moins 500,000 unités de logement supplémentaires pendant les 10 prochaines année pour combler le déficit d’avant séisme, pour réparer les dégâts du tremblement de terre et pour répondre à la demande substantielle de logements consécutive au développement urbain » Nous en sommes encore très loin..
Mesdames et Messieurs,
La problématique du logement en Haïti demeure préoccupante. Toutefois, il s’avère nécessaire d’analyser, de discuter, d’échanger et de poser les problèmes : quelles sont les politiques publiques en matière d’urbanisation et de logement ? Il nous faut soulever la problématique du cadastre, les problèmes liés à l’environnement. Il nous faut aborder les questions de financement de l’immobilier et les risques encourus par les institutions financières, sans écarter les aspects légaux, l’enregistrement des titres et des contrats, la fiscalité et, enfin, explorer des pistes tels que les possibilités de partenariat entre l’Etat et le secteur privé.
L’appui économique au secteur du bâtiment ne peut se faire de manière adéquate si ces questions ne sont pas posées et des solutions viables ne soient pas trouvées et mises en application.
Les avantages de la copropriété sont pourtant multiples. Il est irrationnel de penser que ce déficit de logement peut être comblé avec notre manière traditionnelle de construire des résidences isolées, une par une……. La copropriété répond à une nécessité en raison de sa commodité et de son coût d’acquisition généralement plus abordable. La copropriété peut répondre à la pénurie du logement décent pour les ménages à revenu moyen dans de meilleures conditions de coût et d’environnement physique.
Il est donc indispensable de sensibiliser les acteurs publics et privés, d’informer les promoteurs immobiliers, hommes et femmes d’affaires, banquiers et autres opérateurs économiques de cette opportunité non négligeable dont ils disposent, mais manifestement encore trop peu connue du grand public.
La BRH s’est engagée dans des réflexions pour orienter un pan de sa politique vers un programme de refinancement de Promoteurs Immobiliers, ou développeurs de grands projets immobiliers au bénéfice des cadres de la fonction publique, des professionnels et de la diaspora haitienne. Ces projets devraient viser la construction de Complexes d’Appartements destinés à la location ou à la vente en copropriété, la construction de villages résidentiels, l’acquisition et la viabilisation de terrains destinés à un projet de logement.
Ces programmes une fois lancés, devraient servir de base au développement, dans le moyen terme d’un marche obligataire à travers la titrisation des portefeuilles de prêts immobiliers.
Nous espérons que ce forum permettra de mieux identifier les contraintes, de faire ressortir les difficultés, de fournir des pistes de réflexion et d’aboutir à des politiques publiques de logement, au renforcement du secteur du bâtiment, à la valorisation des métiers liés à la construction, à un cadre juridique concis et adéquat, au développement de mécanismes financiers, à l’accroissement du crédit immobilier, mais surtout à rendre accessible aux ménages et familles un logement décent.
Voilà, Mesdames, Messieurs, un véritable défi pour le développement économique du pays.
Pour commencer à faire face à ce défi, le présent forum nous offre l’occasion de réaliser une réflexion approfondie en vue de la construction d’immeubles en copropriété dans une perspective de réduction des coûts et des risques.
Nous remercions les distingués panélistes qui ont accepté notre invitation de ce jour et formulons le vœu que les travaux de ce forum soient couronnés de succès.
Merci !
Port-au-Prince, le 29 juin 2017
Madame le Directeur General,
Messieurs les représentants du Ministère de l’Économie et des Finances,
Monsieur le PDG du Groupe Croissance
Mesdames, Messieurs les Directeurs des Banques Commerciales,
Mesdames, Messieurs les représentants des supermarchés et autres établissements commerciaux,
Chers collègues de la BRH et du système bancaire,
Distingués invités,
Le thème du forum d’aujourd’hui est d’une importance qu’on ne saurait trop souligner. Cette importance tient au caractère vital que revêt la monnaie dans toute société qui participe aux mouvements et transactions de l’économie moderne. Il est vrai que, depuis quelques temps déjà, la monnaie traditionnelle est en proie à la concurrence vigoureuse de diverses formes non physiques de moyens d’échange. Il est vrai aussi que l’évolution monétaire la plus marquée dénote une tendance croissante à la dématérialisation, surtout avec l’émergence récente de monnaies électroniques comme le bitcoin. Toutefois, cette réalité n’empêche guère encore que la monnaie physique ou le cash reste cet élément nécessaire pour échanger pleinement dans nos sociétés contemporaines de production. En fait, on n’a pas hésité à attribuer au mouvement de circulation de la monnaie au sein de l’économie des attributs pareils au mouvement du sang à travers le corps humain.
Un rôle si prépondérant, essentiel même pourrait-on dire, s’explique par le fait que la monnaie est un intermédiaire de choix qui permet aux agents économiques de manifester une demande effective pour les divers produits disponibles sur le marché. Elle est donc cet instrument unique d’amélioration des circuits d’échanges, un maillon incontournable de la chaîne économique qui unit la production à la consommation. C’est une fonction que la monnaie a toujours exercée, et ce, comme nous le révèle la numismatique, à travers les diverses formes qu’elle a connues depuis le troc du tout début.
De manière encore plus fondamentale, et d’un point de vue conceptuel, la monnaie permet aux opérateurs du marché d’évaluer quantitativement ladite demande afin, d’une part, d’exprimer la force de celle-ci par rapport à l’offre disponible et, d’autre part, de refléter la rareté relative des biens et services telle qu’exprimée par le système des prix. À cela, il faut ajouter les atouts instrumentaux de la monnaie, lesquels se manifestent à travers les diverses fonctions de celle-ci. Ainsi, la monnaie :
- se fait unité de compte, de par sa divisibilité ;
- elle se fait réserve de valeur, de par sa durabilité ;
- et elle se fait moyen de paiement, de par le consensus collectif qui garantit son invariable acceptabilité.
Dès lors, au vu de tous les enjeux qui découlent du rôle qu’elle assume pour le financement de l’économie, l’on comprend que la monnaie se place au cœur de la mise en œuvre par la Banque Centrale de sa mission de surveillance du fonctionnement du système financier en vue d’en assurer la stabilité constante. C’est que le cash reste, jusqu’à aujourd’hui encore, le moyen prédominant de règlement des transactions financières routinières de l’économie domestique. Du coup, il revient à la Banque Centrale d’assurer que le système économique haïtien, dans toutes ses composantes, sans exclusive, dispose d’une monnaie fiable, et disponible sans restriction et de manière continue.
Ce mandat consistant à s’assurer que les moyens de paiement en monnaie fiduciaire mis à la disposition du public suffisent pour répondre aux besoins de l’économie, c’est à sa Direction de la Caisse et du Réseau que la BRH l’a confiée. Un tel mandat se place en ligne directe de la vision que le Conseil d’Administration que j’ai l’honneur de diriger a définie pour la BRH, et je cite :
« Une banque centrale moderne et efficiente, soucieuse de la stabilité des prix et du développement du système financier et déterminée à encourager la croissance des secteurs réels de l’économie dans l’optique d’une Haïti inclusive ». Fin de citation.
Cependant, la BRH croit qu’un système ne peut fonctionner à point que lorsqu’il y a cohérence entre les comportements de toutes les structures qui le composent. Si telle composante remplit le rôle dévolu à telle autre, des confusions se créeront, des goulots d’étranglement se formeront, et des inefficiences se développeront. Naturellement, ce système finira par s’essouffler.
L’organisation de ce Forum découle à la fois de cette vision d’inclusion des secteurs réels de l’économie et de ce mandat d’assurer l’approvisionnement adéquat du marché en monnaie fiduciaire.
Divers sujets seront débattus au cours de la journée. Citons, entre autres :
- la nécessité de créer un mécanisme de dialogue entre les Directeurs des Opérations des Banques afin de mieux servir les agents économiques ;
- la problématique de la disponibilité de la monnaie chez nous ;
- les annonces et propositions qui seront faites par la Direction de la Caisse et du Réseau pour une gestion plus moderne et plus efficiente des questions relatives à la gestion du cash ;
- et j’en passe.
Toutes ces conversations et tous ces échanges participent de cette politique d’ouverture que la BRH entend pratiquer à l’égard de tous les acteurs de l’économie réelle. La tenue de ce Forum est aussi une des nombreuses manifestations de notre politique de partage et de divulgation de l’information financière.
En vous accueillant ici ce matin à l’occasion du lancement de ce Forum, j’espère témoigner, s’il en était besoin, de l’importance que l’actuel Conseil d’Administration de la BRH accorde à la stabilité du système financier de notre pays. C’est également un gage de soutien envers la Direction de la Caisse et du Réseau qui a résolument embrassé la vision du Conseil et qui, ces derniers temps, se distingue par un certain nombre d’initiatives orientées vers cette modernité et cette efficience que nous prônons. Je pense particulièrement à l’acquisition et à la mise en service d’équipements sophistiqués comme le CPS 1500, destiné au comptage automatisé des billets, ou encore le BDS qui sera affecté à la destruction des billets mutilés.
Je vous encourage donc à participer activement aux échanges et aux débats afin de nous permettre de trouver des solutions réalistes et durables aux différents problèmes qui nous préoccupent, dans l’espoir de dégager un consensus, un « modus operandi » pour un fonctionnement harmonieux du système.
Bonne journée, et bon travail à toutes et à tous !
Jean Baden Dubois
Gouverneur de la BRH
Mesdames/Messieurs les PDG et Représentants des banques commerciales
Mesdames/Messieurs les Représentants du secteur privé
Monsieur le PDG du Group croissance
Monsieur le PDG de PROFIN
Chers collègues du CA de la BRH
Mesdames/Messieurs
Cette année encore, le menu est copieux mais équilibré. Un arbitrage difficile mais toujours à la portée d’organisateurs efficients qui ne sont pas à leur coup d’essai. Les activités sont de première qualité, ce qui garantit la satisfaction de cette auguste assemblée que vous formez et des esprits critiques que vous représentez. La richesse du Sommet International de la Finance est là ; dans ce creuset d’idées et de diversités. Bienvenue à la 7ième édition. Le thème central est de la plus haute importance : Financer l’Immobilier en Haïti. Il est au cœur d’une problématique plus large : le besoin d’une croissance forte et soutenue face à une dynamique démographique intense.
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais me faire complice d’un acte de contagion ce soir. Celui de vous communiquer la joie et l’enthousiasme que je ressens à délivrer cette adresse à l’occasion de la 7ième édition du Sommet Internationale sur la Finance et de la deuxième édition du Fin Tech. Mais je ne parle pas qu’en mon nom.
- Je parle au nom du Group Croissance et de son Président-Directeur Général Kesner Pharel à qui j’adresse un hommage chaleureux pour la qualité d’organisation et la régularité d’un événement qui gagne en ampleur chaque année sur le plan de la participation et sur celui de la pertinence de thèmes d intérêt majeur pour les politiques publiques et les acteurs économiques.
- Je parle au nom des multiples stake holders dont la qualité et le niveau de représentation attestent de l’intérêt d’une communauté grandissante pour les questions de la Finance et pour le financement du développement en général.
- Je parle certainement au nom de la Banque de la République d’Haïti qui, depuis quelques années, est passée de l’autre côté des coulisses pour devenir une coorganisatrice active du Sommet. Notre équipe travaille d’arrache-pied à améliorer la valeur ajoutée que notre institution apporte à l’organisation de l’événement. Elle garantit ainsi l’objectif de familiariser davantage les acteurs économiques avec la vision, les objectifs, les instruments de la Banque Centrale ainsi que les contraintes auxquelles elle fait face.
Vous comprenez donc pourquoi le succès qui couvrira les assises qui se tiennent durant les cinq jours ouvrables de cette semaine de la Finance ne sera pas le fruit du hasard. Un nombre important d’acteurs y aura contribué. Aussi, permettez-moi d’associer la voix de l’auguste assemblée que vous représentez à celle du Conseil d’Administration de la BRH pour adresser des remerciements chaleureux à tous ceux qui, personnes physiques ou morales, à un niveau ou à un autre, auront fait de cette 7ième édition un succès de plus.
Mesdames et Messieurs,
La problématique du développement demeure le thème majeur dans un pays, où dans 65% des cas, le Produit Intérieur Brut par tête d’habitant est négatif sur les 36 dernières années. Pour le banquier central que je suis, le financement de la croissance, dans des conditions macroéconomiques saines, est au cœur de cette problématique. Il s’agit donc d’exclure les extrêmes que sont l’euphorie de la précipitation et la paralysie de l’attentisme. De ce point de vue, la consolidation des institutions financières, leur développement et l’élargissement de leur spectre d’action représentent la voie qui sied à une démarche raisonnée de politique monétaire propre à supporter la croissance.
La Stratégie Nationale d’Inclusion Financière participe de cette démarche et notre présence renforcée à ce Sommet répond au besoin d’en assurer la promotion à travers l’un des piliers importants de cette stratégie : l’éducation financière. C’est ainsi qu’au cours de la semaine dernière et pendant toute la semaine consacrée à la Finance, des cadres de la BRH se déplacent dans les écoles secondaires publiques et privées pour exposer aux écoliers des classes terminales des éléments basiques en économie et en Finance et traiter de sujets se rapportant à la mission et aux activités de la Banque de la République d’Haïti.
L’éducation financière est une entreprise de longue haleine qui devra toucher toutes les composantes de la population. Elle est pourtant appelée à porter des fruits assez rapidement et l’espérance de son rendement socioéconomique est parmi les plus élevées. Pour un Policy Maker, rien ne vaut une population éduquée des questions économiques et informées des politiques mises en œuvre. C’est la garantie première à l’émergence d’une double prévisibilité : celle de la réponse des agents économiques aux mesures envisagées et celle des solutions que doivent apporter les décideurs aux problèmes soulevés. Ce qui constitue la voie royale de la primauté des règles dans la conduite des politiques publiques sans omettre le rôle que jouent ces informations dans la formation des anticipations.
Une telle démarche devrait bénéficier tant qu’au cadre unique de l’environnement macroéconomique qu’aux cadres multiples des politiques sectorielles. Et dans le cas qui nous concerne aujourd’hui, à la réussite d’une politique éclairée de financement du secteur immobilier. Ce secteur se trouve à la jonction de trois dimensions d’un développement durable et intégré. Il est une sous-branche importante de la branche des Bâtiments et Travaux Publics autour de laquelle se construisent les infrastructures économiques et sociales. Il est un indicateur de mobilité sociale et de renforcement des classes moyennes. Il est une composante pérenne du moteur de la croissance économique à travers des effets directs notables et des effets induits renouvelés. Voilà pour l’essentiel, les motivations de la banque Centrale dans la promotion de ce secteur.
Mesdames et Messieurs
Le déficit de logements est un problème structurel que certains experts font remonter à la période de l’indépendance. Il participe d’une situation plus large liée aux problèmes de l’habitat et de l’urbanisation sans l’exclure de la problématique globale de l’aménagement du territoire. Cependant la nature du problème requiert une approche jointe qui tient de considérations de moyen et de long terme. Il s’en suit que les réponses aux problèmes du logement ne peuvent attendre la longue période de mise en branle d’une politique complète d’urbanisation. Elle doit, par contre, en tenir compte pour s’assurer de la durabilité des investissements dans le domaine et réduire les coûts futurs d’expropriation que la modernisation urbaine imposera aux ménages et au Trésor Public.
Les réflexions et les dispositions de la Banque Centrale en faveur du financement du secteur de l’immobilier remontent bien avant le 12 janvier 2010. La plus ancienne de ces dispositions date de la loi (décret) de création des Banques d’Epargne et de Logement qui les exonère de 50% des réserves obligatoires en vigueur. Ce qui atteste d’une forte tradition de préoccupation de l’institution pour le financement du secteur immobilier qui a cumulé, en 2009, un déficit d’offre de logements de 300,000 unités sur un stock de logements occupés de l’ordre de 2,1 millions unités selon des estimations venant de sources combinées.
Le séisme est venu fortement creuser le déficit d’offre déjà très sérieux. Les estimations cependant tombent dans un intervalle trop large pour être concordantes. Elles vont d’un minimum de 105,000 à un maximum de 300,000 unités détruites. Fort heureusement, une statistique qui fait autorité, puisque venant de l’Etat haïtien, estimait en 2013, que « la zone métropolitaine de Port-au-Prince à elle seule nécessitera au moins 500,000 unités de logement supplémentaires pendant les 10 prochaines années pour combler le déficit d’avant séisme, pour réparer les dégâts du tremblement de terre et pour répondre à la demande substantielle de logements consécutive au développement urbain. »
Aujourd’hui, on ne peut approcher la question du logement en Haïti qu’en termes de crise profonde. Mais tout profonde qu’elle est, cette crise contient les germes du renouveau. Il dépendra du leadership des autorités publiques et de la perspicacité des investisseurs privés pour en tirer partie. La nature du problème immobilier en fait un secteur à potentiel très élevé de croissance. Il ne s’agit pas que d’unités de logement à bâtir. Dans une perspective moderne : il s’agit d’un domaine dont le profil et le contenu restent à concevoir ; il s’agit d’un espace économique dont la portée sociale est essentielle si l’on veut reconstituer les classes moyennes ; Il s’agit d’un secteur qui se prête aisément à une dynamique large de création de richesse grâce à la multiplicité des chaines de valeurs qu’il induit et la durabilité du processus qu’il peut enclencher.
Conduire tous azimuts une politique de développement du secteur immobilier est donc une nécessité d’un point de vue social et un passage obligé d’un point de vue économique. Une entreprise conséquente qui visera à réparer un drame séculaire qui trouve ses manifestations dans un habitat rural épars et une expansion anarchique des espaces urbains. La Banque Centrale s’attèle à trouver les meilleurs moyens, en termes de montages et de mécanismes financiers, pour amplifier son apport à la mise en branle d’un projet qui reste un objectif majeur de croissance et de développement. Son rôle demeure ancré dans les dimensions (économiques) jointes de ce projet d’envergure :
- Une contribution incitative à la constitution par le secteur privé des affaires d’une offre diversifiée de logements et d’immeubles dans les meilleures conditions de coûts et d’environnement physique
- La promotion d’une dynamique de croissance susceptible de garantir la solvabilité d’une demande en progression régulière qui permette une rentabilité suffisamment élevée pour viabiliser le secteur
- L’effort de mobilisation des ressources pour financer les lourds investissements nécessaires à la réalisation d’économies d’échelle bénéfiques au marché. Je vous ferai grâce de calculs financiers rébarbatifs qui ne cadrent pas nécessairement avec mon adresse. Mais tentons pour le moins une arithmétique simple de la question immobilière. Restons dans la lignée d’une étude rendue publique après le séisme de 2010 pour nous en tenir à une demande annuelle de 4500 à 5000 unités venant de la classe moyenne. Dans des conditions raisonnables d’économie d’échelle, un prix unitaire moyen de $75,000 est dans l’ordre des transactions possibles pour des logements de niveau standard. Nous aboutissons pour cette seule composante de classe moyenne à un niveau annuel de l’ordre de 350 millions de dollars d’investissement résidentiel. Des ressources à la portée du système financier formel et dont le coût d’emprunt ne dépasserait pas les $700 le mois pour tendre vers les $350 au terme d’un prêt immobilier de 20 ans assorti d’intérêt bonifié de l’ordre de 5% à 6%.
Je n’irai pas plus loin en inférence pour projeter les effets directs et les effets d’entrainement d’un tel effort d’investissement sur l’économie. Contentons-nous d’admettre qu’ils sont potentiellement importants et durables s’ils sont renouvelés sur un horizon de moyen terme. Mais les étapes, diriez-vous, pour rendre faisables des objectifs de cette envergure, dans le cadre du développement du secteur immobilier, sont multiples et tiennent à de fortes pesanteurs de nature structurelle, légale et institutionnelle.
- Les contraintes majeures du problème cadastral qui limitent la mise en œuvre d’une politique de l’habitat, rationnent le financement immobilier tout en renchérissant les coûts.
- La multiplicité de coûts administratifs et fiscaux dont le cumul grève la part des ressources financières préposées à l’implantation immobilière proprement dite.
- L’inadéquation d’un cadre légal suranné qui occasionne de sérieux coûts d’immobilisation sur le portefeuille de crédit immobilier des institutions financières en raison de trop longs délais de réalisation de propriétés données en gage.
Ces problèmes, pour ne citer que ceux-là, font partie d’un environnement globalement défaillant qui décourage les investissements dans le secteur et dilue les impacts des mesures incitatives à son financement. D’où le rôle fondamental que les politiques publiques sont appelées à jouer pour desserrer les contraintes d’un domaine de production capable de porter la croissance et d’animer des pans divers de l’activité économique. L’arrêté d’application de la loi sur la copropriété est un pas dans la bonne direction. Il incite à la modernisation d’un secteur dont la réalisation du plein potentiel requiert deux voies d’actions :
- Celle portant sur les contraintes de nature structurelle et de nature juridico-administrative pour créer un cadre d’attraction et de rentabilité suffisantes des investissements.
- Celle visant à réduire sur le moyen terme la composante des importations dans les coûts de construction pour magnifier les effets indirects induits par la croissance du secteur.
Sur le plan de la mobilisation des ressources, la Banque Centrale poursuit les travaux nécessaires à la mise en phase de son action avec les exigences de développement du secteur immobilier. L’accent est mis particulièrement sur les contours de l’environnement financier propre à supporter l’effort de financement qui devra mobiliser l’ensemble des acteurs du système bancaire et au-delà. Nous sommes conscients des limitations d’une approche partielle où les préoccupations de coûts l’emportent sur la coordination de politiques publiques d’horizons divers. C’est pourquoi nos réflexions portent en priorité sur la mise en séquence des actions de politiques qui permettront de raccourcir les délais de réalisation des objectifs visés.
Entre temps, la politique de stimulation du crédit en faveur du relèvement du secteur de logement suit son cours. Comme vous le savez, La BRH a pris des mesures pour exonérer de réserves obligatoires les ressources collectées par les banques et utilisées à des fins de crédit au logement et au secteur hôtelier. De même des protocoles d’accord ont été signés avec certaines banques dans le cadre d’un programme visant à financer, en des termes favorables, l’acquisition, la rénovation ou la construction de logements au bénéfice de clients solvables. Les réponses du marché immobilier à ces dispositions prendront de l’ampleur au fur et à mesure que s’aplaniront les contraintes de nature structurelle et institutionnelle comme celui du cadastre.
Pour contourner ce dernier problème, la BRH s’est engagée dans des réflexions pour orienter un pan de sa politique du logement vers le financement de promoteurs ou développeurs de grands projets immobiliers au bénéfice des cadres de la fonction publique, des professionnels et de la diaspora haïtienne. Ces projets devraient viser la Construction de complexes d’appartements destinés à la location ou à la vente en copropriété, la construction de villages résidentiels, l’acquisition et la viabilisation de terrains destinés à un projet de logement.
Ce programme, une fois lancé, devrait servir de base au développement, dans le moyen terme, d’un marché obligataire à travers la titrisation des portefeuilles de prêts immobiliers. La mise en place d’un tel marché pourrait contribuer à une meilleure allocation de l’épargne des agents économiques, alimentant ainsi un cercle vertueux de développement de ce secteur d’avenir.
Mesdames, Messieurs
J’espère vous avoir communiqué un peu de mon enthousiasme sur la question immobilière. Au départ je faisais remarquer que la voie des solutions au problème du secteur n’est pas celle des extrêmes : ni précipitation… ni attentisme. La réponse au séisme du 12 janvier 2010 fut un bon exemple de ce comportement mesuré. La BRH a ressorti des mesures qui portaient sur le coût et l’accessibilité du crédit au logement. Une démarche qui, dans un premier temps, rentrait nécessairement dans le cadre d’une approche partielle. Pour le débiteur comme pour un créancier, ce sens de l’urgence ne pouvait trouver réponse que dans les instruments de politique monétaire pour apaiser les tensions du marché immobilier et inviter les agents économiques à plus d’optimisme.
Avec le bénéfice du recul, une approche plus complète s’est imposée à la réflexion sur la problématique de l’immobilier. Elle permet d’intégrer une meilleure compréhension des dimensions d’avant et d’après séisme dans les solutions qui se dessinent. Au cours des dernières années, les réflexions sont passées par un processus de maturation qu’on retrouve dans la qualité des propositions et le caractère d’application qui s’y dégage. Le 7ième Sommet de la Finance est l’espace idéal pour consigner ces propositions dans un cadre cohérent de réflexions pour l’action. Praticiens des questions la Finance, décideurs politiques, professionnels du secteur, universitaires et investisseurs y trouveront leur compte. Voilà tout le bien fondé de cet enthousiasme que je veux être contagieux.
C’est donc avec emphase que, au nom du Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haïti, je remercie tous ceux qui font de ce Sommet ce succès qu’il est déjà. Ces remerciements vont particulièrement à l’équipe du groupe Croissance et à son PDG Kesner Pharel ainsi qu’à l’équipe de la BRH qui a travaillé sous la supervision d’un membre du Conseil d’Administration en la personne de Ronald Gabriel. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre reconnaissance.
Merci!
Mesdames, Messieurs,
Chers participants,
J’espère que ce colloque –avec cette brochette d’analystes distingués et experts de haut niveau comme Charles Castel, mon prédécesseur à la BRH, Fritz Duroseau mon actuel collègue au Conseil d’ Administration, et d’autres spécialistes universitaires et de la communauté internationale- donnera lieu à des échanges fructueux susceptibles de conduire à des politiques publiques favorables à la stabilité et à la croissance économiques.
Mesdames, Messieurs,
Il est difficile d’exagérer –au moins pour Haïti- l’importance des remises de fonds, communément dénommées Transferts de fonds sans contrepartie en provenance de l’étranger ou encore Transferts courants dans la nomenclature internationale de la balance des paiements. Cet agrégat, qui regroupe les dons officiels officiels reçus de l’étranger et les envois de travailleurs d’origine haïtienne, s’élevait à US $2,5 (26.1% du PIB) milliards en 2014, dont 563.0 millions de dons officiels et US $2.0 milliards (19.7% du PIB) en remises de travailleurs. Les transferts courants (sur une base nette) devraient atteindre US $2.7 milliards par an (29.2% du PIB) et les envois de travailleurs autour d’US $2.3 milliards (25.0% du PIB) de cette année à l’exercice 2020-2021. A 22.7% du PIB en 2014, Haïti figure en 8ème place dans la liste des plus gros receveurs de transferts (ou les pays les plus dépendants des envois de travailleurs) après le Tadjikistan, la République Kyrgyz, le Népal, Tonga, la Moldavie, le Libéria et les Bermudes, selon la Banque Mondiale.
Mesdames, Messieurs,
Les transferts courants ne sont pas « produits » par l’économie comme le sont les exportations de biens et services et ne dépendent pas de l’économie comme le sont les importations de biens et services. Les recettes d’exportations nettes proviennent d’activités réelles servant de contrepartie alors que les transferts de fonds courants C’est un agrégat relativement autonome par rapport au reste du pays. En fait, il y aurait une relation négative entre l’état de l’économie et les transferts courants dans la mesure où l’aide humanitaire ainsi que les envois de travailleurs augmentent sensiblement après les catastrophes naturelles, ceteris paribus. En attendant plus d’études sur le sujet, les transferts de fonds semblent dépendre beaucoup plus du revenu des pays expéditeurs que de l’action des pays receveurs.
Ainsi la stagnation économique, la dégradation de l’ environnement physique et l’ explosion démographique, en favorisant l’ émigration massive –souvent illégale- de ressortissants haïtiens vers l’ Amérique du Nord et les Caraïbes (et maintenant vers l’Amérique du Sud) coïncident avec une expansion extraordinaire des transferts courants de US $64.8 millions en 1981 à US $234.3 millions en 1991 pour atteindre US $768.6 millions en 2001 et US $2.8 milliards en 2011.
Un premier constat est que les transferts courants, tout en finançant le reste de l’économie, augmentent plus vite que le PIB et, par conséquent, ne contribuent pas beaucoup à la croissance. Un deuxième constat qui dérive du premier : à part la construction de résidences et l’acquisition d’instrument aratoires et d’autres outils de production, les transferts de fonds, particulièrement les envois de travailleurs, financent de plus en plus plus les importations de produits alimentaires ou d’habillement, au détriment de la production locale.
Un troisième constat est le dynamisme observé des transferts vers l’extérieur (par opposition aux transferts de l’extérieur) notamment depuis le tremblement de terre de janvier 2010. Renforçant une tendance qui remonte à la fin des années 1980, avec les turbulences universitaires et la dégradation relative de la qualité de l’enseignement, des transferts vers l’extérieur financent en permanence la scolarité des membres de familles émigrés, souvent depuis le niveau secondaire.
Mesdames, Messieurs, La BRH a la charge de la préparation de la balance des paiements et, par conséquent, compile les données sur les transferts courants de fonds, notamment les envois des travailleurs, aussi bien vers que de l’extérieur. Elle travaille conjointement avec ses partenaires notamment l’ IHSI, le Centre d’Etudes Monétaires Latino-Américains (CEMLA), la BID et le FMI pour l’amélioration constante de la qualité des données statistiques. La BRH également surveille de près les flux de transferts à des fins d’évaluation systématique des liquidités sur le marché des changes et le marché monétaire, dans le cadre de l’exécution de la politique monétaire.
Les transferts sous forme d’envois de travailleurs sont devenus la plus grande source de financement extérieur dans les Caraïbes et en Afrique, dépassant de loin l’aide officielle au développement, les investissements directs et les investissements de portefeuille. Le récent rapport de la Banque Mondiale prévoit que les envois de travailleurs dépasseront US $500.0 milliards l’an au cours des prochaines années.
Mais, outre l’ampleur de ces flux, il a été observé que les transferts de fonds « possèdent une valeur intrinsèque en matière de développement » et jouent un rôle de « vecteur pour faciliter la plus grande inclusion financière », selon l’Organisation Internationale de la Francophonie. Les revenus de transferts supportent la consommation journalière en nourriture et en énergie ainsi que les investissements de base dans l’éducation, par exemple. Ces ressources permettent également de financer le lancement de bon nombre de petites et moyennes entreprises et représentent également « un important outil d’amélioration de l’autonomisation économique des femmes… ».
Dans ce contexte, la BRH met tout en œuvre pour la réalisation de l’objectif mondial de réduction des coûts des transferts de 11 à 5%, l’accès aux services de transferts pour les plus pauvres et l’ utilisation des transferts pour faciliter une plus grande inclusion financière et une croissance économique de qualité.
Sur ce, Mesdames et Messieurs, je souhaite le plus grand succès à la conférence.
Merci.
La Banque de la République d’Haïti a achevé la construction de son centre de convention et de documentation d’une superficie de plus de 6000 mètres au bas de la ville dans le centre historique de Port-au-Prince
Cette nouvelle construction, à l’ architecture contemporaine et audacieuse, occupe l’angle des rues Pavée et du Quai. Sa structure de béton repose sur plus de 360 pieux en acier et sa conception est le fruit d’un travail acharné d’une équipe d’architectes et d’ingénieurs aguerrie qui a coordonné chacune des étapes menant a la concrétisation de cette longue aventure, depuis sa conception jusqu’à la supervision des travaux.
Ce bâtiment marque un jalon important dans le nouveau développement du centre-ville de Port-au-Prince, puisqu’il est parmi les premiers édifices publics a y être reconstruits en intégrant des technologies de pointe en matière de construction parasysmique et paracyclonique.
Plus de 1000 mètres carres de toitures végétalisées qui réduiront d’autant les ilôts de chaleur au centre-ville
- Un lobby principal d’entrée isolé des rues adjacentes par un mur végétal
- Une ventilation et un éclairage naturels maximisees dans tous les espaces occupés
- Des panneaux solaires pour le chauffage de l’eau domestique
- Un système de récupération des eaux de pluie et des eaux grises des lavabos pour l’irrigation automatique des aménagements paysagers
- Des systèmes de traitement de l’air à vitesse variable controlée par détecteurs de mouvement, ainsi que des unités de ventilation qui auront la possibilité de fonctionner en mode de refroidissement gratuit lorsque la température extérieur sera favorable
- Des appareils de plomberie à débit réduit en eau incluant des cabinets à double chasse
- Des appareils d’éclairage de type LED et des moteurs à haute efficacité énergétique
- Des brise-soleil en bois d’ IPÉ réduisant les accumulations de chaleur thermique
Une salle d’ exposition multifonctionnelle d’une superficie totale de 900 m2 avec un dégagement de 10 mètres libres sous son plafond et pouvant recevoir près de 1000 visiteurs
-
- Plusieurs configurations de cette grande salle permettent la tenue d’évènements diversifiés; notamment des expositions de grand calibre, des conférences, des spectacles musicaux et théatraux ainsi que des conventions
- Cette salle, dotée d’équipements techniques multimédia à la fine pointe, est équipée de deux cloisons mobiles et motorisées permettant sa subdivision en 3 salles distinctes, deux d’entre elles bénéficiant d’ un système de climatisation, et pouvant être généreusement ouvertes sur l’ extérieur
- 2 salles de régie munies des équipements permettant la traduction simultanée
- 4 salles de réunion, équipées de système de visioconférence, chacune d’une superficie de 65 m2 pouvant acceuillir chacune jusqu’à 70 personnes
- Un foyer d’une superficie de 300m2, constituée d’une terrasse extérieure couverte et immédiatement accessible depuis le lobby d’entrée, menant à la salle principale et pouvant acceuillir 300 personnes
- Un lobby d’entrée, généreusement ouvert sur la rue, planté de grands palmiers et d’une superficie de 380 m2
- Un restaurant pouvant recevoir 125 personnes
- 5 locaux à bureaux sur la rue Pavée de superficies variant de 35 m2 à 55m2
- Un espace de documentation et de bureaux d’une superficie de 290m2
- Un secteur administratif de près de 120m2
- Un loge d’artiste pour les prestations musicales et théatrales
Enfin, des matériaux nobles et naturels, intégrant la pierre du pays et le bois d’ IPÉ
Je dois commencer par féliciter le président et les membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Grand’Anse pour cette initiative d’organiser, en partenariat avec la Banque de la République d’Haïti (BRH), cette conférence sur la transformation économique de ce département géographique.
Je présente mes vifs remerciements aux organisateurs pour ce grand honneur fait à la BRH en l’associant à cette activité qui coïncide avec la fête patronale de Jérémie, la magnifique cité des poètes. Je profite donc de cette occasion pour souhaiter, au nom de mes collègues du Conseil d’Administration de la BRH et en mon nom propre, une bonne fête à tous les Jérémiennes et Jérémiens.
C’est donc pour moi un immense plaisir de prendre la parole dans le cadre de cet événement prestigieux, qui, sans nul doute, contribuera à mettre en valeur les nombreux potentiels économiques du département de la Grand’Anse. Le département doit se relever des conséquences néfastes de l’ouragan Matthew, par la création d’un climat favorable à l’investissement privé.
Depuis le séisme du 12 janvier 2010, la BRH tente de jouer sa partition dans la relance de l’économie nationale à travers des mécanismes de stimulation du crédit productif, c’est-à-dire, à forte valeur ajoutée et avec des effets induits sur la croissance économique, les exportations et la création d’emplois durables. Sous mon administration, à l’intérieur d’un cadre de politiques publiques qualifié de « pro-croissance », ces mécanismes initiés dans le secteur immobilier ont été renforcés et étendus à d’autres secteurs économiques, notamment l’Agriculture et l’Agro-industrie. C’est donc dans ce contexte particulier que je vais vous entretenir des objectifs visés par ces mécanismes.
La BRH, de par sa loi organique, entend utiliser les moyens dont elle dispose pour conduire la politique monétaire d’Haïti et veiller à la stabilité du système financier national. En exécutant ce mandat, elle s’assure que ses actions sont inscrites dans le cadre de relance défini par les autorités gouvernementales.
Je me réjouis toujours de participer à ces rencontres qui offrent l’occasion d’échanger des idées, de débattre et de partager des réflexions en vue non seulement d’aider à la stabilité macroéconomique, mais aussi de contribuer à une croissance robuste et durable. A l’instar de celle des autres régions du pays, la population Grand’Anselaise estimée, en 2015, à environ 468 000 habitants, est jeune et en quête d’opportunités. Les politiques publiques n’ont jusqu’à présent pas produit le niveau de bien-être collectif auquel elle aspire et auquel elle a droit. Nous voulons, à travers ces mécanismes incitatifs, articulés avec d’autres programmes publics, lui donner la chance de travailler, d’entreprendre, afin de réduire sa dépendance par rapport aux transferts privés de nos sœurs et frères de la diaspora. Nous voyons aussi en notre participation, une occasion d’apprécier, au niveau de la Grand’Anse, la carence d’information qui prévaut à travers le système financier national et qui affecte l’allocation efficiente de l’épargne aux investissements viables. La BRH entend tout mettre en œuvre en vue de rendre disponible les informations relatives à ses politiques, aux mesures adoptées et aux projets sur lesquels elle travaille. Dans cette optique, une nouvelle Direction de Communication y a été créée afin d’améliorer le circuit d’information avec le Grand Public à l’échelle nationale. En conséquence, je vous donne la garantie que la Grand’Anse ne sera pas laissée pour compte dans ce processus.
Sans vouloir réveiller des souvenirs douloureux qui nous ont fait tous souffrir après le passage de l’ouragan Matthew, je dois quand même dire que ces évènements ont été pour moi l’occasion d’apprécier le courage et le sens de solidarité de la population Grand’Anselaise. Permettez-moi de saluer la résilience de cette population qui, en dépit des catastrophes et des situations dramatiques, a toujours su se relever pour construire et se reconstruire. Comme un Phénix, cette population sait comment renaître de ses cendres. Les peuples qui savent construire ne peuvent pas disparaître. C’est cette pensée qui motive les gens à investir et à faire un pari sur l’avenir. Rien de splendide n’a jamais été réalisé, sauf par ceux qui ont osé croire que quelque chose à l’intérieur d’eux-mêmes était supérieur aux circonstances. – Bruce Barton. Aussi, tirons les leçons qui s’imposent et repartons sur de nouvelles bases en faisant mieux cette fois-ci, de manière structurante et pérenne.
Mes chers amis
Nous sommes dans une région qui, à travers l’histoire, a toujours été? considérée comme l’un des principaux greniers du pays, notamment pour la qualité? de ses fruits (café?, cacao et arbre véritable), pour la diversité? de ses tubercules et pour l’abondance de ses côtes en fruits de mer. A cela, il faut ajouter les nombreux potentiels touristiques et éco-touristiques qui jusqu’à date sont quasi-inexploités.
Je salue l’action de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Grand’Anse (CCIGA), qui, a? travers son concept de plan régional intégré? 2012-2014, comptait essentiellement sur les facteurs suivants : un éveil des hommes, une mise en commun des ressources, un alignement des capacités et organismes d’exécution dans le département pour atteindre et alimenter les marchés locaux et régionaux. Beaucoup d’idées contenues dans ce plan sont encore d’actualité et peuvent servir comme base de réflexion dans la mise en place d’un plan de relance de l’investissement dans la région.
Si l’on se base sur les capacités naturelles et autres potentialités de la région, il est à mon humble avis possible d’enclencher une dynamique de croissance nécessaire à l’amélioration du niveau de vie. Il suffit de le vouloir et d’y croire.
Les importations de produits alimentaires connaissent une hausse continue. En 1986-1987, elles représentaient 19,2% des importations totales. Ce ratio est passé à 27,7% en 2014-2015. En parallèle, le poids de l’agriculture ne cesse de baisser dans notre produit intérieur brut et, pour les mauvaises raisons. Il est passé d’environ 42% du PIB en 1970 à environ 20% aujourd’hui. Je dis, pour les mauvaises raisons, car ce déclin du poids de l’agriculture n’est nullement attribuable à une augmentation de celui des industries de transformation, mais à une dépendance accrue par rapport à l’extérieur. Il nous faut impérativement trouver la meilleure formule pour augmenter l’offre de produits et de services, sinon il sera de plus en plus difficile de contenir, à terme, les pressions inflationnistes et les fluctuations indésirables du taux de change. Notons que cette dépendance par rapport à l’extérieur nous a rendus de plus en plus vulnérables aux chocs externes, notamment les chocs de prix – par exemple, les troubles sociopolitiques ou « émeutes de la faim », d’avril 2008, causés par la hausse des prix internationaux de céréales en particulier du riz, dont le cours mondial est passé d’environ 500 à plus de 1250 dollars la tonne métrique durant la période concernée.
Les problèmes de change et d’inflation ne peuvent et ne pourront être résolus de manière définitive par la politique monétaire quand ils sont causés par des facteurs structurels tels que le déficit chronique de la balance des paiements et la diminution continue de la production. Donc, nous devons générer de manière permanente des quantités de devises supérieures ou égales à nos consommations en devises. E la pa gen wout pa bwa, fòk nou rekomase pwodui e rekomanse ekspòte.
Point n’est besoin de rappeler le rôle que doit jouer le secteur privé dans la création de la richesse nationale. L’augmentation de la croissance économique, la réduction de la pauvreté et l’amélioration des conditions de vie de la population exigent un secteur privé dynamique constitué d’investisseurs locaux et de la diaspora et d’investisseurs directs étrangers. Pour être efficace il est indispensable que l’investissement public remplisse adéquatement son rôle de catalyseur de l’investissement privé. Le pays se retrouve en situation d’épargne nationale négative avec une composante d’investissement du budget de la République tributaire des appuis internationaux. La création d’un climat favorable aux investissements directs étrangers est donc un passage obligé. Ces derniers qui traduisent en général un intérêt durable de la part du promoteur du projet envers le pays ciblé ont plusieurs vertus. Ils apportent les capitaux, le savoir-faire, de nouvelles demandes, la connexion aux réseaux internationaux. Les grandes chaines d’hôtels internationales font partie de grands réseaux touristiques qui comprennent agences de voyages, lignes aériennes, hôtels, restaurants, compagnies de location d’automobiles, écoles professionnelles, services de loisirs, chaînes d’approvisionnement agricole, etc. et qui viennent avec leur demande. Les Bahamas viennent d’accueillir un investissement direct étranger de 2 milliards de dollars dans le secteur hôtelier, le projet Bahama Mar. La Corée du Sud, fort de sa stratégie axée sur les investissements directs étrangers est passée, du début des années 60 à aujourd’hui, d’une balance commerciale caractérisée par des exportations de produits primaires d’environ 600 millions de dollars à des exportations de produits industriels estimés à plus de 600 milliards de dollars par année. Son PIB per capita est passé de 143 dollars en 1963 à près de 26 mille dollars en 2016 contre moins de 800 dollars pour Haïti et 6.910 dollars pour la République Dominicaine. Nos flux nets d’Investissement Direct Etranger n’ont jamais excédé historiquement 200 millions de dollars par an alors que pour la République Dominicaine et la Corée du Sud, ils ont atteint respectivement 2,5 et 10,8 milliards de dollars en 2016.
Mesdames /Messieurs
En tant qu’entrepreneurs, producteurs, chefs d’entreprises, vous connaissez très bien l’importance du crédit dans le développement de l’activité économique et le lien qui existe entre le crédit, l’investissement, la production et l’emploi. Toutefois, vous conviendrez avec moi que l’augmentation du crédit au secteur privé ne provoque pas automatiquement la croissance économique et la baisse du chômage. Rappelons qu’en 2014-2015 le crédit accordé par le système bancaire a augmenté de près de 20% après avoir crû en moyenne de 30% durant les exercices 2010-2011 à 2012-2013, alors que le taux de croissance économique n’a été que de 1,4% pour une croissance démographique de 1,8 %. Cette croissance du crédit a dans une large mesure favorisé des importations de biens de consommation au détriment de la production locale. Le niveau de pauvreté a donc légèrement augmenté durant cette période.
C’est dans ce contexte particulier que nous accueillons tout effort des autorités visant l’amélioration de la qualité des investissements publics, une meilleure cohérence des politiques publiques et la minimisation des freins structurels à la production, à l’investissement et aux exportations. Le système financier haïtien est très liquide. Il n’attend que cela pour orienter ses ressources oisives vers des projets porteurs capables de changer, de manière pérenne, la destinée de nos frères et sœurs haïtiens.
C’est donc dans cette perspective que la BRH a mis en œuvre des programmes spécifiques en vue de promouvoir certains secteurs productifs clés à forte valeur ajoutée et à fort potentiel, susceptibles d’avoir des retombées directes sur l’emploi et la croissance économique. Ces programmes d’incitation, qui vous seront présentés un peu plus tard, permettent un accès élargi au crédit en monnaie locale et à des conditions abordables. Ils visent notamment :
1. L’augmentation de l’offre de logements et la baisse des loyers ainsi que la réduction des coûts de construction et une amélioration de l’urbanisation ;
2. La stimulation du secteur de l’assemblage et des exportations et emplois y associés ainsi que l’augmentation du nombre d’espaces industriels disponibles dans le pays ;
3. La stimulation des exportations en général, de la production locale et des rentrées nettes de devises de l’économie ;
4. Le développement du secteur touristique, principalement à travers sa composante hôtelière ;
Lesdits secteurs peuvent ainsi obtenir du crédit à des taux d’intérêt plus favorables.
D’autres projets sont à l’étude dans le cadre des mesures d’incitation aux secteurs productifs. Il s’agit, notamment, de la promotion de projets de développement immobilier ; de la promotion de la copropriété et de zones franches agricoles ; et de la mise en place, au bénéfice du secteur agricole, de garanties partielles de crédit. La BRH encourage tous les acteurs impliqués dans le développement de l’agriculture à mettre sur pied de mécanismes d’assurance, notamment pour les récoltes. Ces derniers doivent jouer un rôle clé dans la mitigation des nombreux risques auxquels est exposé le secteur et qui rendent le coût des crédits trop souvent dissuasif aux yeux des débiteurs.
Enfin, la BRH s’est récemment engagée dans une série d’activités de facilitation de dialogue et de réflexion entre les acteurs clés de différentes filières d’activité à forte valeur ajoutée à travers des tables sectorielles de concertation. La dernière en date, organisée par le Ministère de l’Agriculture, a porté sur la filière cacao. Cet exercice est basé sur l’identification des freins caractérisant les différents maillons de la chaine de valeur et qui en entament l’évolution. Il porte aussi sur l’élaboration de recommandations à l’autorité compétente pour la minimisation des freins identifiés. Il vise donc, le renforcement des politiques et des mécanismes qui favoriseront l’augmentation des financements au bénéfice de projets de plus en plus viables et capables d’influencer le développement économique du pays de manière durable.
La BRH est venue vers vous pour partager ces informations utiles. Elle est convaincue qu’elles seront utilisées à bon escient. C’est en posant ces jalons que nous réussirons à créer dans le département de la Grand’Anse, ce cercle vertueux qui devrait induire :
-
-
l’amélioration de la production et des exportations de biens et de services, notamment les services touristiques ;
-
des créations d’emplois soutenus et durables ;
-
une augmentation de la productivité de la main-d’œuvre et du capital ;
-
un élargissement de l’assiette fiscale ;
-
une augmentation soutenue du PIB per capita ;
-
un élargissement de la classe moyenne ;
-
la projection d’une nouvelle image internationale du département et du pays aux yeux des investisseurs et consommateurs potentiels.
-
Je vous remercie de votre attention et encore une fois, bonne fête de la Saint-Louis.