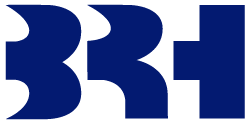Discours du Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti (BRH) à l’ouverture de la Session « Engaging the Haitian Diaspora as a priority for Haitian Development » de la Sixième Conférence annuelle de National Alliance for the Advancement of Haitian Professionals (NAAHP) New York, 4 novembre 2017
Distingués Invités,
Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,
D’abord, elle permet à la Banque Centrale d’Haïti de poursuivre le dialogue qu’elle a entamé avec d’autres entités de la Diaspora haïtienne. Il s’agit d’un échange fructueux, vital faut-il dire, un échange qui envisage, d’une part, comment intensifier le rôle déjà crucial que jouent les Haïtiens vivant à l’étranger dans l’économie d’Haïti. D’autre part, ce dialogue offre une occasion de suggérer à ces compatriotes des voies concrètes propices à une telle intensification de leur participation dans la production en Haïti. Nous voulons, par la valorisation des nombreux potentiels du pays, qu’ils bénéficient des opportunités d’investissement existant dans les secteurs porteurs et compétitifs de l’économie.
D’où le deuxième élément d’importance expliquant la participation de la BRH aux assises qui nous rassemblent aujourd’hui. Nous sommes heureux d’avoir été invités à interagir directement avec les vibrantes communautés haïtiennes évoluant dans les centres urbains majeurs de la vaste zone métropolitaine de New York, et des alentours. C’est donc pour moi une grande joie de saluer les Haïtiennes et Haïtiens ainsi que les amis et partenaires d’Haïti vivant à New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvanie, et même à Boston et le New England, et bien au-delà. Un salut spécial aux jeunes professionnels de la 2e génération, si nombreux dans les rangs de NAAHP, et qui constituent pour notre pays d’Haïti une réserve inestimable, et hautement souhaitée!
Mwen kontan anpil ke m avè nou jodi a !
Chers amis,
La thématique qui sous-tend mon intervention ce midi s’inscrit en ligne droite dans le sujet global de la conférence, à savoir:
Diaspora et croissance économique en Haïti:
Quelles voies d’engagement?
Le développement de notre pays requiert de l’économie d’Haïti une capacité à réaliser une croissance forte et à la maintenir pendant des années, sans fléchir. Sans entrer dans trop de détails, soulignons que les politiques publiques destinées à promouvoir cette croissance vigoureuse et soutenue sont globalement de deux catégories, chacune d’elles dotée d’attributions fondamentales pour toute nation. Il s’agit de la politique fiscale et de la politique monétaire. La politique fiscale est du ressort du Gouvernement et du Parlement. La politique monétaire est de la responsabilité de la Banque Centrale, laquelle a aussi la charge de veiller à la stabilité du système financier national et d’agir comme banquier de l’État. Une telle charge explique que la BRH ne cesse de mener des efforts visant une utilisation accrue des moyens importants dont elle dispose pour remplir sa mission.
Nous nous évertuons à jouer notre partition dans la création de ce climat propice à une croissance économique soutenue et durable par la stimulation de l’investissement privé, dont celui de la Diaspora.
Depuis plus de douze ans, la BRH a contribué au maintien d’un cadre macroéconomique relativement stable. Cependant, les taux de croissance économique élevés, capables de sortir de la pauvreté la majeure partie de nos sœurs et frères, n’ont pas été au rendez-vous.
L’acceptation par la BRH de l’invitation que lui a faite la NAAHP participe précisément de ces efforts. La Banque Centrale conduit sa mission en coordination avec le cadre de politiques économiques mis sur pied par les autorités gouvernementales. Une autre source de collaboration que nous prenons très au sérieux se retrouve dans le secteur privé, à l’intérieur du pays certes, mais aussi dans notre Diaspora toujours fidèlement présente, en solidarité avec la mère patrie. Nous croyons qu’en sus de cette solidarité, par vos transferts, par vos apports en capitaux et en know-how, vous pouvez et devez faire des profits en Haïti et, par la même occasion, favoriser le développement durable de votre pays.
C’est pourquoi nous sommes si heureux de nous retrouver parmi vous aujourd’hui. La Banque Centrale entend profiter de l’opportunité offerte par la conférence de la NAAHP pour partager avec les participants d’utiles informations qui pourront aider à nous mettre au même diapason en ce qui concerne l’évolution générale de la réalité économique haïtienne. De telles informations contribueront à jeter la lumière sur le cadre macroéconomique d’Haïti afin de mettre en évidence les conditions favorisant la maximisation des opportunités d’affaires viables existant dans des secteurs économiques porteurs.
Mais il ne suffira pas de partager des informations, si utiles soient-elles. Une conférence comme celle-ci fournit des possibilités de découverte, à divers niveaux, d’affinités multiples et de modalités de collaboration. Sur la base des informations fournies et des expériences déjà acquises sur le terrain en Haïti, ces possibilités devront permettre à nos sœurs et frères de la Diaspora, et surtout nos talentueux professionnels de la 2e génération, de s’intéresser beaucoup plus aux capacités latentes d’Haïti. Un tel développement est d’autant plus souhaitable que lesdites capacités ne demandent qu’à être fructifiées afin d’alimenter les potentiels du capacity building. De ce point de vue, il faut souhaiter que les jalons posés au cours de cette conférence soient autant de graines qui, semées à bon escient, génèreront les projets qui maximiseront les aubaines d’investissements dont regorge notre pays. Ces dernières ont d’ailleurs été clairement identifiées par des expertises tant nationales qu’internationales.
Distingués Invités,
Mon but aujourd’hui est de partager avec vous des données clés à propos de l’état actuel de l’économie haïtienne. Ce partage d’information vise un double objectif. Je souhaite avant tout qu’il vous porte à apprécier les opportunités d’affaires viables qu’offrent, chez nous, des secteurs économiques porteurs. Ensuite, je souhaite aussi que les détails, que je vais vous fournir, vous convaincront de prendre avantage desdites opportunités.
Mon intervention aura donc trois volets :
- D’abord, un survol du cadre macroéconomique de notre pays sur les derniers trente-cinq (35) ans. Il s’agira de jeter une lumière constructive sur les défis qui se dressent face à nous tous, question d’être bien imbus des efforts qui nous attendent.
- Ensuite, le rappel du potentiel d’investissements existant au sein de l’économie d’Haïti, un potentiel qui abonde en opportunités d’affaires pour une Diaspora dont le niveau sans pareil de transferts privés, et aussi d’autres contributions, en font déjà le pilier de l’économie haïtienne, un réservoir inestimable d’investissements aptes à stimuler le renforcement des capacités.
- Enfin, j’analyserai quelques exemples de projets d’investissement qui ont réussi en Haïti, puis je présenterai des mécanismes d’incitation mis en place par la Banque Centrale en support à des secteurs à forte capacité productive.
S’agissant du premier volet, qui concerne un survol du cadre macroéconomique d’Haïti, je vous invite à considérer deux ensembles d’observation.
Le premier est que de 1981 à 2016, l’économie du pays a connu une croissance moyenne d’environ 0,5% par an, et des épisodes d’inflation plus ou moins forte, surtout pendant les périodes 1992-1994 et 2003-2004. L’économie a aussi subi les effets tenaces de certains déséquilibres, dont celui du compte extérieur, entretenu par les carences des exportations par rapport aux importations ; et aussi le déséquilibre des finances publiques, alimenté par l’insuffisance des rentrées fiscales et la volatilité des flux d’aide externe. À cela il faut ajouter les aléas tels que les évolutions de la conjoncture sociopolitique, les dégâts causés par les catastrophes naturelles et l’impact de chocs externes comme l’embargo de 1992-1994, et aussi les chocs de prix externes, tels que ceux du pétrole et des céréales. Soulignons que ces chocs ont, pour beaucoup, été absorbées par le déficit du Trésor Public, ce qui s’est traduit par des déséquilibres macroéconomiques importants. Enfin, la parité fixe du taux de change, établie par convention depuis 1919 à 5 gourdes pour 1 dollar US, fut abandonnée au début des années 90. Trente ans plus tard, vers la fin de mars 2017, le taux de change effleura le seuil des 70 gourdes pour 1 dollar en raison principalement desdits déséquilibres.
Le deuxième ensemble d’observation est que les programmes de stabilisation mis en place de façon périodique par les autorités haïtiennes ont permis de limiter l’impact délétère de ces déséquilibres et aléas. Et les efforts consentis au cours des dernières années ont conduit à une amélioration relative de la performance macroéconomique. Mais le grand défi, pour nous tous, demeure la nécessité de tout mettre en œuvre, et sur tous les fronts, afin d’accélérer le rythme de la croissance par la maximisation des potentiels de vos investissements dans les secteurs porteurs. Il devrait en résulter une amélioration substantielle du pouvoir d’achat et des conditions de vie de la population sur le long terme.
Chers compatriotes de la Diaspora,
Le pari économique haïtien est de taille, mais les problèmes ne sont pas insurmontables. Il ne faut surtout pas baisser les bras. De son côté, si la BRH se donne une claire conscience des défis qui se posent à notre pays, c’est pour signaler l’urgence de se mettre au travail sans tarder et de redoubler d’efforts afin de relever ces défis, une fois pour toutes. Dans cette perspective, la Banque Centrale d’Haïti se veut simplement une institution au service du progrès de notre pays, dans l’optique d’une Haïti inclusive. Elle se voit comme un maillon au sein d’une grande chaîne nationale, un partenaire parmi tant d’autres, prêt à apporter une franche collaboration à tout effort de développement conforme à ses attributions statutaires.
Et cette idée me fournit l’occasion de passer au deuxième volet de cette présentation, pour rappeler et les bonnes perspectives de l’économie haïtienne, et la place que doit y jouer ce partenaire indispensable qu’est la Diaspora.
S’agissant des bonnes perspectives, considérons les quatre (4) indicateurs de performance suivants :
- Le taux de croissance annuel moyen de l’économie s’est fixé autour de 2% au cours des 5 dernières années, et il est anticipé un résultat plus robuste pour l’exercice fiscal 2017-2018.
- Durant l’exercice fiscal qui vient de s’achever (2016-2017), les réserves de change nettes ont augmenté pour dépasser le seuil du milliard de dollars.
- Le taux de change s’est écarté de la barre de 70 gourdes pour un dollar qu’il avait presque touchée à fin mars 2017, pour décliner graduellement et atteindre 62,47 gourdes pour un dollar à fin juillet, niveau où il s’est relativement stabilisé. Quant à l’inflation de fin de mois évaluée en glissement annuel, quoiqu’étant encore relativement élevée par rapport aux niveaux de 2010 à 2014 (5 % environ), elle est revenue de la pente ascendante suivie de février 2017 (13,9 %) à juin (15,8 %), pour se stabiliser à 15,6 % en juillet et 15,4% en septembre. Notons que ce taux d’inflation est attribuable principalement aux effets rémanents de l’impact de l’ouragan Matthew sur l’offre agricole et à l’ajustement des prix à la pompe des produits pétroliers effectué durant le 3ème trimestre de l’année fiscale écoulée.
- Le financement monétaire du déficit budgétaire a été réduit de plus de moitié sur la période allant de la fin de l’exercice 2015 à la fin de l’exercice 2016. Il est passé de 9,9 milliards de gourdes au 30 septembre 2015, à 4,5 milliards de gourdes au 30 septembre 2016. L’amélioration de la situation des finances publiques devrait se poursuivre, d’une part, avec le maintien de l’accord de cash management établi entre le Ministère de l’Économie et des Finances et la BRH et, d’autre part, avec la baisse progressive des subventions importantes accordées par l’État haïtien sur les achats de produits pétroliers. Soulignons que la stratégie du cash management consiste à poursuivre une gestion efficace, c’est-à-dire sans gaspillage ni excès, des flux de trésorerie et des soldes de trésorerie à court terme du gouvernement.
Les interventions programmées par la Banque Centrale sur le marché des changes devraient, en conjonction avec d’autres mesures tant de la BRH que des autorités de l’État, contribuer à contenir les pressions inflationnistes. De manière plus générale, les mesures en cours ont plus de chance de réussite sur le long terme avec la mise en place d’une stratégie de relance économique tablant sur l’orientation progressive desdites mesures vers la consommation de biens et de services produits localement, plutôt que la consommation de produits importés. Une telle stratégie se fonde sur une conjonction de trois (3) facteurs, à savoir le renforcement de nos institutions, la réduction des imperfections du marché et la minimisation des contraintes structurelles majeures auxquelles est soumise notre économie.
Renforçant les bonnes perspectives, il y a aussi des avantages comparatifs dont notre pays peut se prévaloir au sein de la zone Caraïbe. Du nombre de ces avantages, citons les atouts suivants :
- La proximité de marchés importants, auxquels le pays bénéficie d’un accès avantagé.
- Un capital historique et culturel d’une richesse imposante.
- Un relief frappant, composé par une géographie qui alterne montagnes et plaines majestueuses serties de plages magnifiques, créant un cadre amène pour le développement durable, touristique en particulier, y compris écologique et culturel.
- Une population jeune dont le dynamisme assure le miracle quotidien de la survie à partir de très peu, et qui ne cherche qu’un minimum de possibilités et d’encadrement pour accomplir sur le sol natal les succès que remportent ses compatriotes vivant à l’étranger.
- Une diaspora fiable et fidèle, principale pourvoyeuse du pays en devises fortes et pépinière en puissance d’investisseurs et, surtout, de ressources humaines dans pratiquement tous les domaines. Et là, on n’insistera jamais trop sur le rôle potentiel de la 2e génération, ces jeunes Haïtiennes et Haïtiens très attachés à la terre de leurs ancêtres malgré qu’ils soient nés aux États-Unis et ailleurs.
- La résilience de la population, liée aux valeurs ancestrales, transmises de génération en génération, qui fait d’Haïti, malgré l’image négative qu’on persiste à lui attribuer, l’un des pays les plus sécuritaires du continent, avec un taux de meurtres par 100 000 habitants parmi les plus faibles. D’autres nations de la région s’enorgueillissent de leur performance sur le plan des investissements directs étrangers et du tourisme avec des taux de criminalité beaucoup plus élevés.
Mais, parlant de Diaspora, justement, quelle pourrait être la contribution de celle-ci dans la mise en œuvre des bonnes perspectives et l’exploitation des avantages comparatifs ?
Considérons d’abord la question du rôle de la Diaspora sous un angle historique.
La contribution financière de la Diaspora figure parmi les flux de capitaux les plus importants dirigés vers Haïti, avec une tendance à la hausse depuis le milieu des années 1990 et une nette accélération à partir de 2010. Haïti est le troisième plus grand bénéficiaire de transferts dans la Caraïbe. Les transferts de notre Diaspora sont passés en moyenne de 5% du produit intérieur brut (PIB) durant la période 1992-1996, à près de 23% du PIB sur la période 2011-2016. Dans le même intervalle, l’apport des transferts au financement du déficit commercial d’Haïti est passé en moyenne de 27% à 70%. En 2015, les transferts excédaient le flux d’investissements directs étrangers par un multiple de 20. Depuis le début des années 2000, les transferts des Haïtiens vivant à l’étranger sont devenus la principale composante de l’offre de devises en Haïti.
Au-delà de cette contribution financière très importante, la Diaspora fournit à Haïti un potentiel considérable sur le triple plan de la hausse de la productivité, de la formation du capital humain et de l’essor du secteur du logement. En effet, selon une étude publiée par la Banque Interaméricaine de Développement (BID), l’éducation représente, après l’alimentation, le deuxième poste le plus important dans les dépenses des bénéficiaires de transferts. L’enquête souligne que la contribution de la Diaspora est tout aussi significative dans le secteur du logement.
L’évidence est claire : le caractère unique du poids que la Diaspora en est arrivée à se donner dans la réalité économique de notre pays est incontestable. La question maintenant est de savoir comment assurer un ancrage encore plus profond de la Diaspora en terre natale, particulièrement en termes de participation à l’agenda de croissance forte et soutenue dont il fut question plus tôt.
Ce point nous amène au 3e et dernier volet de mon intervention, lequel dévoilera quelques exemples de projets d’investissement qui ont réussi en Haïti. L’idée est de montrer que, dans notre pays, ce ne sont pas les opportunités d’affaires qui manquent aux investisseurs, de la Diaspora surtout. Ensuite, je décrirai des mesures élaborées par la BRH comme incitation au secteur productif et aux exportations.
Dans le cas des investissements locaux, des montages financiers de qualité ont permis d’intégrer l’apport de partenaires de la Diaspora dans le capital d’entreprises locales. Ces montages ont été réalisés dans trois secteurs clés de l’économie : l’industrie alimentaire, l’hôtellerie et la production d’énergie. De plus, des investissements directs étrangers, ou IDE, ont été effectués, avec pour souci l’intégration de la production locale dans des chaînes de valeur, comme dans le cas de la Brasserie Nationale, ou Brana, et celui du petit mil. D’autres success stories ont été réalisées avec des entreprises fonctionnant dans le secteur de la téléphonie mobile et des établissements hôteliers liés à des franchises internationales.
Nous ne saurons trop exhorter le déploiement des investissements directs étrangers en Haïti. Contrairement aux investissements de portefeuille, les IDE sont peu volatiles. Leur impact sur l’emploi, sur l’assiette fiscale et sur la croissance économique est plus stable. De plus, les IDE occasionnent souvent des apports en nouveaux savoir-faire, en nouvelles technologies, en nouvelles techniques de production et de gestion. Ils contribuent donc à enrichir leurs secteurs d’activité en les rendant plus productifs et plus compétitifs, et en leur facilitant l’accès aux marchés internationaux, souvent à travers leurs réseaux d’entreprises. À titre d’illustration, prenons le business hôtelier qui, de nos jours, relève de réseaux constitués d’agences de voyages (réelles ou virtuelles), d’agences de croisière, de lignes aériennes, de services d’assurance, etc.
La Diaspora a tout intérêt à rechercher des mécanismes susceptibles de générer en Haïti des projets alimentés par des investissements directs étrangers, et aussi par des prêts bancaires transfrontière. Une telle initiative, menée systématiquement sous tous les cieux où se retrouvent des investisseurs potentiels de la Diaspora, aiderait à la mise sur pied du cercle vertueux qui induira l’émergence d’autres success stories à travers l’élaboration d’un cadre où l’investissement public jouera pleinement son rôle de catalyseur de l’investissement privé, notamment, bien sûr, celui de la Diaspora. Ceci est d’autant plus urgent que l’épargne intérieure privée en Haïti est très faible par rapport aux besoins énormes de financement qu’implique le développement durable, tandis que le système financier haïtien ne dispose que d’environ 1,4 milliard de dollars de ressources qui pourraient, lorsque les circonstances le permettront, être orientées vers des projets porteurs viables, présentant un niveau de risque raisonnable.
Quant à l’appel à l’épargne extérieure, laquelle combine les dons officiels, les prêts publics et les prêts privés, il reste conditionné aux exigences des organismes multilatéraux de financement et aux disponibilités que permet la performance économique des bailleurs de fonds bilatéraux. Il y a donc lieu de minimiser certaines contraintes structurelles et institutionnelles afin d’aménager un accès direct à l’épargne privée et, de là, œuvrer à l’approfondissement du marché financier. Par exemple, l’accès aux capitaux internationaux pourrait être favorisé, d’une part, par la mise en commun des ressources locales et de celles de la Diaspora et, d’autre part, par l’élaboration d’instruments de garantie internationale et d’autres mécanismes de mitigation des risques.
Cet ensemble de contraintes peut être transformé en opportunités, pour vous, frères et sœurs de la Diaspora. Permettez que je vous communique, en tant que « policy maker » et acteur évoluant sur le terrain, les pistes suivantes :
- Il y a lieu d’améliorer votre capacité associative autour de projets d’envergure. L’entreprise individuelle, de petite taille, à faible niveau de capital, est très vulnérable aux chocs et est assujettie à des dépenses d’opération élevées ;
- Il y a des opportunités dans des domaines à fort potentiel de demande au sein même de la Diaspora, tels que les développements résidentiels gardiennés (gated residential communities), destinés aux retraités ou à d’autres acquéreurs intéressés
- La diaspora peut investir et participer à la gouvernance, par l’apport en capitaux de long terme ou par l’acquisition d’actions dans des produits d’investissement tels que :
- des entreprises en pleine croissance, notamment les startups, dont l’évolution est limitée par des besoins en capital ;
- des entreprises dont le fort potentiel est affecté par toutes sortes de difficultés, surtout d’approvisionnement en capital ;
- des entreprises en vente ou en transfert de propriété;
- des partenariats public-privé ;
- Les principaux organismes financiers multilatéraux (IIC, IFC) et certains bailleurs bilatéraux disposent d’enveloppes au bénéfice de projets privés porteurs, notamment d’investissements directs étrangers, dont vous pourriez tirer avantage.
C’est dans la perspective de la recherche de nouvelles pistes de solution pour stimuler l’investissement en Haïti que la BRH a mis en œuvre des programmes spécifiques en vue de promouvoir certains secteurs productifs à forte valeur ajoutée, susceptibles d’avoir des retombées directes sur l’emploi et la croissance économique. Ces programmes d’incitation au secteur productif sont les suivants :
- Le programme KAY PAM, mis en place après le séisme du 12 janvier 2010 de manière à stimuler le crédit au logement en faveur de la classe moyenne. Il comporte les caractéristiques suivantes : le taux d’intérêt est compris entre 8% et 10%, et il est fixe sur 10 ans ; le financement est libellé en gourdes, et il porte sur la construction, la rénovation et l’acquisition de maisons.
- Le programme de développement des zones franches, mis en place en décembre 2015, et qui vise essentiellement à augmenter la capacité du pays à bénéficier des lois HOPE II et HELP , lesquelles ont été renouvelées par le Sénat américain en août 2015 pour 10 ans. Créé en partenariat avec les banques commerciales, ce programme permet non seulement d’accroître les exportations et le nombre d’emplois dans le secteur textile, mais aussi aux promoteurs de zones franches de se financer auprès des banques à des conditions favorables incluant un taux d’intérêt maximum de 7%.
- Le programme de financement des exportations établi suite à des protocoles d’accord signés en octobre 2016 par la BRH avec deux sociétés financières de développement, le Fonds de Développement Industriel (FDI) et la Société Financière Haïtienne Industrielle de Développement Économique et Social (SOFHIDES). Ce programme favorise l’accès au crédit pour les entreprises de production de biens et services destinés à l’exportation. Il comprend une fenêtre de refinancement des comptes à recevoir des exportateurs, et une facilité de crédit visant le renforcement des capacités de production des entreprises ciblées. Cela devrait mener à moyen et long terme à la réduction du déficit de la balance des paiements.
- Le programme d’incitation aux secteurs touristique et hôtelier, par lequel les banques sont exonérées de l’obligation de constituer des réserves obligatoires sur les ressources qu’elles utilisent pour financer des projets réalisés dans les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie. Lesdits secteurs peuvent ainsi obtenir du crédit à des taux d’intérêt plus favorables.
D’autres projets sont à l’étude dans le cadre des mesures d’incitation aux secteurs productifs. Il s’agit, notamment, de la promotion de projets de développement immobilier, de la promotion de la copropriété et de zones franches agricoles, et de la mise en place de garanties partielles de crédit et de programmes d’assurance au bénéfice du secteur agricole. Enfin, la BRH s’est récemment engagée dans une série d’activités de facilitation de dialogue et de réflexion entre les acteurs clés de différentes filières d’activité à forte valeur ajoutée. Cet exercice vise le renforcement des politiques et des mécanismes de financement capables d’influencer le développement économique du pays de manière durable.
Chers amis,
Au vu des opportunités d’affaires et des efforts d’accompagnement de l’État que je viens d’évoquer, j’invite la Diaspora à suivre l’exemple des devanciers qui, ayant choisi d’investir en Haïti, ont pour la plupart déjà pris place parmi les plus grands contribuables du pays. La Diaspora a tout intérêt à tirer avantage de formules qui ont donné la preuve de leur efficacité. Sa contribution au développement de la terre natale passerait à un niveau autrement important si elle complétait ses transferts traditionnels avec des initiatives orientées vers l’investissement en Haïti.
Les associations régionales et locales de la Diaspora pourraient s’associer aux autorités haïtiennes, notamment les municipalités, dans une logique de partenariat public/privé destiné à financer les projets de développement régional. Les besoins d’investissement ainsi que les opportunités qui en découlent sont immenses dans les infrastructures socio-économiques de base comme l’éducation, la santé, la distribution de l’eau potable et les énergies renouvelables. La Diaspora pourrait aussi investir directement dans les entreprises qui acceptent d’ouvrir leur capital. Il s’agirait de promouvoir l’expansion ou la création d’entreprises d’économie mixte dans le cadre d’opérations conjointes avec des institutions déjà impliquées dans ce type d’activité comme le Fonds de Développement Industriel (FDI) et la Société Financière Internationale (SFI). Enfin, outre la création de chambres de commerce régionales et la mise en place de réseaux d’affaires, la contribution de la Diaspora peut aussi s’étendre aux échanges commerciaux et aux transferts de compétences et de technologies.
Ce dernier aspect s’adresse particulièrement aux jeunes professionnels de la 2e génération, dont nous avons entendu parler des prouesses sur le marché du travail nord-américain, et jusque dans les salles du conseil d’administration des grandes entreprises, et même dans la Maison Blanche de l’ancien Président Barack Obama. Bref, ces jeunes Haïtiennes et Haïtiens nés en dehors d’Haïti, et dont les succès en terre étrangère font notre fierté à tous.
Voilà, Mesdames, Messieurs, quelques initiatives qui pourraient progressivement permettre à la Diaspora de maximiser les opportunités d’investissement en Haïti. La Banque de la République d’Haïti joue sa partition à travers des mesures pro-croissance destinées à promouvoir le secteur productif et d’exportation, et à aider à transformer le cercle vicieux dans lequel nous sommes en un cycle vertueux de croissance forte et soutenue, de réduction drastique de la pauvreté et d’amélioration substantielle continue du niveau de vie de la population.
Je vous remercie de votre attention.
Jean Baden Dubois
Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti